La question de « l’aide » américaine à la France et généralement aux puissances européennes dans les années 1940-1950 est un sujet passionnant mais aussi d’une brûlante actualité au regard de la politique américaine vis-à-vis des pays européens depuis maintenant plusieurs années, et en particulier dans le cadre des opérations militaires en Ukraine. Cette question se double d’une autre : l’évaluation du « plan Marshall ».
Ce dernier est en effet devenu le symbole d’une aide supposée désintéressée et efficace au relèvement des pays d’Europe occidentale, au point qu’il est utilisé désormais dans le langage commun : on a évoqué un « plan Marshall pour les banlieues »et aujourd’hui on parle d’un « plan Marshall pour la rénovation des logements ». Il est ainsi devenu le synonyme de ce que l’on doit, ou que l’on devrait, faire dans certaines circonstances. Mais, le plan Marshall originel justifiait-il ces jugements et cet enthousiasme ? Depuis maintenant aux moins deux dizaines d’années, on assiste à une relecture nettement plus critique.
Un livre important, un livre dérangeant, un livre critiquable
C’est donc dans ce contexte qu’Annie Lacroix-Riz a publié en octobre 2023 un livre important et imposant sur les origines du plan Marshall[1]. Important, il l’est par son sujet. Le débat a commencé depuis maintenant plus de vingt ans sur les motivations profondes de l’engagement des États-Unis dans ce que l’on appelle le plan Marshall ou ERP (Emergency Recovery Program). Imposant, il l’est par sa forme (571 pages), mais aussi par des sources très importantes. Avertissons immédiatement le lecteur, c’est un livre à thèse. L’autrice y défend celle d’une aide américaine pensée exclusivement au service des États-Unis et dans le but d’asseoir une domination totale de ces derniers sur les pays européens. Le titre du premier chapitre de l’ouvrage le prouve. Il s’intitule « la quête américaine de l’hégémonie en Europe ».
Mais, ce livre ne se limite pas à cela. Il porte aussi une seconde thèse qui est celle du ralliement des élites françaises au projet américain, dans la continuité pour certaines de leur précédent ralliement au projet nazi. Cette dernière thèse, qui est dans la continuité d’ouvrages précédents d’Annie Lacroix-Riz[2], contribue cependant à brouiller la première. En effet, elle empiète et réduit l’étude du plan Marshall, et en particulier de ses conditions d’application, notamment, mais pas seulement, de l’importance de l’OECE (la future OCDE) qui fut créée spécifiquement pour coopérer avec l’Economic Cooperation Administration qui devait gérer le plan Marshall[3] et de l’Union Européenne des Paiements[4]. Au vu de l’importance de l’ouvrage, cela est regrettable. La question des élites avait été traitée de manière exhaustive dans trois précédents ouvrages, et elle n’aurait du occuper qu’une place mineure dans celui-ci.
Pour écrire ce livre, Annie Lacroix-Riz a effectué un travail très important. Elle a largement dépouillé les archives françaises, que ce soit dans les archives générales (y compris les fonds privés de certains acteurs), dans les archives policières ou dans les archives de la Banque de France, mais aussi des archives américaines publiées par l’organisme officiel US-GPO (Foreign Relations of the United States ou FRUS) ainsi qu’une très abondante bibliographie. La place tenue par ce que l’on appelle l’appareil critique dans l’ouvrage est considérable : pas moins de 127 pages sur un total de 571 pages soit 22%. Cela classe immédiatement le livre dans la catégorie des ouvrages d’érudition, qui ne sont pas d’une lecture aisée. Il est évident que son autrice a voulu produire un ouvrage de référence, et que sur bien des points elle y est arrivée. On pourrait alors penser que l’on est en présence de l’ouvrage définitif sur la question de l’aide américaine. Ce n’est pourtant pas le cas.
Non que ce livre soit totalement faux ou insignifiant, loin de là. Il est même instructif sur tout une série de sujets. Mais, il présente une approche qui est largement biaisée par les opinions, et même les préjugés, de son autrice. Ce biais se retrouve d’ailleurs dans le choix des sources. Si on ne peut que féliciter Annie Lacroix-Riz d’avoir consacré beaucoup d’attention, et naturellement beaucoup de temps, aux sources d’origine policière (ou de renseignement), on s’étonne alors qu’elle n’est pas pensée à regarder les archives du Général George C. Marshall (pour les États-Unis) ou les archives de Jean Monnet pour ne citer que celles-là, qui sont facilement disponibles car numérisées[5]. Plus généralement, dresser un état des intentions américaines était assurément louable. Mais dresser un bilan de leurs actions, en les resituant dans leur contexte aurait été plus important encore. De plus, présenter les États-Unis comme un acteur unique, sans mentionner les débats importants qui opposèrent des segments de l’administration, soulève aussi un problème. Enfin, présenter les États-Unis comme une sorte de « donneur d’ordres » sans mentionner la « demande » pour une aide, et même une tutelle, américaine chez certains des acteurs européens pose aussi un problème méthodologique important.
S’agit-il d’un problème de perspective ou d’un problème de fond ? Je laisse ici le lecteur seul juge. Mais, il me semble qu’au-delà de différences légitimes de perspectives, la « méthode » Lacroix-Riz soulève un problème.
Perspectives, vous avez dit perspectives ?
La différence de perspective sur un tel sujet était inévitable. Annie Lacroix-Riz est historienne, et l’auteur de ce texte est économiste, même s’il lui est arrivé de commettre des travaux qui sont à la limite de l’histoire[6]. Des champs disciplinaires aussi fortement structurés que le sont respectivement l’histoire et l’économie, même si les fécondations réciproques ont été nombreuses, se caractérisent naturellement par des différences de démarche et d’approche qui sont substantielles. Confronté à la genèse et au développement du plan Marshall, l’économiste commencerait par dresser un tableau de la situation économique. Il envisagerait, ensuite, les effets du plan Marshall au travers de données comparatives, en cherchant d’ailleurs à distinguer, si faire se peut, l’impact du plan des autres facteurs exogènes qui ont pu intervenir sur les économies. Pour tout dire, sans être absolument fermé aux déterminants subjectifs, les opinions ou l’expression des intérêts, l’économiste regarde avant tout les besoins initiaux et les résultats ex-post d’une possible action.
Il est donc normal que l’approche du sujet ne soit pas exactement la même chez l’historienne et chez l’économiste. Néanmoins, l’importance, et on peut même aller jusqu’à parler de fascination apparente, qu’Annie Lacroix-Riz prête aux intentions est troublante, d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une absence quasi-totale d’éléments concrets sur l’état des économies considérées. L’absence totale dans l’ouvrage de tableaux, de graphiques, est d’autant plus surprenante que des historiens travaillant sur des sujets économiques y recourent de manière régulière. On a le sentiment qu’Annie Lacroix-Riz se meut uniquement dans le monde des idées, ce qui est surprenant pour une historienne se réclamant du marxisme.
Pour ma part, j’en présenterai un, dont il convient de se souvenir. On mesure à quel point la France est ruinée par la guerre et l’occupation au 1er semestre de 1945, surtout en comparaison avec les deux pays du continent nord-américains, les États-Unis et le Canada.
Tableau 1
Comparaison de la situation du PNB de la France et d’autres pays, 1938 = indice 100
|
Pays |
1929 |
1938 |
1945 |
1946 |
|||||||
|
1er semestre |
2ème semestre |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
|||
|
États-Unis |
131 |
100 |
258 |
250 |
180 |
170 |
189 |
185 |
179 |
196 |
196 |
|
Canada |
111 |
100 |
271 |
269 |
202 |
196 |
207 |
206 |
197 |
186 |
189 |
|
Suède |
66 |
100 |
79 |
107 |
110 |
111 |
112 |
113 |
113 |
112 |
110 |
|
France |
125 |
100 |
37 |
60 |
65 |
72 |
74 |
80 |
84 |
86 |
(78) |
Source : Présidence du Gouvernement, Rapport Général sur le Premier Plan de Modernisation et d’équipement, Paris, novembre 1946, p. 20
Mais, à lire l’ouvrage d’Annie Lacroix-Riz, qui est rempli d’éléments censés montrer que les États-Unis établissent une tutelle économique complète sur notre pays, le mettent quasiment en coupe réglée, on oublie qu’en un an, de juin 1945 à juin 1946, la PNB[7] de la France augmente de +132% alors que la Suède, pays neutre et qui n’a pas connu la dévastation qui fut le lot de notre pauvre pays, même si elle fut très contrainte dans ses relations commerciales avec l’Allemagne nazie, ne voit elle son PNB augmenter que de +41,7%.
Cela interroge. Nous n’avons pas de raison de mettre en doute les sources abondamment citées par Annie Lacroix-Riz. Mais on constate qu’elles dressent un tableau de la réalité qui ne correspond pas toujours aux faits.
Ceci nous amène à un autre problème de perspective. Madame Lacroix-Riz a largement fait sa carrière dans le monde universitaire. Pour ma part, et je n’en tire aucune gloire, j’ai partagé ma carrière entre un cadre universitaire et un cadre non-universitaire, travaillant comme conseiller ou comme consultant pour des administrations d’État. Cela m’a sans doute donné une sensibilité particulière à la manière dont les archives des administrations régaliennes sont constituées. Une note de police ou de la DGSE n’est pas « la » vérité, mais ne fait que traduire la manière dont la culture spécifique d’une certaine administration apprécie les choses et les hommes. J’en donnerai un exemple, où je demande à mes lecteurs de me croire sur parole : en 1996, en Russie, j’eu l’occasion de consulter les fiches me concernant rédigées l’une par l’ex-KGB (et ses successeurs) et l’autre par le GRU (services de renseignement de l’Armée).
La différence entre ces deux fiches était plus que substantielle ; elle était, si l’on peut oser le mot, philosophique. Là où la première relevait du renseignement de basse police, contenait des affirmations erronées sur mes idées et mes liens politiques, des suppositions souvent extrêmement hasardeuses, et se révélait par ailleurs incomplète, la seconde était un constat froid et sans jugement de l’ensemble de mes activités, couvrant d’ailleurs – et ce fut une surprise pour moi – ma scolarité à Sciences Pô avec le nom de mes charges de conférences, mes notes et la liste de mes condisciples. J’aurai pu, avec quelques modifications de langage, utiliser la seconde comme curriculum vitae. La première était clairement inutilisable, voire pouvait provoquer chez ses destinataires des actes ou des réactions clairement faussées. J’avais eu, en 1982, une expérience similaire quand il m’avait été donné l’occasion de consulter ma fiche au Renseignements Généraux (les RG), où la fantaisie le disputait à l’incompétence.
Si je me suis permis de citer cet exemple personnel c’est pour faire comprendre au lecteur qu’il ne faut jamais prendre des archives issues d’administrations régaliennes au pied de la lettre. C’est pourtant ce que fait Annie Lacroix-Riz très, et peut être trop, souvent. Pourtant, en tant qu’historienne, elle aurait dû avoir en tête les réflexions de Nathan Wachtel sur la vision des vainqueurs et celles des vaincus[8]. Bref, ce n’est pas parce que le SDECE, la Police, voire le Quai d’Orsay mettent une chose dans un document écrit qui est ensuite archivé que cette chose est totalement, voire parfois partiellement, vraie. Ici encore, j’ai vu dans des administrations françaises des notes de très bonne qualité être brulée sitôt que lue (ou envoyée au broyeur) et des notes de qualité médiocre être archivées…sans être lues.
Je ne prétends pas que toutes les archives sont constituées de fonds de tiroirs et de papiers de mauvaises qualités. J’affirme néanmoins que la proportion de ces « canards » comme on dit dans la presse est suffisamment substantielle pour nécessiter une aide au dépouillement de ces archives, aide qui peut parfois provenir de l’interview des acteurs (ce qui n’est cependant pas sans risques non plus pour l’interprétation), ou de l’usage d’autres documents indépendants. Trop souvent, hélas, une erreur contenue dans une archive est répétée sans cesse par des gens qui considèrent que les archives sont Dieu et les Prophètes…Cela pose donc un problème de méthodologie quant au travail d’Annie Lacroix-Riz.
Le prêt-bail et avant
Sur le fond, Annie Lacroix-Riz est parfaitement fondé à voir dans le « Prêt-Bail » ou Lend-Lease l’une des origines du plan Marshall. On peut cependant y ajouter l’expérience de la commission Franco-Britannique d’achats aux Etats-Unis qui dépensa, de fin 1938 à 1940 des sommes considérables en comparaison du budget de la défense de l’époque des États-Unis. Ce budget fut, pour 1940, de 3,6 milliards de dollars. Or le financement global est largement supérieur aux dépenses des États-Unis (qui ne comptent pas les exportations d’armes vers la France et la Grande-Bretagne en 1939 et 1940).
Compte tenu du fait que les franco-britannique ne payèrent pas seulement du matériel mais financèrent des extensions d’usines et payèrent de larges « primes d’accélération », la contribution de la France et de la Grande-Bretagne peut être estimée entre 1% à 2% du PNB des États-Unis[9], soir à l’époque, et avant que les États-Unis ne basculent dans un effort de guerre important (ce qui se fera dès la fin du printemps 1940[10]), peut être considéré comme une contribution très importante au réarmement américain. Ces sommes, dans le cadre de la loi « Cash and Carry » doivent de plus être réglées en or. C’est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne demande une nouvelle loi qui lui permettra d’acheter à crédit. En réalité, le « Lend-Lease » est en apparence plus généreux qu’un crédit. Notons d’ailleurs qu’il y a une confusion dans l’ouvrage d’Annie Lacroix-Riz sur la date exacte du prêt-bail et sur l’accord d’aide mutuelle avec la Grande-Bretagne. Le prêt-bail est signé le 11 mars 1941[11] et l’accord de 1942 (elle parle alors de « mise en œuvre ») est en réalité formel. Les premières armes obtenues dans le cadre du prêt-bail arrivèrent en Grande-Bretagne en mai 1941.
Annie Lacroix-Riz présente l’accord comme un accord commercial. Mais la réalité est assez différente. Les armes étant « prêtées » à la Grande-Bretagne (et aux belligérants contre l’Axe), l’insistance qu’elle met sur la clause de non-réexport n’a pas de sens[12]. Un objet faisant l’objet d’un prêt ne peut pas être reprêté voir vendu sans l’accord de son propriétaire. De fait, certaines armes obtenues par la Grande-Bretagne avant l’été et l’automne 1941 furent bien réexportées vers l’URSS à l’automne 1941 car les canaux spécifiques du prêt-bail vers l’URSS (la voie iranienne et la voie par l’Alaska et la Sibérie) n’étaient pas encore en opération. Ainsi, des avions américains (des P-40) « prêtés » aux britanniques furent, avec l’accord de Washington, réexportés vers l’URSS[13]. Il faut d’ailleurs ajouter que le prêt-bail au profit de l’URSS (en provenance des États-Unis et de la Grande-Bretagne) joua un rôle considérable à la fois pour la stabilité sociale de l’URSS (en fournissant une nourriture que l’agriculture soviétique, dévastée, n’était plus, elle, en mesure de fournir) mais aussi en apportant à l’URSS les produits chimiques sans lesquels elle n’aurait pu disposer des munitions nécessaires à ses offensives de 1943 à 1945. La même remarque vaut pour les transports (camions et locomotives)[14].
Présenter ainsi la loi prêt-bail de manière unilatérale comme un instrument de domination des États-Unis est alors fallacieux. Non que ces derniers n’aient voulu obtenir des garanties avant de s’engager dans une opération qui représentera 17% des dépenses militaires de 1941 à 1945, ce qui est somme toute normal. Mais, la première motivation était avant tout militaire, quoi qu’aient pu dire, penser ou écrire, certains diplomates. Le prêt-bail ne fut d’ailleurs pas géré par de Département du Commerce mais bien par l’administration militaire. L’objectif principal n’était pas comme l’écrit Annie Lacroix-Riz « la maîtrise de l’Europe »[15] mais la défaite de l’Allemagne. La question de la « maîtrise » de l’Europe, ou du moins de l’hégémonie américaine ne s’est posée que quand la victoire a été en vue.
Les conditions de liquidation du prêt-bail sont, elles, bien plus discutables et globalement plus conformes avec ce qu’en dit Annie La croix-Riz dans son livre. L’attitude des États-Unis fut, sur ce point, clairement prédatrice. Cependant, ici aussi, il est matériellement faux d’affirmer que quand Dean Acheson propose de vendre aux alliés des États-Unis les bateaux civils construits de 1943 à 1945 (les Liberty Ships) il fait preuve d’une quelconque « insolence »[16]. En réalité, compte tenu des pertes dans la bataille de l’Atlantique, les flottes commerciales des alliés étaient exsangues. Les chantiers navals étaient soit détruits ou à tout le moins très endommagés (France, Pays-Bas, Belgique), soit surchargés de commandes militaires (Grande-Bretagne). Or, sans navires de commerce, il n’y a pas de commerce…
Remarquons aussi que lors de la liquidation des surplus américains en Europe, qui se fit essentiellement avant l’entrée en fonction du plan Marshall (de l’été à la fin 1948), ces surplus n’étaient nullement de la « quincaillerie » ainsi qu’il est suggéré dans le livre. Il s’agissait de dizaines de milliers de camions, mais aussi de wagons, de locomotives, de matériels du génie. Ces « surplus » furent cédés à un prix dérisoire (entre 1 à 5 dollars pièces) aux gouvernements des pays qui allaient recevoir le plan Marshall, ce qui les aida fortement. En France, la revente au secteur privé des camions GMC et des matériels ainsi obtenus représenta une manne financière pour le budget de l’État, qui lui permit de réduire le déficit.
Ici encore Annie Lacroix-Riz fait un mauvais procès d’intention aux États-Unis alors qu’elle pourrait, de manière bien plus justifiée, se poser la question du prix de revente ou insister sur les conditions de l’aide post-prêt bail où les conditions mises par Washington furent effectivement léonines. De ce point de vue, les chapitres 6 et 7 de l’ouvrage sont très instructifs, et il y a peu de chose à redire. C’est dans la période de transition entre la fin du prêt-bail et la mise en place d’un régime « post prêt-bail » que les américains se montrèrent les plus mesquins et firent globalement beaucoup de mal à la France et aux français.
Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage…
C’est au travers des chapitres qui suivent les deux premiers que l’on voit se déployer la méthode Lacroix-Riz, avec ses outrances, mais aussi ses remarques très justes, avec les pépites qu’elle a trouvées dans les archives, mais aussi les gros cailloux qu’elle entend nous faire prendre pour de l’or.
Commençons par un point soulevé dans le premier chapitre. La question des bases américaines au Groenland et en Islande est très mal posée. Pour l’Islande, s’agit en réalité d’une demande britannique, liée à la « Bataille de l’Atlantique », formulée dès 1941, soit avant l’entrée en guerre des États-Unis. L’Amirauté britannique craignait un débarquement allemand en Islande, l’opération Ikarus qui avait bien été planifiée par les forces du Reich, qui aurait été catastrophique[17]. La Grande-Bretagne avait déployé jusqu’à 25 000 hommes dans l’île, forces dont elle avait besoin de manière urgente ailleurs (au Moyen-Orient notamment). Le remplacement des forces britanniques par les forces américaines (à l’époque encore « neutres » bien que les États-Unis s’engageaient de plus en plus dans la « Bataille de l’Atlantique) s’explique très logiquement[18].
Dans le même ordre d’idées, la question des bases météo n’est ni un « détail » ni un prétexte. La capacité d’obtenir des prévisions météorologiques dans l’Atlantique nord était vitale pour l’organisation des convois. Ainsi, Les Allemands, en raison de l’importance vitale pour l’attaque des convois de ces données, ont tenté d’installer des stations météorologiques terrestres dans des endroits contestés tels que le Spitzberg et même sur les côtes alliées, comme la station météorologique automatisée Kurt qui fonctionna au Labrador. Les Allemands étaient obligés, en raison de leur situation continentale, de s’appuyer en grande partie sur des avions à long rayon d’action (le FW-200 Condor) et des navires météorologiques, vulnérables aux attaques pour les navires de surface ou à une détection précoce pour les cas des U-Boot[19]. C’est pourquoi ils se reposèrent aussi sur des stations clandestines situées dans des endroits exposés. Les Alliés avaient un net avantage dans la compétition, contrôlant toutes les principales îles (Terre-Neuve, Groenland, Islande, Grande-Bretagne) de l’Atlantique Nord.
Étant donné que les conditions météorologiques à cette latitude se déplacent généralement d’ouest en est, les Alliés pourraient suivre la progression d’un front lors de sa traversée de l’Atlantique. Les Allemands, avec leur petit nombre de stations d’observation (éphémères), ne pouvaient compter que sur la chance pour détecter un front météorologique avant qu’il n’atteigne l’Europe. En août 1941, lors de la préparation de l’opération Gauntlet (occupation du Spitzberg), la Royal Navy détruisit la station météorologique de l’île aux Ours et plus tard, celle du Spitzberg (après avoir transmis de fausses informations pour décourager l’observation aérienne). Le Spitzberg était un lieu important : il permettait aux Allemands de surveiller les conditions météorologiques sur la route des convois alliés vers le nord de la Russie.
Les Allemands ont tenté à plusieurs reprises d’établir et de maintenir des stations météorologiques dans l’archipel du Svalbard, notamment au Spitzberg et à Hopen (stations Svartisen et Helhus), et celles-ci n’ont jamais été supprimées. Les autres emplacements utilisés comprenaient ceux de l’île Jan Mayen, de l’Île aux Ours et de l’est du Groenland avec des équipes et des stations automatisées. La Kriegsmarine a fait fonctionner la station habitée Schatzgräber sur l’Alexandra Land dans l’archipel soviétique de la Terre François-Joseph de novembre 1943 à juillet 1944[20]. Une simple recherche aurait ainsi évité à Mme Lacroix-Riz d’écrire à ce sujet des bêtises.
Un second point sur lequel on peut largement contester le traitement de l’information fait par Mme Lacroix-Riz concerne les relations industrielles et bancaires entre les Etats-Unis et l’Allemagne avant et pendant la guerre. Non que ces relations n’aient pas existé. Mais il est mensonger de laisser entendre que les États-Unis les ont maintenus après leur entrée en guerre. Un exemple peut être donné par le cas des relations entre le groupe suédo-allemands SKF-VKF et les américains, qui est largement détaillé à la page 78 de l’ouvrage. L’usine allemande fut en réalité massivement attaquée par la 8ème Air Force le 14 novembre 1943.
Cette attaque se solda par ailleurs par des lourdes pertes pour les aviateurs américains, qui sur les 291 B-17 participant à cette mission en perdirent 60, virent 17 autres appareils endommagés au point d’être inutilisables et 121 autres endommagés à des degrés divers soit une proportion de 68% d’appareils détruits ou endommagés au cours d’un seul raid alors que la proportion acceptable était inférieure à 10%[21]. Sur les 2900 membre d’équipage participant à ce raid, 650 furent tués, sans compter les prisonniers et les blessés. Mais, ces pertes (conséquences de la tactique employée par l’USAAF) et l’effet médiocre du bombardement (dû à la fois à l’emploi de bombes trop légères et d’une analyse de la place de l’usine dans l’effort de guerre allemand défectueuse[22]) ne remettent nullement en question l’effort considérable consacré par l’aviation américaine à la destruction de l’usine de Schweinfurt.
On ne peut ici échapper à l’impression, en lisant le livre d’Annie Lacroix-Riz, que cette dernière s’est laissée emporter par son anti-américanisme au point de faire de mauvais voire de faux procès, aux États-Unis. Encore plus surprenant, pour une historienne se réclamant de la tradition marxiste, voire de la politique du PCF dans cette période, elle en vient de fait à défendre les empires coloniaux, l’empire français mais aussi la colonisation belge, pour mieux dénoncer la politique américaine.
Dans un autre cas, la méthode d’Annie Lacroix-Riz confine au burlesque. Les discussions entre le plan britannique et le plan américain concernant le système monétaire et commercial de l’après-guerre, qui donnera la conférence de Bretton Woods en 1944, n’est traité que par des notes archivées des services de renseignement français dont on peut raisonnablement douter qu’ils aient eu accès à l’ensemble de la documentation existante. Signalons à notre collègue que les archives de J.M. Keynes (le négociateur britannique) se trouvent à l’université de Cambridge[23], et que ses contributions, mémorandums et autres papiers ont été publiés dans le volume 27 des The Collected Writings of John Maynard Keynes publiés aussi aux Cambridge University Press par Elizabeth Johnson et Donald Moggridge[24].
Les apports de l’ouvrage
Cet ouvrage contient cependant des apports que l’on aurait tort de négliger. Il détruit, même si c’est malheureusement parfois à l’aide d’arguments fort discutables, l’image d’une aide désintéressée, d’une Amérique altruiste qui n’a jamais existé. C’est un point important, mais qui ne surprendra que les tenants d’une approche « morale » ou « idéaliste » des relations internationales. Pour les partisans d’un point de vue « réaliste »[25], et d’une certaine manière le marxisme est bien plus proche d’une approche réaliste que d’une approche morale ou idéaliste, chaque pays défend ses intérêts. De ce point de vue, l’attitude des États-Unis est parfaitement explicable. Ce que montre Annie Lacroix-Riz c’est la persistance de cette défense des intérêts américains, et des grandes entreprises qui en sont la base.
Il est indiscutable que la sortie de l’isolationnisme qui prévalait dans les années 1920, où cette défense était avant tout celle des intérêts des entreprises, sortie que l’on peut dater de la période de 1937 à 1941, et le passage à un interventionnisme où ce qui prévaut sont les intérêts de l’État, s’est largement matérialisée dans la question de l’aide économique et militaire qui bien souvent unit l’État et les grandes entreprises. Cette persistance s’appuie sur des réseaux d’individus qui ont des intérêts communs, mais peut être encore plus une formation commune. Les origines universitaires des acteurs comptent ainsi beaucoup, non seulement parce qu’elle permet d’expliquer une forme d’unité idéologique, mais aussi parce qu’elle est bien souvent la base même des réseaux d’influence et de connivence. Cette persistance n’implique cependant pas que les méthodes soient toujours les mêmes.
Annie Lacroix-Riz marque encore un point, même si ce dernier est en réalité plus marginal quand elle décrit et analyse le glissement des élites françaises vers une forme de soumission à l’influence américaine. C’est sans doute sur ce point, dans les chapitres 3 et 4, que l’apport des archives policières est le plus pertinent. Une partie de ces matériaux n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été exploitée par Annie Lacroix-Riz[26]. Mais, ce qui est nouveau est ici l’étude de l’évolution (en particulier pour la frange pro-allemande) et la nature de ses liens avec les élites américaines. On y apprend de nombreuses choses ; d’autres, qui étaient jusqu’à présente supposées, sont confirmées. Ce qui est discutable est la place de cette étude dans l’ouvrage.
Nous ne sommes plus dans « les origines du plan Marshall » mais dans une étude, extrêmement détaillée et précieuse, de l’idéologie et des comportements politiques de l’élite française. Elle revient d’ailleurs sur ce terrain dans le chapitre 5, mais aussi dans les chapitres 7 et 8 de l’ouvrage. Ces derniers sont d’ailleurs moins « décalés » par rapport à l’axe de l’ouvrage que ne le sont les chapitres 3 et 4, car ils traitent des tentatives de négociations des divers gouvernements français avec une administration américaine qui ne semble avoir de cesse que d’humilier et de ridiculiser les plénipotentiaires français. Il convient aussi de noter l’amateurisme de certaines délégations françaises qui semblent avoir quitté Paris imprégnées de politique étrangère morale ou idéologique et durent se confronter au froid réalisme, parfois teinté de cynisme, de la partie américaine. L’odyssée du voyage de Léon Blum à Washington est, sur ce point, très instructive[27].
Pour autant, la méthode adoptée par Annie Lacroix-Riz n’est pas sans défaut.
Eut-elle consulté les archives Jean Monnet de Lausanne, elle eut pu voir un personnage assez différent du féal des États-Unis que Monnet fut certainement de 1941 à 1944 et après 1949. Dans sa bataille pour l’autonomie du Commissariat Général au Plan, bataille que Monnet mena avec détermination et acharnement de février à octobre 1946[28], on peut y découvrir un homme différent, presque souverainiste, qui cherche avant tout à protéger les intérêts de la France, qui envisage de prendre Jean Perroux comme économiste avant qu’une levée de boucliers politique ne lui impose Marjolin[29].
Si elle avait étendu son étude à la Grande-Bretagne, qui traverse – et elle le montre bien – des affres similaires à ceux de la France[30], elle aurait pu étudier la résistance d’Attlee face aux États-Unis en 1946 (on pense à l’éphémère mais important accord commercial de 1946 avec l’URSS[31]) et comprendre aussi pourquoi, et dans quelles conditions, se dernier se rallia-t-il aux exigences américaines.
Cela pose la question de la nature du ralliement aux positions des États-Unis des uns et des autres. On propose alors une typologie dont on pense qu’elle aurait pu être utile pour classer, par périodes, un certain nombre d’acteurs. Le tableau que l’on présente exclut les positions communistes orthodoxes car ces dernières sont orthogonales par principe, et du fait de leur alignement sur les positions soviétiques, à un quelconque pro-américanisme, du moins en France.Lire la Suite ICI
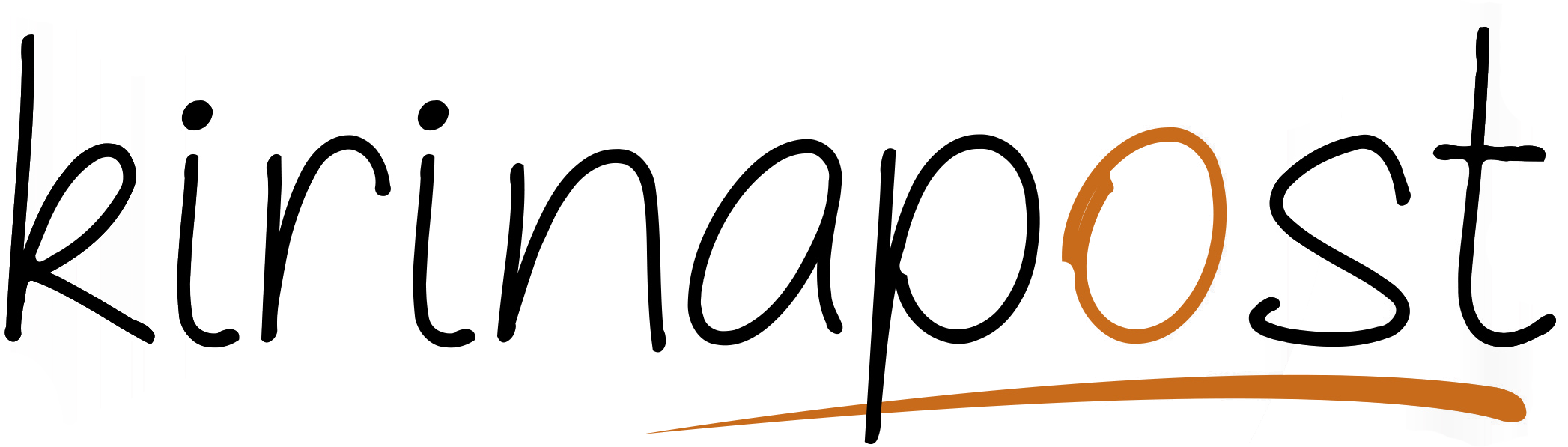










Laisser un commentaire