La guerre, à quoi ça sert ? Eh bien, déjà aux médias pour commencer. Peu après que l’administration Biden a réagi à l’assassinat de trois soldats américains lors d’une attaque de drone sur une base en Jordanie en bombardant 85 cibles liées à l’Iran en Irak et en Syrie, la Columbia Journalism Review (CJR) s’est interrogée dans un titre : « La presse entraîne-t-elle à nouveau l’Amérique dans la guerre ? ». Encore une fois ? me suis-je dit. Ne devrait-on pas dire « comme d’habitude » ?Source TomDispatch, Nan Levinson Les-Crises
Ce titre figurait dans une récente lettre d’information de Media Today, rédigée par Jon Allsop, qui traite régulièrement de ce que l’on pourrait considérer comme le sujet favori des journalistes : eux-mêmes. Il réfléchissait à la critique des médias sur la façon dont le gouvernement avait (ou n’avait pas) divulgué d’informations sur les frappes qui venaient d’être lancées, ainsi que sur ses objectifs, tout en considérant l’accusation selon laquelle certaines plates-formes d’information encourageaient une guerre régionale plus large. CJR (connu comme) étant une publication impartiale, Allsop a mis en garde contre toute généralisation (comme je m’apprête à le faire), soulignant : « Poser des questions sur les frappes prévues n’équivaut pas à les préconiser. » En effet, ai-je pensé, mais lorsque vous concentrez vos questions sur ce sujet, comme l’ont fait tant de médias après la mort d’Américains et avant que l’administration Biden ne lance ses attaques, il n’est pas surprenant que cela puisse avoir cet effet.
Alors que le bilan des morts à Gaza dépassait le nombre de 30 000, les reportages sur le terrain concernant les conditions de vie de plus en plus insupportables dans cette région rendaient la stratégie de riposte armée d’Israël de moins en moins défendable. Il n’est donc pas étonnant que les médias américains se soient concentrés de plus en plus sur la perspective d’un cessez-le-feu. Et semblant aller de pair avec cette option, les reportages faisant état de l’anxiété concernant le déroulement de la guerre en Ukraine ont retrouvé leur place en Une sur l’équivalent numérique, ce qui m’amène à me demander dans quelle mesure les médias auraient besoin, à tout moment, d’au moins une guerre à applaudir ou à redouter.
Les situations en Ukraine et à Gaza sont tout à fait différentes sur le plan militaire, stratégique, politique, moral ou journalistique, et il y a des raisons concrètes pour se concentrer une fois de plus sur l’Ukraine. Après tout, c’était le deuxième anniversaire de l’invasion russe du 24 février 2022. Les évaluations habituelles de la situation, avec des prédictions sur les perspectives militaires de l’Ukraine allant de la sinistrose à la catastrophe, et des photos montrant les dures et peu glorieuses misères de la guerre, se sont succédées. L’ONU a certifié qu’au moins 10 582 civils ukrainiens avaient été tués à la fin du mois de février, tandis que les estimations (que l’on suppose être des sous-estimations fantaisistes) font état de plus de 45 000 soldats tués pour la Russie et de 31 000 pour l’Ukraine, ainsi que de dizaines de milliers de blessés dans les deux camps.
Si l’on ajoute à cette liste l’affirmation extravagante de Donald Trump selon laquelle, s’il remportait à nouveau la présidence, il encouragerait la Russie à « faire tout ce qu’elle voudra » à tout pays de l’OTAN qui n’augmenterait pas son financement militaire selon ses critères ; celle de la menace révélée à point nommé selon laquelle la Russie pourrait mettre une arme nucléaire en orbite, ainsi que la mort suspecte du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, on retient certainement l’attention des consommateurs américains d’informations. Entre-temps, le financement de l’aide militaire américaine à l’Ukraine est devenu un enjeu politique au Congrès, dont les dysfonctionnements, s’ils ne sont pas nouveaux, ont fait la une des journaux.
Ainsi, la guerre en Ukraine a certainement été considérée comme un sujet d’actualité, mais au-delà de cela, il semble qu’il y ait quelque chose à propos de la guerre à laquelle les journalistes ne peuvent pas résister et des angles morts qu’ils ne peuvent pas surmonter.
Le salaire de la peur
La question de savoir si la presse, les grands médias, les médias traditionnels, quel que soit le nom qu’on leur donne, guide ou suit l’opinion publique, fait l’objet d’un vif débat. Les sondages montrent que les Américains se tournent de plus en plus vers les médias sociaux et les podcasts pour s’informer. Seuls 5 % des adultes préfèrent désormais s’informer par le biais de publications imprimées et personne ne semble faire confiance à un média autre que la chaîne météo. Pourtant, qu’on le veuille ou non (et généralement on ne le veut pas), les médias d’information continuent d’influencer ce que nous savons et la manière dont nous pensons les événements mondiaux, car ils définissent les priorités, le langage, le cadre et le spectre de la discussion publique.
Même à une époque où un scoop, où une exclusivité, dure rarement plus de quelques minutes et où les sources d’information du monde entier offrent des reportages et des points de vue alternatifs, ce sont toujours les salles de rédaction d’une poignée de journaux, magazines et chaînes de diffusion et câblées qui génèrent une grande partie des informations que nous consommons sur nos différents appareils et applications. C’est particulièrement vrai pour les questions internationales et encore plus vrai pour les guerres dans lesquelles les États-Unis s’impliquent, aussi lointaines soient-elles.
Ce n’est pas que les journalistes soient particulièrement insensibles ou assoiffés de sang. C’est que la guerre est un bon sujet. Des récits comme celui de l’ancien correspondant de guerre Chris Hedges, War is a Force That Gives Us Meaning (La guerre est une force qui nous donne un sens), témoignent de la séduction qu’elle exerce. Comme il l’écrit : « La guerre est un élixir séduisant. Elle nous donne une résolution, une cause. Elle nous permet d’être nobles. » Ce « nous » comprend les hommes politiques que la guerre incite à s’engager à respecter des principes et les journalistes qui prospèrent en les citant.
« Dans la bataille entre la démocratie et les autocraties, les démocraties s’imposent et le monde choisit clairement le camp de la paix et de la sécurité », a déclaré le président Biden au sujet de la guerre qui commencait en Ukraine dans son discours sur l’état de l’union de 2022. Peu importe que sa version de la paix et de la sécurité soit soutenue par plus de 44 milliards de dollars d’aide militaire au moment où il prononcera son discours sur l’état de l’union en 2023. Bien entendu, le président a alors réaffirmé que l’Amérique défendrait la démocratie lorsqu’elle serait mise à l’épreuve. « Car cette défense nous importe parce qu’elle maintient la paix. » (Je ne comprends pas très bien comment la guerre maintient la paix, mais nous ne sommes sans doute pas censés approfondir ce genre de rhétorique).
Non seulement la démocratie était en danger, nous a-t-on dit, mais également les pays voisins de l’OTAN. En mars 2023, le président ukrainien Zelensky, faisant preuve de son habileté à mobiliser ses alliés, a déclaré : « Si nous disparaissons, alors, Dieu nous en préserve, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie seront les prochaines. » Onze mois plus tard, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, la vice-présidente Kamala Harris a amplifié la menace : « Si nous restons les bras croisés pendant qu’un agresseur envahit son voisin en toute impunité, il continuera à le faire ; et dans le cas de Poutine, cela signifie que toute l’Europe serait menacée. » Et, comme on pouvait s’y attendre, cette rhétorique guerrière nous a rappelé, encore et encore, que l’histoire, ce châtiment implacable, nous regarde.
Les hommes politiques disent ces choses et les journalistes, bien sûr, les rapportent. De plus, le fond de commerce du journalisme n’est pas l’histoire, mais bien l’actualité, nous donnant un instantané éternel d’un présent évanescent. Il n’est donc pas surprenant qu’une situation complexe puisse rapidement être réduite à quelques phrases d’accroche et que, répétées suffisamment souvent, ces phrases deviennent notre seule réalité. (Demandez à Donald Trump comment cela fonctionne, si vous ne me croyez pas.) Ce faisant, il y a une hypothèse sous-jacente et incontestée selon laquelle le chemin vers la sécurité et la paix future passe inéluctablement par la guerre. Et lorsque, selon votre gouvernement et les médias, vous avez la démocratie et l’histoire de votre côté, il est difficile d’imaginer une alternative, telle que la négociation avec l’ennemi, comme n’étant rien d’autre qu’une trahison crapuleuse.
Je ne remets pas en question le fait que la souveraineté de l’Ukraine soit en danger, qu’un pays attaqué a le droit de se défendre ou que le président russe Vladimir Poutine continuera à faire honneur à sa réputation de provocation et de brutalité, éliminant ses opposants par défenestration, par poison ou par d’autres moyens qui restent à révéler. Les commentateurs occidentaux ont déjà été dupés, et Poutine lui-même ne sait peut-être pas ce qu’il va faire ensuite. Toutefois, certaines sources bien informées pensent que, même avec une victoire en Ukraine, il laisserait l’OTAN tranquille, du moins dans un avenir prévisible. Toutefois, il faut se plonger dans la plupart des articles de presse américains récents sur le sujet pour trouver ce type d’argument.
Qui en bénéficie ?
Sur le podcast du New York Times, The Daily, le correspondant diplomatique Steven Erlanger a remarqué, à propos des pays européens qui augmentent actuellement leurs dépenses militaires : « En réalité, il n’y a rien de tel que d’effrayer les gens pour les faire agir. » Et qui profite d’une classe politique et d’une population craintives, partout ? Pourquoi pas les médias ?
Les reportages n’ont pas forcément pour but de nous mettre mal à l’aise, de nous alarmer ni de nous décourager, mais c’est souvent le résultat obtenu. Cette conséquence s’intégre dans notre idée de l’actualité, qui, pour être une actualité, doit être en constante évolution. Si vous vous fermez les yeux, aussi anxiogène que ça puisse être, cela signifie que vous manquerez quelque chose. Ce que vous allez manquer n’est peut-être pas toujours clair, mais les médias sociaux et les technologies qui les accompagnent nous ont appris à avoir soif d’un « contenu » sans fond qui se renouvelle en un clin d’œil.
La peur est rentable non seulement pour les médias, mais aussi, bien sûr, pour les entreprises de défense. Il s’agit peut-être d’un défaut de notre nature ou d’un réflexe instinctif, mais les Américains répondent aux angoisses nationales, réelles ou imaginaires, en s’armant jusqu’aux dents, tant sur le plan personnel que national, et leurs alliés aussi. En 2022, une année normale, notre pays a dépensé plus pour la « défense » que les dix pays suivants réunis et, au cours des deux années qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il a envoyé 46,3 milliards de dollars d’aide militaire à ce seul pays ; sans compter les autres dépenses liées à cette guerre.
Et pourtant, si l’on en croit les médias, ce n’est pas encore assez. Les reportages actuels sur l’Ukraine ne manquent pas de souligner le besoin désespéré de l’armée ukrainienne en armes, équipements et munitions. Un article d’opinion, intitulé « Ce n’est pas le moment d’abandonner l’Ukraine », a même ressuscité le vieux cliché selon lequel les Ukrainiens sont forcés de se battre avec un bras attaché dans le dos. Et en supposant que le Congrès adopte enfin le projet de loi de finances nécessaire, qui doit intervenir pour produire les armes, les équipements et les munitions ? Les géants américains de l’armement du complexe militaro-industriel du Congrès, bien sûr, et s’ils s’enrichissent au passage, c’est la définition d’une bonne affaire, n’est-ce pas ?
Vous serez soulagé d’apprendre qu’il ne s’agit pas d’une affaire à sens unique. L’armée américaine, selon sa propre étude confidentielle effectuée pendant un an, utilise la guerre en Ukraine pour repenser sa stratégie. Et comme on pouvait s’y attendre, cette guerre ne coïncide que trop bien avec les intérêts économiques américains. S’exprimant lors de la 11e réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur les transferts d’armes vers l’Ukraine en décembre dernier, Ann Wright, ancienne colonelle de l’armée, fonctionnaire du département d’État à la retraite et militante pacifiste, a déclaré, en citant le secrétaire d’État Antony Blinken, que 90 % de ce que l’Amérique a investi dans la défense de l’Ukraine a été dépensé aux États-Unis, ce qui est une aubaine pour l’économie américaine. « Il s’agit donc d’un accord gagnant-gagnant que nous devons poursuivre », a-t-il confessé.
« Ce ne sont pas les civils des zones de conflit qui sont les gagnants, a fait remarquer Wright. Le gagnant est le complexe militaro-industriel ainsi que les politiciens et fonctionnaires retraités qui occupent des postes de haut niveau dans l’industrie de l’armement après leur départ à la retraite. »
Mais assez parlé de l’Ukraine, qu’en est-il des États-Unis ?
Et comme par hasard, cette réunion de l’ONU n’a pas été couverte par les médias. Pourquoi parler de la 11e réunion de quoi que ce soit ? Mais la guerre en Ukraine est restée un sujet national majeur avant son anniversaire, en partie à cause de l’impasse du Congrès sur ce programme d’aide supplémentaire et de la façon dont le soutien et l’opposition à ce programme ont eu tendance à se briser sur des lignes de parti de plus en plus féroces et de plus en plus trumpiennes. En conséquence, les médias traitent la situation en Ukraine comme une nouvelle course politique américaine vers un aller-retour en enfer. La Suite ICI
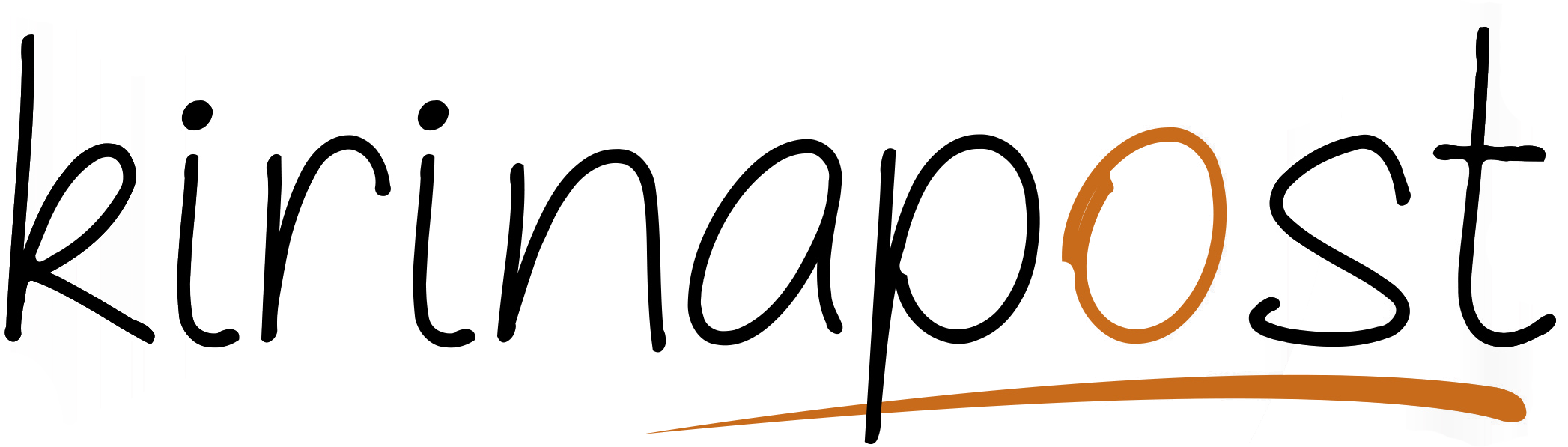










Laisser un commentaire