Mustapha Saha • Paris. Mai 2023. Cinquante-cinquième anniversaire de Mai 68. Autre anniversaire tragique. Le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop, normalien, figure emblématique du film La Chinoise de Jean-Luc Godard, animateur du Mouvement du 22 Mars, agitateur inspiré de Mai 68, est assassiné à l’âge de vingt-six ans par des gardiens de la prison de l’Île de Gorée au Sénégal.
Omar Blondin Diop est aussi un dandy. Par goût de l’élégance. Par finesse rhétorique. J’en témoigne. Débatteur énergique. Argumenteur pédagogue. Parfois chicaneur quand la mauvaise foi de l’interlocuteur le pousse à bout. Il associe, avec ingéniosité, la bienséance et l’excentricité, l’irrévérence et la civilité, l’ascétisme et la festivité, le mutisme et la prolixité. Dans une période de repli sur soi, je l’ai vu s’imposer un régime de dattes et de lait. Je le vanne. Il me dit : « C’est une vieille recette maraboutique. Très efficace ». Les bancs des Lycées Louis Le Grand et Montaigne laissent des empreintes durables. Il affectionne le panachage des teintes sobres et des couleurs vives. Il porte des vestes flamboyantes sur pantalons noirs, des chaussures Weston. Sa passion pour le jazz, le rock, la musique pop, le pop’art, ne doit rien au hasard. Il répète une sentence, pour épater la galerie sans doute. « La beauté se reconnaît dans la concordance de la substance et de l’apparence ». Je ne sais s’il en est l’auteur. Je participe avec Omar Blondin Diop à la manifestation internationale contre la guerre du Vietnam du 28 octobre 1968. Des bobbies à cheval barrent le passage à proximité de l’ambassade américaine. L’équidé fait une embardée et chute à nos pieds. Le service d’ordre étudiant aménage aussitôt un cercle de sécurité pour protéger le policier et sa monture en attendant les secours. Omar Blondin Diop se retourne vers moi : « Ce n’est pas à Dakar ou à Paris qu’on verrait cette scène ». Nous revenons de la capitale anglaise avec des costumes de velours lisse, deux vert et bleu pour lui, un rouge pour moi, dénichés dans une vitrine de Regent Street. Nous testons leur effet à la Coupole. Quelques mois plus tard, nos complets font la mode parisienne.
Après le meurtre d’Omar Blondin Diop, je recherche des témoignages auprès de ses anciens condisciples. J’apprends ses fréquentations des milieux bourgeois. Peut-être un défi contre l’exclusion. Au début des années soixante, il fait partie de la bande du Drugstore sur les Champs Elysées avec, ironie du sort, le fils du président Léopold Sédar Senghor, Guy-Wali Senghor, né en 1948, futur professeur de philosophie, qui se suicide en 1983 en se jetant du cinquième étage de son appartement parisien. La bande du Drugstore est constituée de fils-à-papa, résidant dans les quartiers riches, Seizième, Etoile, La Muette, Chaillot, Porte Dauphine… Des fastueux de quinze à vingt ans. Unique programme de la journée, préparer la soirée. Ils apportent des tissus à un tailleur du Sentier, Marina. Ils sont d’abord surnommés marinettes à cause de cette filiation couturière. Marinette, marin au féminin. Ils portent des cheveux mi-longs. Ils campent pendant des heures dans le drugstore, lisent des magazines en dégustant un banana split. Ils s’attardent sur le trottoir comme des mannequins en démonstration avant de s’inviter dans les surprises parties. Ils manient avec maestria les ficelles de la séduction, l’élégance et l’insolence, l’audace et le charme, la classe et le panache. Le placard du minet rivalise avec le vestiaire d’un milord : vestes cintrées, gilets assortis, chemises Oxford, cravates club, pulls shetlands, gabardines croisées, trench-coats, Levi’s Corduroy, Clarks, Boots Carvil, lunettes Ray Ban, briquets Zippo. Le concept de drugstore, à la fois magasin de disques, pharmacie, parfumerie, kiosque à journaux, brasserie, est importé en 1958 des Etats-Unis par Marcel Bleustein Blanchet, patron de Publicis. Les murs sont tapissés de décors Far West. Les minets jouent aussi du coup de poing, pour une fille, pour un gadget. Lucky Luke se dévore à chaque parution. Cet héritage, Omar Blondin Diop le garde jusqu’au bout.
Style androgyne. Look casual. Les minets dansent le rock, le Be-Bop. Ils écoutent les pionniers du rock’n’roll Chuck Berry et Fats Domino, les Everly Brothers, Elvis Presley. Leur argent de poche ne suffit pas à couvrir leur bar et leur night-club préférés, le Silène et le Mars Club. Quand ils quittent la sauterie, ils pillent les sacs et les tiroirs, vandalisent la maison. Pour payer Renoma, devenu leur couturier attitré, les faux capucins, rejetons sans scrupules d’ambassadeurs, de ministres, de banquiers s’adonnent aux larcins, au trafic de tabac. Sur le juke-box, Jacques Duroc chante : « Je n’ai pas peur des petits minets. Qui mangent leur ronron au Drugstore. Ils travaillent tout comme des castors. Ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds ». Les minets règnent jusqu’en Mai 68. Omar Blondin Diop les entraînent sur les barricades.
Le disquaire importateur Lido Musique existe toujours, comme le drugstore des Champs des Elysées. Les autres drugstores de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Lazare, de l’Opéra ont disparu. L’américano-mania d’après-guerre a vécu. Les mocassins Weston valent aujourd’hui entre 650 et 700 euros. Le séculaire Club Renault, son bar, son restaurant, ses voitures mythiques, n’est qu’une survivance d’un passé révolu. A partir de 1966, la boutique O’Kennedy, rue du Colisée, met en vente, pendant une dizaine d’années, le costume Mao. La tendance chinoise contamine les milieux universaitaires, artistiques, intellectuels. L’austère tenue accroche l’attention par sa simplicité. Elle représente la sobriété prolétarienne. Rusticité du tissu de coton. Austérité de la coupe. Fatuité du message idéologique. L’intention purificatrice est évidente. La haute couture s’en empare. Pierre Cardin et Thierry Mugler effacent la référence marxiste. L‘uniforme bleu indigo devient le symbole du parisian smart, de la récupération mercantile de la contestation soixante-huitarde. La réification dans toute sa splendeur. La révolution se chosifie pour s’écouler comme marchandise. Salvador Dali voit dans la veste mao une esthétique incomparable. Andy Warhol féminise la panoplie. Gilbert Feruch la recycle dans le smoking de mime pour Marcel Marceau. La contrefaçon atteint son comble. S’inaugure une culture mao-pop que le glamour hollywoodien s’empresse de capturer.
En 1967, la radio publique française déclare la maoite comme « une nouvelle mode dont la seule violence est de faire fureur. Un divertissement de jeunes snobs ». Le couturier Charles Glenn révèle la clientèle : « Les plus jolies filles du seizième, beaucoup de vedettes, beaucoup de starlettes, beaucoup de mannequins ». La veste Mao s’arrache à son histoire prolétarienne. Elle devient un habit élitiste, un signe de mazarinade bourgeoise. La Révolution culturelle chinoise est fantasmée comme une révolution spontanéiste, pacifique, libertaire, autogestionnaire. En 1985, le ministre de la Culture Jack Lang s’exhibe en col Mao à l’Assemblée nationale. « Cette veste merveilleuse qui suscita tant de polémiques chez les zélés conservateurs » (Jack Lang). Le costume Mao repose désormais dans musée de la mode.
Simon Leys, démystificateur de la Révolution culturelle, éteint du jour au lendemain l’emballement idolâtre. Beaucoup de petits livres rouges finissent dans les poubelles de Saint-Germain-des-Prés. « La révolution culturelle n’a de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial. Elle n’est qu’une lutte pour le pouvoir, menée au sommet entre une poignée d’individus, derrière le rideau d’un fictif mouvement de masse » (Simon Leys, Les Habits neufs de Mao, éditions Champ Libre, 1971). Quand Omar Blondin campe son rôle de leader maoïste dans le film La Chinoise, en pullover rouge comme il se doit, il reçoit, ainsi que les autres acteurs, une directive quotidienne de Jean-Luc Godard se terminant par une citation de Mao. Il me raconte que le cinéaste, se voyant gratifié d’une avant-première dans la Cité interdite et d’une audience accordée par le président Mao, réfléchit par avance à l’habit qu’il doit porter à cette occasion. L’ambassade chinoise de Paris n’a jamais répondu à ses démarches.
Au moment où je rédige ce passage, j’apprends la mort du plus fervent des écrivains maoïstes, Philippe Sollers. Je ne le voyais plus ces derniers temps à La Closerie des Lilas, où il s’attablait régulièrement avec sa complice, Josiane Savigneau. Philippe Forest, qui lui a consacré une thèse à la Sorbonne, écrit dans le journal Le Monde daté du 6 mai 2023 : « Dans l’euphorie et la confusion qui entourent les événements de Mai-68, Philippe Sollers et ses amis s’enflamment pour la cause exotique et douteuse de la Révolution culturelle. Au printemps 1974, la revue Tel Quel dépêche une délégation au pays de Mao. Sur cet engagement, Philippe Sollers s’est toujours refusé à la franche autocritique. Il explique avoir alors choisi le camp chinois pour mieux rompre avec le néo-stalinisme et par goût d’une civilisation dont tous ses livres témoignent ».
Guillaume Erner est sociologue, journaliste, chroniqueur sur France-Culture. Il est né en février 1968. Il pose sur notre génération le regard d’une classe d’âge qui n’a pas vécu Mai 68, mais qui la juge sans concessions. Je me rassure d’être resté du même côté de la barricade. Je repense aux dérives des camarades, certains morts, d’autres survivants, taraudés par la mauvaise conscience ou lénifiés par l’indifférence, révolutionnaires un jour, bourgeois toujours, qui ont servi avec enthousiasme et talent le pouvoir établi après l’avoir voué aux géhennes.
L’appréciation de Guillaume Erner vaut la peine d’être citée en entier. Le regard éclairé d’une descendance intellectuelle sur un lignage consacré peut revêtir valeur bilancielle. « Aucun être ne se résume, y compris au seuil sévère du tombeau. Philippe Sollers était charmant, séducteur, virevoltant, paradoxal, inattendu. Il était, tout à la fois, patron de revue d’avant-garde, Tel Quel, intellectuel d’avant-garde, disons structuro-maoïste, romancier d’avant-garde, dans Paradis notamment, composé d’une seule phrase, sans paragraphes ni ponctuation. Philippe Sollers épousait le destin des avant-gardes. Il n’est pas facile d’être d’avant-garde, d’incarner pour toute une génération le renouveau intellectuel, ses codes et ses tocades. Et Philippe Sollers les avait toutes épousées, Mao en chef. Il n’hésitait pas à déclarer : « Les œuvres du grand timonier sont un bond en avant considérable et complètement original ». Comment peut-on être maoïste? se demandent les jeunes aujourd’hui. Ils sont toujours cruels, les jeunes. Ils ne voient que les travers des aînés, les jeunes. Ils ne voient que les erreurs des vieux, les jeunes. Mais, quand on lui rappelait ses égarements de jeunesse, Philippe Sollers n’était nullement embarrassé. Il renvoyait jeunes et vieux dos à dos : « Serge July a-t-il eu raison de quitter Mao pour Rothschild ? Pour toute une génération fiévreuse, la sortie du délire Mao était problématique. Peu d’individus sont revenus à la bonne vieille maison de gauche. Certains ont cru se délivrer en allant de Mao à Moïse (Benny Lévy, sic). D’autres de Mao à Bush. Je crois être le seul à avoir basculé de Mao au Pape ». De Mao au Pape, la destinée des avant-gardes est de devenir arrière-gardes. Pierre Bourdieu, dans un texte de 1995 : « Philippe Sollers s’est cru libre, mais il a toujours flotté comme limaille au gré des forces du champ pour accomplir un double demi-tour, une double demi-révolution ». Nous avons enterré Pierre Bourdieu. Nous enterrons Philippe Sollers. Une avant-garde, puis l’autre. C’est peut-être cela que nous perdons avec eux, la notion même d’avant-garde » (Guillaume Erner, France Culture, 8 mai 2023).
Décidément. Les pertes se succèdent et se ressemblent. Ce mardi 9 mai 2023, l’avocat Georges Kiejman, ténor du barreau, défenseur des opprimés, disparaît à l’âge de quatre-vingt-dix ans. En 1973, apprenant la mort d’Omar Blondin Diop, Georges Kiejman publie une réaction à chaud dans Le Nouvel Observateur sous le titre Mort d’un militant africain, d’une justesse implacable. « Omar Blondin Diop meurt dans un cul-de-basse-fosse de la prison, au large de Dakar. Il se serait « suicidé » dans sa cellule. On n’a guère plus d’imagination au Sénégal que partout ailleurs dans le monde. Partout où les tenants du pouvoir croient qu’un jeune homme porteur de vérité les gênera moins mort que vivant. Omar Blondin Diop, beaucoup d’étudiants parisiens le connaissaient. Il a été animateur du Mouvement du 22 Mars. Beaucoup d’autres le connaissaient qui ne le savaient pas. Dans le film de Jean-Luc Godard, La Chinoise, le jeune noir qui tenait un discours enflammé, c’était lui. Etudiant des plus brillants, élève de l’Ecole Normale de Saint-Cloud, il s’est vu notifier par notre gouvernement un arrêté d’expulsion. Parti de France contre son gré, il est retourné volontairement au Sénégal où l’air, si favorable aux touristes, lui paraissait irrespirable. Le régime ne demandait qu’à l’intégrer. N’était-il pas un remarquable sujet formé par la culture française ? Omar Blondin Diop pensait qu’il y avait mieux à faire que singer les meurs de la bourgeoisie française en continuant à partager avec elle les profits du néocolonialisme. De passage au Sénégal, il n’y a à peine plus d’un mois, je ne me suis guère alarmé lorsque le ministre de l‘Intérieur, malgré mon instance quotidienne, laissa sans réponse ma demande de visiter Omar Blondin Diop, mis au secret, que sa famille n’avait pas vu depuis plusieurs semaines. J’avais tort. Tous les régimes qui bâillonnent une jeunesse dont la seule arme est la parole doivent être dénoncés. Sans nos excès de pudeur, Omar Blondin Diop ne serait peut-être pas mort, à vingt six ans, dans cette Île de Gorée où ses ancêtres faisaient leur première halte vers l’esclavage » (Georges Kiejman).
Rentrée d’octobre 1968 à Nanterre. Discussions informelles avec René Lourau, Georges Lapassade, François Lyotard, Félix Guattari sur la sociologie d’intervention, la psychopathologie sociale, l’analyse institutionnelle, la recherche-action, le sociodrame, les vertus de la transe, des danses de possession. Je parle des gnaouas marocains. Je prépare plus tard une thèse avec Henri Lefebvre, Psychopathologie sociale en milieu urbain désintégré. Contradictions insurmontables entre pratique et théorie que seules les cultures orales surmontent. Le problème, l’écriture, sarcophage de la pensée. Fascination des vivants, obsédés par leur mortalité, pour les alphabets figés, les significations gisantes sur papier. « La praxis n’est pas la pratique. La praxis est l’investissement dialectique de la théorie dans la pratique et de la pratique dans la théorie, des mots dans l’action et des actions dans les mots » dit Omar Blondin Diop.
Malgré son courage physique, Omar Blondin Diop n’aime pas voir le sang couler. Il se promène avec une trousse de secours pour porter les premiers soins à un éventuel camarade blessé. Il est contre l’amateurisme mercenaire. Je me souviens de ses tirades pendant les réunions clandestines dans l’église protestante de la rue d’Alesia contre des apprentis révolutionnaires qui s’imaginent des guérilleros. Il est vigilant vis-à-vis des katangais, qui se portent volontaires pour assurer le service d’ordre. Ils ornent un local que nous leur octroyons d’un poster de Fidel Castro. Nous finissons par les expulser de la Sorbonne. Ils se réfugient dans le théâtre de l’Odéon occupé.
Omar Blondin Diop se vit, avant tout, comme un penseur, un artiste, stimulé par la nécessité révolutionnaire, il dirait par l’impératif historique. Il passe son temps à prendre des notes. Nous fréquentons beaucoup les cinémas d’art et d’essai et les terrasses de Saint-Germain-des-Prés. Il n’y a pas de temps mort. Nous prenons part aux palabres de rue. La rue devenue par bonheur un forum où des inconnus s’abordent et sympathisent. Nous faisons le bilan des événements au fur et à mesure. Nous recensons les réussites, les erreurs, les échos médiatiques. Nous établissons des parallèles avec d’autres pays. Les films, les livres soulèvent nos commentaires, nos interprétations, nos confrontations. Nous affectionnions les westerns hollywoodiens et les westerns-spaghettis. Références incontournables, les films de Sergio Léone, les musiques lancinantes d’Ennio Morricone. Des antihéros crasseux, graveleux, dévergondés. Des femmes, souvent des prostituées, buveuses de whisky, fumeuses de havanes, bagarreuses. Des personnages finalement plus humains, plus proches. Esthétique parabolique, paysages panoramiques, travellings avant, travellings arrière, contre-plongées, gros plans, flashbacks, rythmes lents, intenses. Nous transposons allégrement les trames narratives dans des situations révolutionnaires.
1967-1968, millésimes formidables, Dieu pardonne, moi pas avec Terrence Hill de Giuseppe Colizzi avec Terrence Hill. Le Dernier Jour de la colère de Tonino Valerii avec Lee Van Cleef. Le Dernier Face à face de Sergio Sollima avec Gian Maria Volontè. Le temps des vautours de Romolo Guerrieri avec Gianni Garko. Des réalisateurs déjantés. Des acteurs mythiques. Le Grand silence de Sergio Corbucci, avec le tandem invraisemblable Jean-Louis Trintignant-Klaus Kinski, tourné dans les neiges profondes. L’histoire se déroule dans les montagnes de l’Utah. Des paysans, des bûcherons deviennent hors la loi pour survivre. Des chasseurs de primes sont enrôlés pour les abattre comme des bêtes sauvages. Pauline, dont le mari a été tué, engage Silence, un pistolero muet pour le venger. Des images haletantes du début à la fin. Des salles programment le même long métrage pendant plusieurs mois. Nous allons voir certains films plusieurs fois. 1966–1968, c’est aussi Blow-Up de Michelangelo Antonioni. Bernardo Bertolucci tourne Partner avec mon ami Pierre Clémenti et Stefania Sandrelli, adaptation du roman Le Double de Fiodor Dostoïevski. Pierre Clémenti fait des allers-retours Rome-Paris pour filmer les barricades et les volcans sous les pavés, comme il dit. Le slogan le plus célèbre de Mai 68 est sans nul doute Sous les pavés, la plage. Je garde en mémoire des films projetés à la Faculté de Nanterre, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, La Dolce vita, Huit et demi de Federico Fellini, L’aventura, L’Eclipse de Michelangelo Antonioni, Rocco et ses frères de Luchino Visconti, Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, l’Evangile selon Saint-Matthieu de Pier Paolo Pasolini, Le Dieu noir et le diable blond de Glauber Rocha, Viridiana, l’Ange exterminateur de Luis Bunuel. J’en oublie. Des films vus et revus, comme des poèmes insatiablement revisités.
Nous nous promenons en permanence avec des livres sous le bras. Les Mots de Jean-Paul Sartre. La Part maudite de Georges Bataille. Aden Arabie et Les Chiens de garde de Paul Nizan. Les Damnés de la terre de Franz Fanon. Omar Blondin Diop ponctue ses paroles de citations connues par cœur. Des lectures philosophiques. L’Âne de Lucien de Samosate. L’Eloge de la folie et L’Essai sur le libre arbitre d’Erasme de Rotterdam. La Désobéissance civile d’Henry David Thoreau. Société et solitude de Ralph Waldo Emerson. Le Droit à la paresse de Paul Lafargue.
Je maintiens qu’Omar Blondin Diop est un libertaire pur et dur, un anarchiste héritier spirituel des communards, un incurable insurgé. Il lit Jules Vallès avec enchantement. Il ne se voit jamais en homme de pouvoir. Il ne serait jamais devenu président de la République. Il n’aurait pas supporté le costume. Nous revenons sans cesse aux fondamentaux, La Phénoménologie de l’esprit de Hegel. Critique de la raison pratique d’Emmanuel Kant. L’Ethique de Baruch Spinoza. Omar Blondin Diop me parle de son projet de thèse sur Baruch Spinoza avec Jean-François Lyotard. La philosophe Corinne Enaudeau, fille de Jean-François Lyotard, pourrait peut-être retrouver des manuscrits d’Omar Blondin Diop dans les archives de son père. Nous annotons les Manuscrits de 1844, la Critique du programme de Gotha de Karl Marx quand il est théoricien du dépérissement de l’Etat et de la démocratie directe. « Chacun selon ses capacités, chacun selon ses besoins ». Il fallait entendre Omar Blondin Diop commenter Philosophie de la misère de Proudhon et Misère de la philosophie de Marx. Une rupture aux conséquences historiques irréparables. Influences décisives d’ouvrages quasiment oubliés, Marx penseur de la technique de Kostas Axelos, Histoire et conscience de classe de Georg Lukacs, Marxisme et philosophie de Karl Korsch. Une autre pensée marxiste émerge dans nos têtes, épurée des corruptions léninistes, éclairée des concepts d’aliénation, de réification. Karl Marx toujours : « Est prolétaire l’homme qui n’a aucun pouvoir sur sa vie ». Je critique le slogan « l’imagination au pouvoir », l’imagination est antithétique de tous les pouvoirs. Omar Blondin Diop m’approuve. Nous démontons tous les deux le concept surévalué de Négritude, qui relève de l’autoculpabilisation rédemptrice. Deux ouvertures émancipatrices. Eros et civilisation, « seule la poésie, l’imagination dans la société industrielle, incarnent encore un refus total » et L’Homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse, traduit en pleine effervescence soixante-huitarde. Herbert Marcuse dévoile la complicité objective entre le libéralisme et le soviétisme, tous deux actionnés par une bureaucratie étatique au service du capitalisme ou de l’oligarchisme. Racisme et puritanisme d’un côté, endoctrinement et terreur idéologique de l’autre côté, répression féroce de l’insubordination dans les deux cas. L’uniformisation des pensées, la standardisation des comportements excluent l’esprit critique. Nous remplaçons notion simpliste de synthèse par le concept plus ample de constellation. De nouvelles visions du monde, de la vie, de la nature éclosent. Le principe de réalité n’est que le refoulement entretenu par la soumission. Consentement. Frustration consommée. Le Discours de la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie, opus du seizième siècle, nous parait d’une époustouflante pertinence, d’une terrible actualité.
A la Faculté de Nanterre, nous créons un club de poésie, qui se révèle d’une réelle utilité dans l’invention des slogans soixante-huitards. « Le transformer le monde » marxien et « le changer la vie » rimbaldien ne sont qu’une seule et même chose. J’écris sur un mur de la Faculté : « Connais l’autre pour te connaître ». Dans La Chinoise, Omar Blondin Diop préconise « de reconnaître ceux qui ont existé et existent en dehors de nous et, voyant ce dehors, de commencer de nous voir nous-mêmes du dehors ». Dépassement du « Connais-toi toi-même » socratique, du « Tu deviens ce que tu es » nietzschéen. Deux livres situationnistes, emblématiques, nous accompagnent au tournant de juin 1968, quand la flamme qui nous a enfiévrés n’est plus que braise expirante, Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem et La Société du spectacle de Guy Debord. Je pense, avec le temps, qu’Omar Blondin Diop aurait surpassé le situationnisme en le purgeant de son agressivité maladive, en le mettant à l’épreuve de praxis diversitaires.
En 1967, Henri Lefebvre donne un cours magistral sur Sexualité et société, suivi l’année suivante d’une critique de La Société bureaucratique de consommation dirigée. Deux livres de référence du médecin et psychiatre autrichien Wilhelm Reich, La Révolution sexuelle et La Fonction de l’Orgasme. Le 21 mars 1968, nous organisons dans la Cité universitaire de Nanterre une conférence sur Wilhelm Reich. Nous diffusons sous forme de tract un manisfeste inspiré par le penseur freudo-marxiste. «Qu’est-ce que le chaos sexuel ? C’est exciter les jeunes par des films érotiques, en retirer des bénéfices, mais leur refuser l’amour naturel et la satisfaction sexuelle en faisant appel, par-dessus le marché, à la culture. Qu’est-ce que le contraire du chaos sexuel ? C’est de ne pas faire l’amour sous des portes cochères comme les jeunes dans notre société, mais le faire dans des chambres propres et sans être dérangés ». Le lendemain, vingt-neuf étudiants, dont je suis, sont expulsés de la Cité universitaire. Peu importe. Nous trouvons accueil dans les chambres des filles. Le doyen Jean Grappin nous traite d’envahisseurs. Des graffitis lui répondent : « Prenez vos désirs pour la réalité » « Jouissez sans entraves ». La police est requise pour nous déloger. Nous récidivons le lendemain. Jusque-là, les portes des bâtiments de filles sont verrouillées et électrifiées à partir 21 heures, et toujours interdites aux garçons. Pierre Viansson-Ponté publie, dans le journal Le Monde du 15 mars 1968, un article titré « Quand la France s’ennuie…» : « Les Français s’ennuient. Ils ne participent ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. La guerre du Vietnam les émeut, certes, mais elle ne les touche pas vraiment. Les guérillas d’Amérique latine et l’effervescence cubaine ont été, un temps, à la mode. Elles ne sont plus guère qu’un sujet de travaux pratiques pour sociologues de gauche et l’objet de motions pour intellectuels. Cinq cent mille morts peut-être en Indonésie, cinquante mille tués au Biafra, un coup d’Etat en Grèce, les expulsions du Kenya, l’apartheid sud-africain, les tensions en Inde, ce n’est guère que la monnaie quotidienne de l’information. La crise des partis communistes et la révolution culturelle chinoise semblent équilibrer le malaise noir aux Etats-Unis. De toute façon, ce sont leurs affaires, pas les nôtres. Rien de tout cela ne nous atteint directement. D’ailleurs la télévision nous répète au moins trois fois chaque soir que la France est en paix pour la première fois depuis bientôt trente ans et qu’elle n’est ni impliquée ni concernée nulle part dans le monde. La jeunesse s’ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Egypte, en Allemagne, en Pologne même. Ils ont l’impression qu’ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de l’absurde à opposer à l’absurdité. Les étudiants français se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de l’homme ». L’honorable quotidien Le Monde ne voit dans la révolte nanterroise qu’une broutille estudiantine. La presse institutionnelle, à deux semaines de l’embrasement des villes, ne voit rien venir, ni Mai 68, ni son extension planétaire. La jeunesse n’est pas encore perçue comme une classe dangereuse. Quand le ministre de la jeunesse et des sports, François Missoffe, inaugurant la piscine du campus nanterrois le 8 janvier 1968, est interpellé sur la misère sexuelle des étudiants, il répond : « Si vous avez un problème sexuel, faites un plongeon dans l’eau ». Nous avons un siècle d’avance. Nous sommes nourris de la contre-culture américaine, du summer of love californien. Nous sommes épanouis envers et contre la pudibonderie gouvernante.
Mustapha Saha : Sociologue, écrivain, artiste peintre
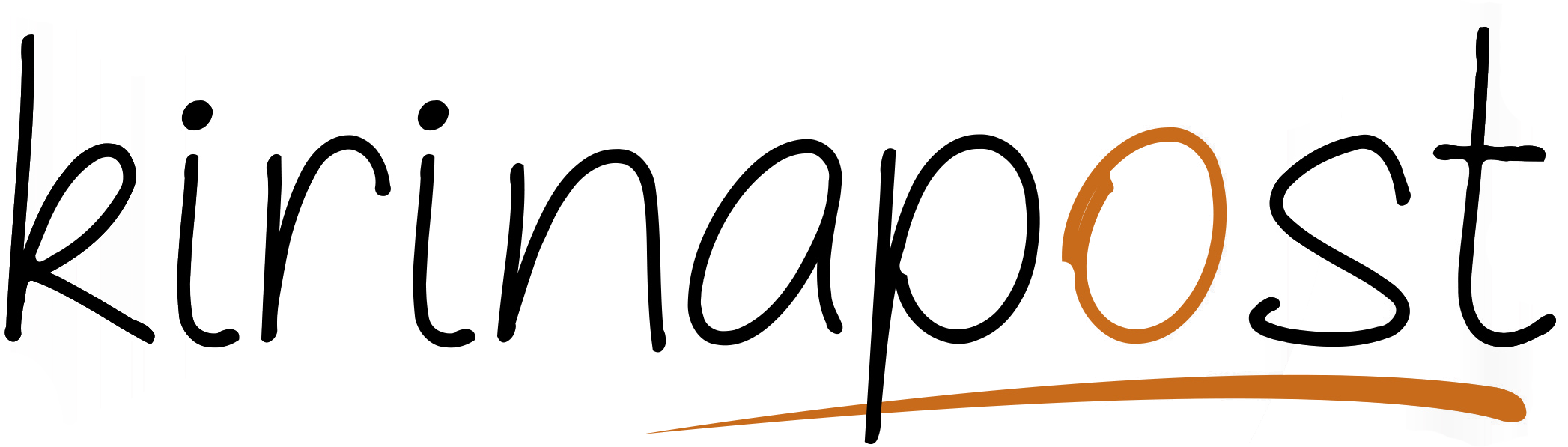






![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-120x120.jpg)



Laisser un commentaire