Aujourd’hui, les géants d’Internet détiennent le pouvoir sur l’information, celle que l’on partage et celle qui nous concerne. Or ce “capitalisme de surveillance” menace la démocratie, avertit Shoshana Zuboff. Pour cette docteure en psychologie sociale, il est urgent de bâtir une civilisation de l’information véritablement démocratique. Source: swissneutral
Il y a vingt ans de cela, le gouvernement américain a ouvert grand les portes de la démocratie à de jeunes entreprises du web, allant jusqu’à y allumer une petite flambée en signe de bienvenue. Dans les années qui ont suivi, une société de la surveillance s’y est développée, une vision qui répondait aux besoins distincts mais mutuels des agences de renseignements et des acteurs privés du web, les unes comme les autres caressant le rêve d’une veille informationnelle généralisée.
Vingt ans plus tard, les flammes se sont propagées hors de l’écran, menaçant de réduire en cendres, le 6 janvier dernier, le siège même de la démocratie.
J’ai passé très exactement quarante-deux ans de ma vie à étudier la montée en puissance du numérique, c’est-à-dire le moteur économique de notre transition vers une civilisation de l’information. Ces vingt dernières années, j’ai pu observer les répercussions de ce drôle de mariage entre l’économie et la politique, j’ai vu de jeunes entreprises se métamorphoser en empires de la surveillance reposant sur des dispositifs internationaux d’analyse, de ciblage et de prédiction de nos comportements, que j’ai englobés sous le nom de “capitalisme de surveillance”.
Afin d’optimiser les profits qu’ils en tirent, ces nouveaux empires se sont servis de leurs outils de surveillance pour fomenter un coup d’État épistémologique totalement contraire à la démocratie qui se caractérise par une concentration sans précédent de données nous concernant, laquelle leur confère un pouvoir pour lequel ils n’ont à rendre aucun compte.
Le contrôle non légitime de l’information
Dans une civilisation de l’information, les sociétés se définissent par la question de la connaissance – comment se répartit-elle, quelle est l’autorité qui régit cette répartition, quel pouvoir protège cette autorité. Qui a la connaissance ? Qui décide qui l’a ? Et qui décide qui décide qui l’a ?
Ce sont les acteurs du capitalisme de surveillance qui détiennent aujourd’hui la réponse à chacune de ces questions, alors qu’ils n’ont jamais été portés au pouvoir. C’est l’essence même de ce coup d’État épistémologique. Ils revendiquent l’autorité de décider qui possède la connaissance en faisant valoir des droits de propriété sur nos informations personnelles et défendent cette autorité grâce à leur maîtrise de réseaux et d’infrastructures d’information devenus incontournables.
La tentative de coup d’État politique de Donald Trump s’inscrit dans le sillage de ce coup d’État qui ne dit pas son nom, fomenté depuis vingt ans par des réseaux “antisociaux” que nous avions pris un temps pour des outils de libération.
Le jour de son investiture, Joe Biden a déclaré que “la démocratie [avait] triomphé” et a promis de redonner sa juste place à la vérité dans la société démocratique. Mais aussi longtemps que nous n’aurons pas déjoué l’autre coup d’État, celui du capitalisme de surveillance, la démocratie et la vérité se trouveront toujours sous une épée de Damoclès.
La vie privée, une matière première gratuite
Le putsch épistémologique se décompose en quatre étapes.
La première est la mainmise sur les droits épistémologiques, dont découlera tout le reste. Le capitalisme de surveillance part d’un constat : une entreprise peut accaparer la vie des gens et la considérer comme une matière première gratuite dont elle extraira des données comportementales qu’elle déclarera ensuite comme sa propriété.
La deuxième étape est un creusement de l’écart épistémologique, c’est-à-dire la différence entre ce que je peux savoir et ce que l’on peut savoir de moi.
La troisième étape, celle que nous sommes en train de vivre, voit les prémices d’un chaos épistémologique provoqué par la montée en puissance des algorithmes, la dissémination d’informations mensongères et le microciblage, lesquels s’inscrivent généralement dans des stratégies de désinformation à des fins commerciales. Ses effets se font sentir dans le monde réel, où elle fractionne notre réalité collective, empoisonne le débat public, paralyse la démocratie et se solde parfois par des violences ou par des morts.
Dans la quatrième étape, la domination épistémologique est institutionnalisée et la gouvernance démocratique reléguée derrière la cybergouvernance du capitalisme de surveillance. La machine sait et le système décide, piloté et protégé par l’autorité illégitime et le pouvoir antidémocratique du capitalisme de surveillance. Chaque étape prend pour point d’appui la précédente. Le chaos épistémologique ouvre la voie à une domination épistémologique en affaiblissant la société démocratique – ce qui a sauté aux yeux lors de l’invasion du Capitole.
Définir l’ordre social de ce siècle
Nous sommes au siècle du numérique et assistons aux débuts de la civilisation de l’information. Une époque que l’on pourrait comparer aux balbutiements de l’ère industrielle, quand les patrons avaient le pouvoir et que leurs droits de propriété l’emportaient sur toute autre considération.
L’insoutenable vérité sur la situation actuelle, c’est que les États-Unis et la plupart des autres démocraties libérales ont abandonné la propriété et l’exploitation des données numériques aux acteurs du capitalisme de surveillance, qui, mus par des intérêts politico-économiques, concurrencent désormais la démocratie sur la question des droits et des principes fondamentaux qui définiront l’ordre social de ce siècle.
Cette année de pandémie et d’autocratie trumpienne a démultiplié les effets de ce putsch épistémologique, mettant au jour, bien avant le 6 janvier, le pouvoir dévastateur des réseaux “antisociaux”. La conscience grandissante de cet autre coup d’État et de la menace qu’il fait planer sur les sociétés démocratiques nous ouvrira-t-elle les yeux sur une vérité dérangeante qui se dessine depuis vingt ans ?
Car, entre la démocratie et la société de la surveillance, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Une société de la surveillance démocratique est une impossibilité existentielle et politique. Ne nous y trompons pas : c’est bien pour l’âme de notre civilisation de l’information que nous nous battons.
La tragédie nationale du 11 Septembre a totalement changé l’ordre des priorités à Washington : exit les débats autour des lois fédérales sur la confidentialité des données, place à la lubie de la veille informationnelle généralisée, qui se traduit par un intérêt décuplé pour les dernières solutions de surveillance de la Silicon Valley.
Main basse sur les données
En 2013, le directeur de la technologie à la CIA avait exposé la mission de l’agence, à savoir “tout récupérer et tout conserver sans limite de temps”, remerciant au passage les géants du web – dont Google, Facebook, YouTube, Twitter – ainsi que Fitbit [fabricant de montres connectées] et les opérateurs télécoms de la rendre possible.
Les racines révolutionnaires du capitalisme de surveillance naissent de cette doctrine politique implicite de l’exception numérique en matière de surveillance qui lui permet de contourner le contrôle démocratique et autorise, in fine, les nouveaux géants du web à voler la vie des internautes et à la transformer en données propriétaires.
C’est ainsi que de jeunes entrepreneurs sans aucun mandat démocratique ont fait main basse sur une manne de données et sur le pouvoir qui va avec, sans avoir à rendre de comptes. Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, exerçaient un contrôle absolu sur la production, l’organisation et la présentation de l’information mondiale.
Chez Facebook, Mark Zuckerberg avait la haute main sur ce qui allait devenir l’un des principaux moyens de communication et de production de contenus d’actualités du globe. Le nombre d’utilisateurs a augmenté à travers le monde sans que la plupart n’aient conscience de ce qui venait de se produire.
La surveillance comme principe de gouvernance
C’est grâce à ce statut d’exception que les États-Unis et beaucoup d’autres démocraties libérales ont pu ériger la surveillance, plutôt que la démocratie, en principe directeur de leur ordre social. Ce faisant, ces gouvernements démocratiques ont sérieusement plombé leur cote de confiance auprès de l’opinion, accroissant ainsi le besoin de surveillance.
Pour bien comprendre la dimension économique du chaos épistémologique ambiant, il convient de rappeler que le capitalisme de surveillance ne se préoccupe pas des faits. Toutes les données sont jugées équivalentes, alors que toutes ne se valent pas. On les exploite à la manière des Cyclopes, qui avalent tout ce qui bouge en ne faisant aucun cas du sens, des faits ou de la vérité.
Dans le cas de Facebook, le tri des données est effectué soit pour réduire le risque d’un départ de l’utilisateur, soit pour éviter des sanctions politiques. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif reste d’augmenter le flux de données, et non de le réduire. L’impératif extractiviste se conjugue ici à une indifférence totale pour donner naissance à un système qui augmente l’activité globale sur le réseau en continu sans se soucier de la nature de ces interactions.
Si je me focalise ainsi sur Facebook, ce n’est pas parce que ce serait le seul responsable de ce chaos épistémologique, mais parce qu’il s’agit du plus vaste réseau social, et que, à ce titre, il est celui dont les activités ont le plus de répercussions.
Le modèle économique du capitalisme de surveillance a engendré des Cyclopes extractivistes et fait de Facebook un géant de la publicité et un fossoyeur de la vérité. Entre-temps, les États-Unis ont hérité d’un président amoral en la personne de Donald Trump, qui revendiquait le droit de mentir à tout bout de champ. Conjugué à une politique d’apaisement, ce modèle économique dévastateur a aggravé considérablement la situation.
Des études internes présentées en 2016 et 2017 ont ainsi démontré un lien de cause à effet entre les méthodes de ciblage algorithmique de Facebook et le chaos épistémologique ambiant. Une chercheuse révèle que les algorithmes sont responsables de la propagation virale des contenus clivants qui ont contribué à faire monter des groupes d’extrême droite en Allemagne : les outils de recommandation étaient responsables de 64 % des ralliements à des groupes extrémistes, un phénomène qui n’est pas propre à l’Allemagne.
En mars 2018, l’affaire Cambridge Analytica a présenté Facebook sous un jour nouveau et ouvert une fenêtre à un vrai changement. Le grand public a commencé à comprendre que la publicité politique sur Facebook se servait des différents outils du réseau social pour microcibler les internautes, les manipuler et semer le chaos épistémologique. Quelques réglages avaient suffi pour que la machine poursuive des objectifs non plus commerciaux mais politiques.
Le groupe a consenti quelques efforts timides, promettant davantage de transparence, un dispositif de vérification externe de l’information plus performant et des mesures de limitation des “comportements trompeurs organisés”, ce qui n’a pas empêché Mark Zuckerberg de laisser à Donald Trump un accès illimité à la Toile de l’information mondiale.
Une liste blanche regroupe ainsi plus de 100 000 responsables politiques et candidats dont les comptes sont exemptés de fact-checking, malgré des études internes montrant que les internautes ont tendance à prendre pour argent comptant les fausses informations relayées par les politiques. En septembre 2019, le groupe a fait savoir que la publicité politique ne serait soumise à aucune vérification des informations publiées.
On voudrait nous faire croire que les répercussions négatives de ce chaos épistémologique sont le prix à payer pour jouir de notre sacro-saint droit à la liberté d’expression. Mais c’est faux. De la même manière que les taux alarmants de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont la conséquence de notre consommation de combustibles fossiles, le chaos épistémologique est la conséquence des opérations commerciales du capitalisme de surveillance, rendu possible par un rêve vieux de vingt ans, celui d’une veille informationnelle généralisée, qui a tourné au cauchemar.
Une épidémie de fausses informations
C’était avant qu’une pandémie ne frappe l’Amérique et que l’incendie qui consumait le réseau “antisocial” ne gagne le reste de la société. Dès février 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait état d’une “infodémie” sur le Covid-19, caractérisée par le colportage de rumeurs et d’idées reçues sur les réseaux sociaux.
En mars, des chercheurs du centre de recherche sur le cancer M. D. Anderson de l’université du Texas constataient que la désinformation sur le coronavirus “se propageait à une vitesse alarmante sur les réseaux sociaux”, faisant peser une menace sur la sécurité publique.
Fin mars [2020], le Washington Post rapportait que près de 50 % des contenus publiés sur les fils d’actualité Facebook étaient liés au Covid-19 et qu’une toute petite poignée d’utilisateurs influents déterminait les lectures et les fils d’actualité de la majorité des autres.
Une étude publiée en avril par l’institut Reuters confirmait que, sur l’échantillon examiné, les grands responsables politiques, les célébrités et les autres figures de la vie publique étaient responsables de 20 % des informations erronées publiées sur les réseaux sociaux et de 69 % des interactions.
La puissance incontrôlée des algorithmes
Une étude [de l’ONG] Avaaz publiée en août a mis en évidence 82 sites web diffusant de fausses informations sur le Covid, totalisant près d’un demi-milliard de vues sur Facebook en avril. Les contenus des dix sites les plus consultés représentaient près de 300 millions de vues sur le réseau social, contre 70 millions seulement pour les dix principales agences de santé.
Les timides efforts de modération des contenus entrepris par Facebook ne faisaient pas le poids face à ses propres algorithmes, conçus pour semer le chaos épistémologique.
Tel est le monde dans lequel un mystérieux germe mortel s’est propagé. Nous sommes allés sur Facebook en quête d’informations, et tout ce que nous y avons trouvé, ce sont des stratégies mortifères visant à semer un chaos épistémologique pour faire de l’argent.
En 1966, Peter Berger et Thomas Luckmann ont écrit un petit ouvrage qui a fait date, La Construction sociale de la réalité, dont l’observation centrale est que nous fabriquons de toutes pièces, de manière active et constante, la vie de tous les jours que nous prenons pour la réalité. Le miracle permanent qu’est l’ordre social repose sur la connaissance du sens commun, à savoir la connaissance que je partage avec d’autres en temps normal, la routine allant de soi du quotidien.
Songez à la route : il n’y a pas assez de policiers dans le monde pour veiller à ce que chaque voiture s’arrête à chaque feu rouge. Or, on ne voit pas de négociations ni d’altercations à tous les carrefours. C’est parce que, dans les sociétés bien ordonnées, tout un chacun sait que les feux rouges ont le pouvoir de nous faire nous arrêter et les feux verts celui de nous faire passer.
Le sens commun, ça veut dire que nous agissons tous en fonction de ce que nous savons tous, tout en faisant confiance aux autres pour faire de même. Nous ne nous contentons pas d’obéir à des lois ; nous créons cet ordre ensemble. Notre rétribution étant de vivre dans un monde où nous arrivons généralement à bon port sains et saufs parce que nous faisons confiance au sens commun des autres. Aucune société n’est viable autrement.
Un terrorisme épistémologique
“Toutes les sociétés sont des constructions face au chaos”, écrivent Berger et Luckmann. Parce que les normes sont des synthèses de notre sens commun, leur violation constitue l’essence même du terrorisme – qui est terrifiant parce qu’il désavoue les certitudes sociales les plus ancrées. La légitimité et la continuité de nos institutions sont essentielles parce qu’elles nous mettent à l’abri du chaos en officialisant notre sens commun.
La mort des rois et la transmission pacifique du pouvoir sont, en démocratie, des périodes charnières qui accentuent la vulnérabilité de la société. Les normes et les lois qui régissent ces tournants sont traitées à juste titre avec une grande gravité.
Cherchant à dénoncer une fraude électorale, Donald Trump et ses alliés ont lancé une campagne de désinformation qui s’est finalement soldée par des violences. Elle visait ici directement le point de vulnérabilité institutionnelle maximale de la démocratie américaine et de ses normes les plus élémentaires.
À ce titre, c’était une forme de terrorisme épistémologique, l’expression paroxystique du chaos épistémologique. En mettant délibérément sa machine économique à disposition de cette cause, Mark Zuckerberg s’est rendu complice de cette attaque.
La société se renouvelle à mesure que le sens commun évolue. Il faut pour ce faire des espaces de débat public qui soient dignes de confiance, transparents et respectueux, surtout sur les sujets sensibles. Au lieu de quoi, nous avons affaire à l’inverse.
Les dirigeants des réseaux sociaux défendent leurs machines à semer le chaos en brandissant une version déformée du premier amendement. Or, le réseau social n’est pas un espace public mais un espace privé, régi par des machines et des impératifs économiques et incapable (et ne se préoccupant pas non plus) de distinguer le mensonge de la vérité ou le renouveau de la destruction.
Pas de vision politique cohérente
Cette vulnérabilité à la destruction du sens commun s’explique par le jeune âge d’une civilisation de l’information qui n’a pas encore trouvé sa place dans la démocratie. À moins de mettre un terme à ce modèle économique fondé sur la surveillance et de retirer le permis de voler qui légitime des activités antisociales, l’autre coup d’État continuera d’attiser les crises et d’en produire de nouvelles.
Mais alors, que faire ? À ce jour, ni les États-Unis ni les autres démocraties libérales ne sont parvenus à dessiner une vision politique cohérente d’un siècle numérique qui défendrait les valeurs, les principes et la gouvernance démocratiques. Pendant que les Chinois concevaient et déployaient des technologies numériques dans le but d’asseoir leur régime autoritaire, l’Ouest restait dans l’ambivalence et le compromis.
Ces atermoiements ont laissé un vide à l’emplacement de la démocratie, avec à la clé vingt années de dérive vers des outils privés qui surveillent et influencent nos comportements en dehors du cadre établi par la gouvernance démocratique. Ce qui ouvre la voie à la dernière étape du putsch épistémologique.
Le résultat, c’est que nos démocraties abordent cette troisième décennie démunies, sans les chartes des droits, cadres juridiques et structures institutionnelles nécessaires pour garantir un avenir numérique compatible avec les aspirations d’une société démocratique.
Poser les bases d’un siècle numérique démocratique
Nous en sommes encore aux balbutiements de la civilisation de l’information. Cette troisième décennie est l’occasion de poser les fondements d’un siècle numérique démocratique. La démocratie subit un siège auquel elle est seule capable de mettre un terme. Si nous voulons déjouer le coup d’État épistémologique, cela doit passer par la démocratie. Je propose d’axer ces premiers pas sur trois principes.
Premier principe : l’État de droit démocratique. Le numérique doit vivre sous le toit de la démocratie, non pas comme un pyromane, mais comme un membre à part entière de la famille, sujet à ses lois et à ses valeurs et s’y adossant pour se développer. La démocratie, ce géant endormi, s’agite enfin avec des initiatives juridiques et législatives en cours aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, cinq projets de lois d’envergure, quinze projets de lois connexes et une proposition législative importante, chacun ayant des effets concrets sur le capitalisme de surveillance, ont été déposés au Congrès entre 2019 et mi-2020.
En octobre dernier, le ministère de la Justice, rejoint par onze États, a lancé des poursuites fédérales contre Google pour abus de position dominante. En décembre, la Federal Trade Commission a intenté un procès historique à Facebook pour ses pratiques anticoncurrentielles, rejointe par quarante-huit procureurs généraux, eux-mêmes imités peu après par trente-huit autres procureurs qui accusent Google d’user de moyens anticoncurrentiels pour évincer les rivaux de son moteur de recherche et [pousser les internautes à] privilégier ses services.
Reste que, pour ce qui est de déjouer le putsch épistémologique, la lutte antitrust montre ses limites. De fait, affaiblir Facebook ou n’importe quel autre géant du web ne nous prémunirait pas contre les dangers évidents du capitalisme de surveillance. Il faut aller plus loin.
Deuxième principe : la nouvelle donne appelle de nouvelles lois. De nouveaux droits apparaissent en réaction aux changements de nos modes de vie. Sur la question du droit à la vie privée, par exemple, le combat de l’avocat Louis Brandeis [au début du XXe siècle] s’expliquait par l’essor de la photographie et le risque de vol d’informations ou d’immixtion dans la vie privée qu’elle représentait.
Un droit inaliénable à la vie privée
Une civilisation de l’information démocratique ne peut pas progresser sans de nouvelles chartes des droits épistémologiques qui prémuniraient les citoyens contre les ingérences et les vols à grande échelle perpétrés par les acteurs du capitalisme de surveillance.
Pendant presque toute l’époque moderne, le droit à la vie privée était considéré comme élémentaire, rivé à nous comme notre ombre. Nous décidons chacun si et comment nos informations personnelles sont partagées, avec qui et à quelles fins.
En 1967, l’avocat William Douglas se faisait l’interprète des rédacteurs de la Déclaration des droits en expliquant que “la personne doit avoir la liberté de choisir elle-même le moment et les circonstances de la divulgation de ses secrets à autrui et de déterminer l’étendue de cette divulgation”. Cette “liberté de choisir”, c’est le droit épistémologique élémentaire de nous connaître nous-mêmes, dont découle toute notion de vie privée.
Par exemple, en tant que détentrice naturelle de tels droits, je ne donne pas au logiciel de reconnaissance faciale d’Amazon le droit de déceler et d’exploiter la peur [qui se lit sur mon visage] à des fins de ciblage et de prédiction comportementale, tout ça pour satisfaire les objectifs commerciaux d’entreprises tierces. Ce n’est pas simplement que mes émotions ne sont pas à vendre mais qu’elles sont invendables parce qu’inaliénables. Je ne donne pas ma peur à Amazon, mais Amazon me la prend quand même – une donnée de plus parmi les milliards d’autres qui alimentent les machines chaque jour.
Si nos droits épistémologiques élémentaires ne sont pas gravés dans la loi, c’est parce qu’ils n’avaient jamais fait l’objet jusque-là de menaces systématiques. Seulement voilà, les acteurs du capitalisme de surveillance ont fait valoir leur droit à tout savoir de nos vies.
Nous sommes donc à l’aube d’une nouvelle ère, fondée sur le statut d’exception implicite dont bénéficie le capitalisme de surveillance. Aujourd’hui, pour exister, le droit de savoir et de décider qui connaît notre vie doit être inscrit dans la loi et protégé par des institutions démocratiques.
Proscrire l’usage commercial des données
Troisième principe : à menace inédite, réponse inédite. De la même manière qu’une nouvelle situation fait apparaître la nécessité de nouveaux droits, les répercussions de ce coup d’État épistémologique appellent des solutions ad hoc.
Face à la nouvelle donne que nous impose le capitalisme de surveillance, la plupart des débats juridiques et réglementaires se focalisent sur les problèmes qui interviennent en aval, les données – leur confidentialité, leur accessibilité, leur transparence et leur cessibilité – et les stratagèmes permettant d’obtenir notre consentement moyennant une rétribution (dérisoire) en échange de nos données.
C’est en aval également qu’interviennent les débats sur la modération des contenus et les filter bubbles[le filtrage personnalisé, qui maintient l’internaute dans une “bulle” d’information], qui voient législateurs et internautes se courroucer devant des patrons réfractaires. C’est dans le périmètre de ces problèmes secondaires que ces sociétés veulent nous cantonner, focalisés sur les petites lignes des contrats de propriété au point d’oublier l’essence même du problème, à savoir que leurs revendications de propriété sont illégitimes.
Reste à savoir quelles solutions inédites permettraient de s’attaquer aux effets inédits de ce coup d’État épistémologique. Il convient en premier lieu de remonter en amont, à la source, et de mettre un terme à la collecte de données à des fins de surveillance commerciale. C’est en amont que le permis de voler fait des miracles, usant de diverses stratégies de surveillance pour changer le plomb de nos existences en or, c’est-à-dire en bases de données propriétaires.
Nous avons besoin de cadres juridiques qui mettent fin à l’extraction massive de données personnelles et la déclarent illégale. Des lois proscrivant ces pratiques permettraient de couper les chaînes d’approvisionnement illégitimes du capitalisme de surveillance. Ni les algorithmes qui recommandent, microciblent et manipulent ni les millions de prédictions comportementales débitées à la seconde ne peuvent exister sans les milliards de données qui abreuvent quotidiennement ces machines.
Préserver l’intérêt général
Ensuite, nous avons besoin de lois qui arriment la collecte de données aux droits fondamentaux et l’utilisation de ces données à l’intérêt général : elles doivent répondre aux besoins réels des personnes et des populations.
Enfin, nous suspendons les incitations financières qui encouragent le capitalisme de surveillance. Nous pouvons également interdire les pratiques commerciales tributaires d’une collecte massive de données. Les sociétés démocratiques ont bien proscrit la traite des êtres humains, alors qu’elle faisait vivre des économies entières.
Ces principes guident d’ores et déjà l’action démocratique. La Federal Trade Commission a lancé une enquête sur les réseaux sociaux et les sites de streaming vidéo moins d’une semaine après avoir déposé sa plainte contre Facebook, déclarant qu’elle avait bien l’intention de “soulever le capot” sur ses activités internes “et d’étudier ses moteurs en détail”.
Si elles sont adoptées, les propositions de lois novatrices élaborées en Europe et en Grande-Bretagne commenceront à institutionnaliser ces trois principes. Un cadre européen permettrait d’asseoir l’autorité de la démocratie sur les boîtes noires des activités internes des principales plateformes. Les droits fondamentaux et l’État de droit ne s’évaporeraient plus à la cyberfrontière, le législateur insistant sur la nécessité d’un “cyberenvironnement sûr, prévisible et digne de confiance”.
En Grande-Bretagne, le projet de loi Online Harms instituerait un devoir de protection qui tiendrait les groupes du web responsables des préjudices causés et prévoirait de nouvelles instances de contrôle assorties de pouvoirs coercitifs.
Deux citations généralement attribuées à Louis Brandeis figurent dans l’impressionnant rapport du Congrès sur la lutte antitrust :
Nous devons faire un choix. Nous pouvons avoir la démocratie ou nous pouvons avoir la richesse concentrée dans les mains de quelques-uns, mais nous ne pouvons pas avoir les deux.”
Cette déclaration, si pertinente à l’époque du juriste, reste un commentaire piquant sur le capitalisme à l’ancienne, mais elle n’est plus adaptée au nouveau capitalisme qui nous connaît. À moins que la démocratie n’annule le permis de voler et ne conteste le modèle économique et le fonctionnement du capitalisme de surveillance, le coup d’État épistémologique à l’œuvre fragilisera la démocratie et finira par la transformer.
Nous avons un choix à faire. Nous pouvons avoir la démocratie ou nous pouvons avoir une société de la surveillance, mais nous ne pouvons pas avoir les deux. Nous avons une civilisation de l’information démocratique à bâtir, et il n’y a pas de temps à perdre.
Crédit-photo: Forbes
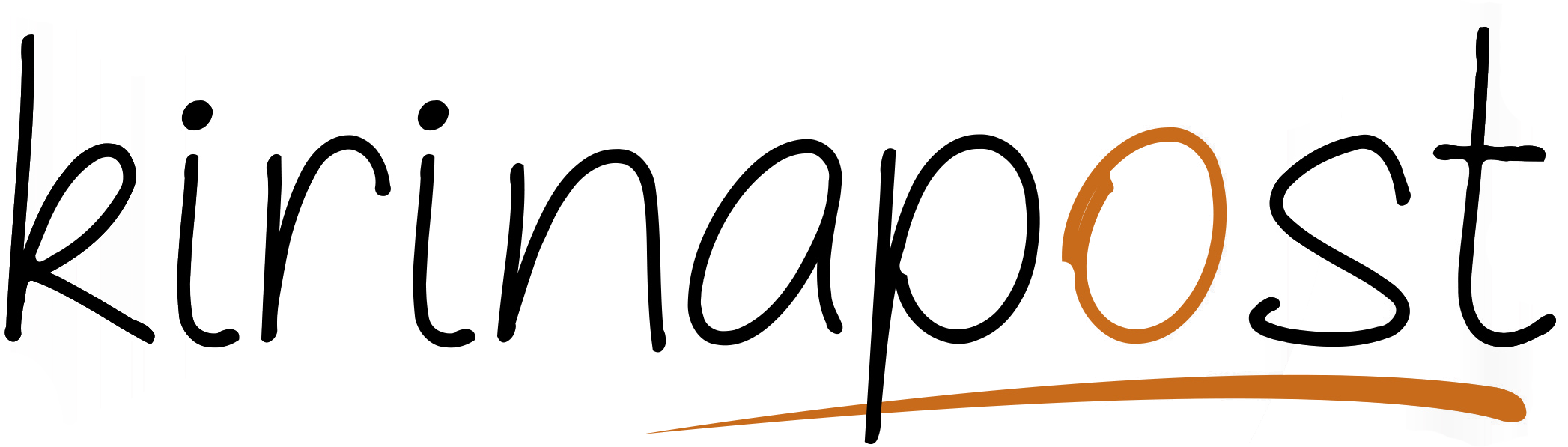





![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-120x120.jpg)




Laisser un commentaire