Stéphanie Latte Abdallah revient sur la notion d’apartheid israélien, examine la question politique à l’origine de l’attaque du 7 octobre, et débat de la possibilité de trouver une solution viable à un conflit désormais hors de contrôle. Un article: Regards
Stéphanie Latte Abdallah est directrice de recherche au CNRS, historienne et anthropologue du politique. Elle est également l’auteure de La toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine (Bayard 2021) et Des morts en guerre. Détention des corps et figures du martyr en Palestine (Karthala 2022).
Regards. Vous avez traité, dans votre livre La toile carcérale, de l’incarcération massive des Palestiniens dans les prisons israéliennes, ainsi que d’une « détention suspendue », c’est-à-dire la crainte constante d’une potentielle détention chez les Palestiniens. La bande de Gaza est fréquemment décrite comme une prison à ciel ouvert. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Stéphanie Latte Abdallah. Cette notion de « prison à ciel ouvert » décrit un espace maintenu sous blocus depuis au moins 2007, au moment de la prise du pouvoir par le Hamas dans la bande de Gaza. Israël contrôle l’ensemble des frontières Gaza, y compris maritimes, à l’exception de la frontière sud par Rafah qui est une frontière avec l’Égypte. Gaza n’a plus d’aéroport depuis sa destruction par des frappes israéliennes début 2000. Israël contrôle donc l’essentiel des circulations de personnes, de biens et toute forme d’approvisionnement dans et vers la Bande de Gaza. Entre 2007 et 2013 s’est constitué ce que l’on a appelé une « économie des tunnels », qui a permis de faire entrer toute une série de biens par des tunnels creusés vers l’Égypte. Cette économie parallèle a allégé ce blocus en laissant entrer les marchandises souhaitées par les Gazaouis et par le Hamas qui la contrôlait.
Le mot « apartheid » est également de plus en plus utilisé, notamment par des ONG comme Amnesty et Human Rights Watch, au regard du traitement infligé par Israël aux Palestiniens. Cela vous paraît-il approprié ?
Pour Israël même, il s’agit plutôt de discriminations envers les Palestiniens d’Israël, même si la loi « Israël. État nation du peuple juif » adoptée en 2018 a établi juridiquement une hiérarchie entre les citoyens israéliens. Mais en ce qui concerne les territoires occupés, on peut parler d’apartheid. Le cas de la Cisjordanie est le plus frappant : la population israélienne, constituée de 450-500 000 colons (sur les 700 000 colons au total en incluant la partie Est de Jérusalem, elle aussi occupée) et les Palestiniens ont des droits différenciés. Ils sont soumis à des juridictions différentes. Par exemple, pour toute une série de délits, et pas seulement des délits de type sécuritaire, les Palestiniens sont jugés à la cour militaire alors que les colons sont jugés par les cours civiles israéliennes. Les possibilités de circulations sont également différentes entre les deux populations, ainsi qu’au sein même de la population palestinienne. Il existe entre 100 et 120 types de permis de circulation pour les Palestiniens. Les capacités de déplacement varient si vous êtes Gazaoui – les possibilités de sortie de la bande de Gaza étant très faibles –, ou bien de Jérusalem – vous pouvez alors circuler librement dans l’ensemble des espaces israélo-palestiniens – ou encore si vous habitez en Cisjordanie. De plus, à partir de formes de profiling bio-social individualisé, vous avez accès, ou non, à différents types de permis pour différentes activités (travailler en Israël, travailler dans les colonies, prier à la mosquée à Jérusalem, se déplacer de la Cisjordanie à Gaza, etc.) selon une série de critères incluant vos appartenances politiques, et celles de votre réseau social et familial, votre genre, votre âge, etc.
« En ce qui concerne les territoires occupés, on peut parler d’apartheid. Le cas de la Cisjordanie est le plus frappant : la population israélienne et les Palestiniens ont des droits différenciés. »
Le crime d’apartheid, tel qu’il est défini par la Convention sur l’apartheid de 1973, dénonce des actes inhumains commis dans un régime institutionnalisé et systématique d’oppression d’un groupe racial, ethnique ou national sur un autre, avec l’intention de maintenir ce régime. Pour le cas palestinien, il y a un certain nombre de caractéristiques qui relèvent de ces actes inhumains : la privation de la liberté physique et de droits fondamentaux ; la différenciation des droits entre deux groupes vivant dans un même espace institutionnalisée par un régime juridique ; des possibilités de circulation différentes ; des transferts de population ; l’emprisonnement massif, pour des raisons qui relèvent de la sécurité mais aussi pour des raisons politiques et de résistance au système mis en place pour assurer cet état d’oppression. Donc oui, il est possible de qualifier cela de système d’apartheid dans les territoires occupés, tout particulièrement en Cisjordanie, tel qu’il est défini par la convention de 1973.
Historiquement, l’apartheid renvoie au régime politique de l’Afrique du Sud de 1948 à 1991. Si l’on emploie cette notion pour le cas palestinien, est-ce que cela signifie que les méthodes utilisées par la population noire sud-africaine pour mettre fin à ce système d’oppression peuvent être, elles aussi, réutilisées pour mettre fin à l’apartheid israélien ?
En Afrique du sud, le mouvement de résistance est peu à peu parvenu à rallier l’essentiel des pays, qui ont progressivement boycotté le régime d’apartheid. Au contraire, la campagne « Boycott, désinvestissement et sanctions » lancée en 2005 par des Palestiniens à l’échelle internationale, a plutôt été criminalisée par les différents gouvernements, notamment le gouvernement français. Cette dénonciation de l’apartheid palestinien n’est pas partagée par la plupart des pays qui pourraient faire pression pour y mettre un terme, malgré les rapports publiés à l’échelle internationale.
La question sémantique autour des événements en cours à Gaza divise. Il y a des critiques très fortes qui sont émises de tous les côtés lorsque l’on évoque le Hamas : est-ce un mouvement terroriste, un mouvement de résistance, etc. Comment est-ce que vous vous positionnez, en tant que chercheuse, dans cette atmosphère dans laquelle il semblerait que tout le monde doive penser la même chose ?
Il est important, dans nos recherches, d’observer le mouvement du Hamas dans ses différentes composantes d’une part, et d’autre part en ayant à l’esprit qu’il est parcouru par des tendances distinctes. Le mouvement Hamas comprend tout à la fois un parti politique, qui a obtenu la majorité à l’Assemblée nationale en 2006, et une branche militaire. Enfin, il y a l’administration Hamas, qui s’est construite à partir de 2007 sur les restes de l’Autorité palestinienne qui administrait Gaza. Cette administration, souvent oubliée, gère la bande de Gaza avec tout ce que cela comporte : différents ministères et toute une série de charges administratives.
En tant que chercheuse, j’observe la diversité du mouvement et je le caractérise de manière plus analytique et plus descriptive. C’est en distinguant ces différents éléments que l’on peut mieux comprendre son fonctionnement, et notamment que la branche militaire a pris une certaine indépendance par rapport aux branches administratives et politiques. En effet, l’attaque très violente du 7 octobre a été surtout, de fait, décidée par la branche militaire, sans réelle consultation avec la branche politique dans son ensemble. Des leaders de la branche politique y ont participé et étaient au courant, c’est sûr, mais il semblerait que ce soit la branche militaire qui ait décidé de conduire l’attaque et qui l’ait complètement organisée. Vu la violence des exactions, on peut aussi se demander qui elle a recruté pour les commettre. Par ailleurs, il s’agit aussi de préciser qui qualifie les choses : si certains, parmi les Palestiniens, considèrent le mouvement Hamas comme un mouvement de résistance, ce sont leurs paroles à eux, et non celles du chercheur.
A partir de nombreuses sources écrites et orales, et de longues enquêtes de terrain dans des lieux et sur des contextes sur lesquels nous travaillons pendant des années, la recherche essaie de comprendre comment les uns et les autres vivent et perçoivent la situation en Palestine. Si nous prenons acte que pour une partie des Palestiniens, il s’agit d’un mouvement de résistance, même si toutes et tous ne partagent pas l’idéologie islamiste du Hamas ni ses modes opératoires, la question est de comprendre pourquoi et comment ces formes d’adhésion se sont construites, dans quel contexte elles se formulent et se situent etc. Le travail des chercheurs est d’apporter une profondeur historique, politique ou sociologique et anthropologique parce que cette histoire n’a pas commencé le 7 octobre. Juste après l’attaque du Hamas, il était extrêmement compliqué ne serait-ce que d’offrir un début de contextualisation.
Dans tous les cas, nous sommes dans une situation de très grande violence, d’un côté par le Hamas, mais aussi par l’armée israélienne qui cible massivement la population civile gazaouie. Il faut essayer de revenir à une analyse qui permette de comprendre dans quelle mesure il y a des solutions politiques, puisqu’au fond la question qui est posée, même si c’est dans l’extrême violence, c’est une question politique. La politique de Netanyahou a consisté à contourner la question palestinienne d’une part en gérant un conflit qu’il pensait pouvoir maintenir à basse intensité par une série de dispositifs mis en place à partir de la fin de la seconde Intifada (2000-2006), et d’autre part par la normalisation avec les pays arabes de la région. Ce qu’il y a derrière les actes du 7 octobre, c’est cette question politique et territoriale que les gouvernements israéliens successifs n’ont plus voulu prendre en compte depuis cette période. En ce sens, la responsabilité que portent les politiciens israéliens et le premier chef Netanyahou est très lourde. De même que celle des Etats-Unis, de l’Europe et du reste du monde, y compris les pays arabes qui se sont, peu ou prou, satisfaits de cette situation.
Dans l’article de Latifa Madani publié par L’Humanité le 23 octobre, vous dites que la jeunesse palestinienne ne croit plus à la possibilité de deux États et que l’idée d’un État binational progresse dans l’opinion. Les citoyens seraient les principaux acteurs pour arriver à une telle solution et cela pourrait supposer l’abandon de l’idée d’un État juif. Pensez-vous que cette création d’un seul État soit possible avec le soutien inconditionnel à Israël manifesté par les États-Unis et divers responsables européens depuis le 7 octobre ?
Ces solutions à un ou deux États sont à peu près à égalité dans les sondages d’opinion en Palestine, avec 30% de soutien de chaque côté. Mais elles sont toutes les deux complexes à réaliser, notamment car elles nécessitent des volontés politiques très fortes. Les acteurs pour les mettre en œuvre sont différents parce que, pour l’État binational, ce sont plutôt les citoyens qui, de l’intérieur, luttent pour les mêmes droits que ceux des Israéliens. Mais c’est un processus que l’on peut imaginer extrêmement long, d’autant plus qu’il existe différentes formules pour amener à la création d’un État binational. L’une d’elles, proposée par le collectif israélo-palestinien Une Terre pour Tous, envisageait le territoire comme une terre appartenant à tous, offrant la possibilité aux réfugiés de 1948 de retourner vivre dans les lieux où ils habitaient, du moins dans une certaine mesure, mais aussi aux colons qui se sont implantés de rester. Autrement dit, il n’y aurait pas de limites sur le lieu où il est possible de s’installer. En revanche, deux entités de type étatique gouverneraient la vie des deux peuples selon les lois qui sont les siennes. Deux formes de représentation politique et deux formes de gestion administreraient et représenteraient politiquement les personnes dans un espace qui serait non continu. Dans ce type de configuration, il y aurait donc un rattachement à une entité de type étatique – où pourrait tout à fait perdurer l’idée du sionisme et d’un État juif, contrairement par exemple à celle d’un seul État démocratique pour toutes et tous – à l’intérieur d’une confédération commune, avec un statut particulier pour Jérusalem.
On le voit, une grande diversité existe dans les schémas qui peuvent être proposés, mais il faudrait des volontés politiques communes qui, pour l’instant, n’existent pas, notamment du côté israélien. Netanyahou, qui a été au pouvoir quasiment sans interruption depuis plus de deux décennies, s’est concentré sur la gestion du conflit et du risque dans un espace de facto partagé. Ce qui s’est avéré un échec. La question de l’autodétermination des Palestiniens persiste. Ils n’acceptent pas l’annexion de la Cisjordanie, la colonisation continue et l’absorption de tout le territoire dans un État Israélien qui a instauré des droits plus que différenciés, et un système qui s’apparente à de l’apartheid. Par ailleurs, l’Autorité palestinienne est aujourd’hui très décriée. Il lui est reproché, en plus de la coopération sécuritaire qu’elle maintient avec les autorités israéliennes, de n’avoir obtenu que très peu de choses sur le plan politique malgré les concessions qu’elle a faites.
A cela s’ajoute la relative absence de la communauté internationale qui n’a pas souhaité, par désintérêt, fatigue, lassitude ou intérêts, exercer les pressions suffisantes pour aller vers une solution à deux États ou vers une autre configuration. Le droit international est mobilisable à la fois sur les questions des deux États, de l’apartheid ou encore de la colonisation. La Cour Pénale Internationale, qui pourrait aujourd’hui commencer à inculper les auteurs des crimes commis, ne le fait pas. Le système international et la communauté internationale ne jouent pas leurs rôles dans ce conflit. Il semble donc impossible, pour l’instant, d’entrevoir une issue prochaine au conflit. D’autant qu’en Cisjordanie, les violences des colons se multiplient. Ils profitent des événements à Gaza pour attaquer des petites villes et des villages, qui sont coupés les uns des autres par les bouclages de l’armée, pour accaparer plus de terres et exproprier les habitants, tout particulièrement les Bédouins, qui vivent sur des terres encore plus isolées. Il faudrait que la communauté internationale s’engage réellement sur le fond du problème, ce qui est loin d’être le cas pour l’instant. Cela fait pourtant partie de ses responsabilités, d’autant plus qu’elle y est pour beaucoup dans la création de ce conflit : rappelons que c’est une résolution de l’ONU qui a ouvert la voie au partage de la Palestine.
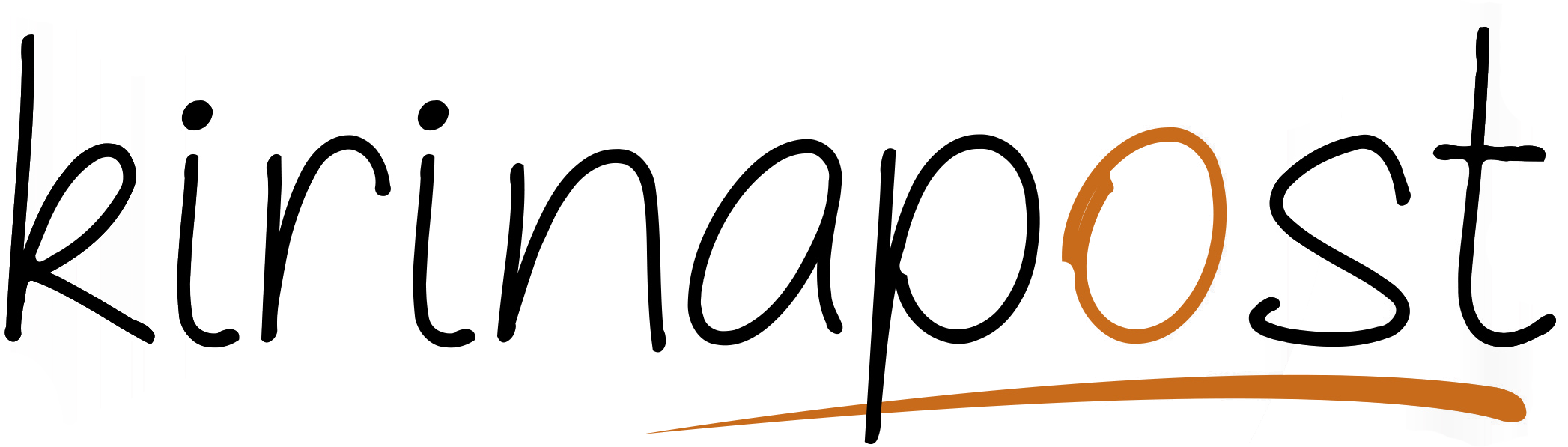










Laisser un commentaire