Septembre 2013. Une critique intelligente de la « valeur » économique, de l’orientation des sciences économiques, de la « main invisible ». Le bloc idéologique capitaliste, ses savoirs et ses pratiques de profits sans causes ni fins, est un obstacle majeur à la durabilité du monde.
ALBERT JACQUARD (1925-2013) : « L’ÉCONOMIE EST BASÉE SUR UNE CONCEPTION ÉRONÉE DU THÈME DE LA VALEUR ». Propos recueillis par Denis Lafay, Acteurs de l’économie | 13/09/2013, 10:16 | 3603 mots.
Né à Lyon le 23 décembre 1925, le généticien Albert Jacquard est décédé mercredi 11 septembre, emporté par une forme de leucémie, à l’âge de 87 ans.
Cet entretien avait été réalisé en décembre 2006, presque sept ans avant sa disparition survenue mercredi à l’âge de 87 ans. Rien de ce que l’humaniste expose ici (publié alors dans les colonnes d’Acteurs de l’économie) n’a vieilli. L’« utopie » du généticien, également ancien élève de Polytechnique et de l’université de Stanford, appelle à réveiller les consciences qui enferment dans la logique économique tout ce qui, des ressources naturelles à la santé ou à l’éducation, devrait lui échapper. Un cri d’amour pour l’homme, de haine pour la marchandisation, et d’espérance pour ceux qui refusent la résignation. La Tribune publie également infra la préface qu’il avait rédigée en 2009 pour l’ouvrage « Autrement » (Acteurs de l’économie). Albert Jacquard y exhorte le lecteur à se « prendre en main » pour décider de sa vie et de la vie. Leçon d’altruisme, et là encore, une utopie salvatrice afin d’imaginer la planète et l’humanité « différemment ».
Qu’est-ce qu’une utopie ?
Albert Jacquard (A.J): C’est ce qui n’est pas encore mais qui pourrait exister. C’est un rêve qu’hélas on n’a pas encore essayé d’exaucer. Une utopie doit être raisonnable, même très raisonnée. A cette condition, elle autorise la lucidité. Et c’est cette lucidité qui nous amène à constater que les êtres humains, parfois de bonne foi, se sont trompés. Ils ont cru que la terre était inépuisable, presque infinie. L’état de l’humanité fait la démonstration inverse.
Pour quelles raisons l’utopie est-elle à la fois si précieuse et si menacée ? Comment doit-on agir pour préserver l’espace d’utopie en chacun de nous puis dans la société ?
A.J: On ne peut pas concevoir l’avenir sans envisager l’utopie. L’avenir, par définition, n’existe pas. La nature ne connaît que le présent. Les hommes ont inventé un « demain », et leurs angoisses de ce demain les entraînent à l’orienter dans la direction qu’ils souhaitent. Cette singularité propre aux seuls hommes est merveilleuse, à condition de savoir l’utiliser. Ce qui n’est pas le cas, car ce demain nous le définissons collectivement selon la loi du marché, ce mythe ridicule de la « main invisible » qui convainc d’accepter de se soumettre au hasard.
Sommes-nous victimes du diktat du pragmatisme ?
A.J: Nous faisons le choix d’orienter toute l’activité humaine en fonction d’événements qu’il suffirait d’ignorer puisqu’ils ne représentent rien. Or on préfère créer des raisonnements intelligents autour de cette absurdité de la « main invisible ». Regardez les théologiens : ils produisent des concepts formidables, mais qui reposent sur la croyance. Et l’édifice intellectuel qu’ils érigent à partir de cette croyance est démesuré. C’est malheureusement cette même logique qui prévaut en économie.
Comment peut-on maîtriser cette « main invisible » ? Par la volonté collective?
A.J: Une structure collective est certes nécessaire, mais elle ne peut encore être déployée. C’est pourquoi l’utopie apparaît aussi essentielle pour diriger la planète. Prenons l’exemple du pétrole. Intrinsèquement, rien ne permet de déterminer que le baril « vaut » 2 ou 1 000 dollars. La valeur du pétrole doit s’établir selon bien d’autres paramètres que ceux marchands. Ce « cadeau de la nature », épuisable, ne peut pas être fourni sans limite à tout le monde, et exige une gestion saine et équitable. Ce que nous refusons d’adopter, au risque d’approcher le pire du pire. Cette négligence et ce mépris sont monstrueux.
Vous rejoignez là l’économiste Patrick Artus, convaincu que les ressources naturelles constituent un bien collectif qui doit se soustraire à la propriété de quelques entreprises multinationales…
A.J: Les ressources naturelles forment le patrimoine commun de l’humanité. Le concept, merveilleux, déposé par l’Unesco pour les cathédrales et les temples, devrait être adapté à toutes les réalités non renouvelables de la nature.
La « valeur » créée par la croissance économique est parfois loin de nourrir la valeur humaine. L’utopie consiste-t-elle à tenter d’asservir la valeur économique à celle de l’homme, et à organiser autrement l’attribution du pouvoir ?
A.J: Sur ce sujet de la « valeur », la langue française est insuffisante. Comme pour le « temps », un même mot signifie plusieurs réalités. Les valeurs aux sens économique et humain n’ont rien de commun. Appliquer une valeur économique à des actes du type « garder un enfant » ou « aider un vieillard » n’a aucun sens. Sauf à considérer que cela coûtera toujours trop cher. La valeur d’un objet n’est pas fonction de l’objet lui-même mais seulement de ce que la société qui l’entoure en a décidé. Tel livre peut « valoir » 1 ou 10 000 euros selon l’intérêt qu’on lui porte. En définitive, toute l’économie est basée sur une conception erronée du thème de la valeur. Sans doute faut-il envisager l’élimination de ce mot.
Il faut donc être vigilant sur l’exploitation manipulatrice, à des fins d’image et mercantiles, que les entreprises font de ce mot…
A.J: Les entreprises créent une valeur économique. Mais les vraies valeurs sont ailleurs. Quelles sont-elles ? Par exemple l’intelligence. Celle d’un enfant forme une valeur extraordinaire. Et s’interroger sur le « coût » de son développement ou sur sa valeur marchande est inepte.
Comment la place, la crédibilité, la légitimité que nous réservons à l’utopie sont-elles liées à notre rapport à la mortalité, à notre besoin d’éternité, à la foi ou à l’absence de foi ?
A.J: Je me méfie des instructions de catéchisme qui, lorsque j’étais enfant, m’enseignaient que la vie sur terre servait à préparer la vie future. Je me contente de préparer ma vie actuelle, celle de mes enfants et de mes petits-enfants. Ce lien que vous évoquez consiste à refuser de se réfugier dans la foi en l’au-delà afin de préserver son sens de la responsabilité à l’égard de la réalité d’aujourd’hui. Le monde de demain, c’est moi qui le bâtis avec d’autres. Je me donne le devoir d’agir pour que ça fonctionne mieux. Dès lors, l’utopie n’est plus un rêve et devient un projet d’humanité. Son initiation doit prendre pour fondement que tout homme est une merveille, et qu’il faut s’émerveiller devant l’homme. Sans l’adoption de ce postulat, il n’y a pas d’issue.
À quoi s’expose une société qui entrave l’accès à l’utopie ?
A.J: Au désespoir. Et in fine à la popularisation des sectes : « Puisque rien n’est possible sur terre, je vais vous apprendre que tout est possible chez moi : scientologue, témoin de Jéhovah… ». « J’atteins l’âge où proposer une utopie est un devoir », écrivez-vous. Ne faut-il pas enseigner que ce devoir concerne chaque âge, et que seulement à ce prix il est possible d’espérer cette « cité idéale » qui ambitionne l’épanouissement des humains ?
Absolument. Mon propos est à mettre en lien avec une angoisse personnelle qui croît avec l’âge. A 80 ans, le temps terrestre s’est amenuisé, le sentiment de l’urgence croît, les angoisses grandissent, alors qu’à 40 ans on se sent encore éternel.
Votre modèle d’enseignement, qui donne à chaque élève l’opportunité de créer sa propre utopie, n’a pas pour vocation de préparer à la vie active, de se soumettre à la réalité économique, ou de fournir à ce « moloch qu’est le marché, les hommes et les femmes dont il a besoin ». Comment pouvez-vous faire entendre cette démonstration aux centaines de milliers de jeunes aujourd’hui sans emploi ?
A.J: Il faut placer chacun dans les conditions de créer sa personne, de devenir quelqu’un, sans qu’il soit orienté vers une finalité productiviste et mercantile, sans qu’il soit façonné à ce que le « marché » va réclamer de lui. Dans les écoles de la banlieue parisienne, j’ai affaire à des gens un peu désespérés mais qui m’écoutent volontiers parce qu’ils préfèrent avoir pour objectif de se construire que de devenir des futurs patrons. Certes, gagner correctement leur vie est essentiel, mais ils ont compris que l’enjeu prioritaire est ailleurs, dans la réalisation d’eux-mêmes. Ce qui implique d’avoir une perspective. Résultat, ils sont moins désespérés lorsqu’ils m’écoutent que lorsqu’ils entendent les discours du richissime patron de Total.
Votre essai « L’utopie » (Stock) démarre par l’école et s’achève par l’école. Vous condamnez très sévèrement les systèmes de sélection, de notation et de concours de l’enseignement supérieur. En premier lieu pour l’accès à l’école, prestigieuse, dont vous êtes issu : Polytechnique. Celle-ci – comme d’autres – a-t-elle échoué dans ce qui constitue à vos yeux le cœur de l’éducation : « meubler l’intelligence » ?
A.J: Ces établissements ne savent pas s’y prendre, et pourtant le besoin est ressenti. Les jeunes ingénieurs sont parfaitement formés à construire des machines et des bâtiments. Mais il leur manque un plus : l’humanisme. Lorsque Mario Botta prépare la construction de l’école d’architecture de Lugano, il m’invite à enseigner « l’humanistique ». Pourquoi ? Parce qu’il avait saisi que ses étudiants devaient réfléchir à l’homme avant de plancher sur les plans de bâtiments, et qu’une dose d’humanisme était utile à l’accomplissement, à la densité, à l’utilité de leur futur métier.
Dans le germe humain, la société, les règles qui façonnent l’organisation, qu’est-ce qui constitue un obstacle à l’exaucement de votre utopie ?
A.J: En théorie, rien. En réalité, l’inertie, qui entrave la dynamique nécessaire à ce changement de cap que nous devons emprunter en urgence. Et cette inertie est parfaitement bien orchestrée et instrumentalisée. Qu’un ministre comme Thierry Breton ose nous engager vers une croissance annuelle sans fin de 3 % – qu’un élève du certificat d’études sait parfaitement incompatible avec l’état de la planète – relève de la falsification intellectuelle.
Vous êtes généticien, spécialiste des populations. Comment expliquez-vous que l’homme soit à ce point si peu capable de mettre son intelligence au service du « bon » et des autres, et si capable de détruire l’autre comme d’engager son autodestruction ?
A.J: On ne peut pas l’expliquer, seulement le constater. Ce qui apparaît majeur dans ce dévoiement, c’est le culte du pouvoir. De François d’Assise à Gandhi ou aux plus anonymes citoyens, la planète regorge de gens merveilleux, dénués de goût du pouvoir. Face à eux, toutes sortes de décideurs, énarques, polytechniciens et autres, appâtés par ce pouvoir que leur accès privilégié aux rouages décisionnels permet d’assouvir. Ma référence est un homme qui vécut deux siècles avant Jésus Christ. Un jour qu’il labourait son champ, on vint le chercher et on lui demanda d’intervenir pour sauver la République. « Toi seul peux y parvenir ». « J’ai mes champs à cultiver». «Ca ne fait rien, viens ». Il se rendit à Rome, accomplit sa tache, et deux ans plus tard retourna à ses champs. Simplement parce qu’il n’avait pas envie du pouvoir. Il faut se méfier de tous ceux qui veulent le pouvoir : ils sont peu intelligents et/ou vicieux.
C’est dans ce même registre que vous vous élevez contre la hiérarchisation des êtres humains ?
A.J: Il ne peut exister de palmarès entre les hommes. Et il faut lutter contre le principe d’unidimensionnalité, au nom duquel on réduit l’individu à un mot et on détermine qu’un être est meilleur qu’un autre. C’est pour cette raison qu’à l’école il faut cesser cette logique, puérile, des concours, qui hypothèque la mission de l’éducation : participer à la construction de personnes différentes.
Mais comment ne pas verser alors vers un inepte et dangereux égalitarisme ?
A.J: Bien sûr, je ne suis pas égal à un autre. Mais l’absence du signe « égal » n’autorise pas pour autant l’introduction des signes « plus grand » ou « plus petit ». Ces deux items ne valent que pour des ensembles définis par un nombre. Or nous ne sommes pas identifiables par un nombre. Si bien que l’on ne peut pas appliquer aux hommes les principes de supériorité et d’infériorité.
Vous expliquez précisément comment la lecture constitue l’axe cardinal de la construction de chaque intelligence. Votre cité idéale inclut-elle l’éradication de la télévision – vous osez une audacieuse comparaison entre Patrick Le Lay, président de TF1 mobilisé à « décerveler » les téléspectateurs pour les inféoder à la machine économique, et Joseph Goebbels – ?
A.J: Des centaines de milliers d’années ont été nécessaires pour créer le langage, fondé sur les sons. L’écoute de ces derniers enclenche un mécanisme intérieur qui développe l’image et la vision que nous aurons du mot. Et voilà qu’en l’espace de quelques décennies, on envoie non plus des sons mais des images qui bougent. Or notre cerveau n’est pas apte à traiter ces images. Devant le téléviseur, nous sommes immobiles, apathiques, face à ces images en mouvement qui accrochent et anesthésient l’esprit. La télévision provoque la destruction de l’intelligence, et ne peut pas être présentée comme utile.
Comment doit-on arbitrer entre les intérêts individuel et collectif ? Par exemple, alors que la carte scolaire est au cœur du débat électoral, comment les parents attachés au principe républicain de l’école publique doivent-ils agir lorsque ladite école publique dont ils dépendent n’est pas en mesure d’assurer l’éveil et l’épanouissement de leur enfant ?
A.J: Mes enfants ont toujours été à l’école publique. C’était certes plus rude qu’à Notre-Dame-de-Passy, mais ils ont gagné à être « en contact ». Il faut admettre que « ce qui nous fait, c’est ce qui nous fait mal ». En tant que parent, on voudrait que nos enfants n’aient jamais mal. Mais on a tort. Il faut de temps en temps qu’ils aient mal. Et d’ailleurs, ce mal, ils le connaîtront tôt ou tard. Pour cette raison, je considère que toute école devrait être publique et ouverte à tout le monde. L’enjeu, plus général, est de reconstruire l’intérêt personnel de telle sorte qu’il soit conforme à l’intérêt collectif. Pour cela, il ne faut pas hésiter à être révolutionnaire.
Est-ce du sentiment de propriété dont notre civilisation est la plus malade ? Cet attachement viscéral au « besoin » de posséder forme-t-il le symptôme d’une société effrayée et recroquevillée ?
A.J: Cet attachement caractérise une société qui ne joue pas l’avenir. Le seul bien dont je suis propriétaire, c’est une maison que j’ai achetée dans le Lot, pour 20 000 Francs. L’ensemble de mes droits d’auteur a contribué à la rendre vivable, puis belle. Bien sûr, je n’aimerais pas qu’on m’en dépossède. Pour autant, je considère qu’il n’y a aucune raison pour que mes arrière-petits-enfants bénéficient d’un bien qu’ils n’auront pas mérité. Cette maison, je l’ai érigée grâce au fruit de mon travail. Ce qui, par définition, ne sera pas le cas de ma descendance. On ne devrait posséder que ce que l’on construit soi-même. Il apparaît donc nécessaire qu’au bout de quelques générations les biens soient retirés à la famille. C’est essentiel pour revaloriser le travail. Hériter constitue une forme d’enfermement.
L’attachement à l’héritage matériel constitue-t-il pour les parents le moyen de se dédouaner du seul véritable héritage qui vaille mais qu’ils accomplissent insuffisamment : celui du sens, de la culture, de l’ouverture, du dialogue, de toutes formes de construction immatérielle ?
A.J: C’est effectivement une déviation, un faux semblant, un cache misère dans l’échec. L’enjeu est pour eux de compenser leurs manquements éducationnels par un bien qui, malheureusement, n’aidera en rien leurs enfants à se bâtir.
Vous distinguez le « travail torture » du « travail action », élément de rencontres, de projets, de réalisation de soi-même. Cette distinction peut être portée sur un autre périmètre : des terrains de forte croissance, aussi inutiles que néfastes à l’individu et à la planète, sont dopés par le consumérisme et le mercantilisme, quand d’autres, aussi essentiels à la collectivité que la santé, la culture, l’éducation, sont négligés. La société est-elle prête à envisager la hiérarchisation des domaines qui doivent héberger prioritairement les investissements et la croissance ?
A.J: Ce vœu est nécessaire. Mais on ne peut l’envisager qu’à l’échelle mondiale, et à la condition d’établir une échelle commune des valeurs. La première voie consisterait à « planétariser » le système de soin. Comme l’indique Bernard Kouchner, tout médecin est sans frontière, et tout accès aux soins devrait être égal pour tous. Comment peut-on encore conditionner la distribution des médicaments à la nationalité ou aux moyens financiers des bénéficiaires… Ensuite, ce même effort devra être porté sur l’éducation et la justice, mais cette fois de manière plus compliquée puisque contrairement à toute maladie, identique à Sao Paulo ou Sidney, l’éducation implique des systèmes différenciés qui tiennent compte des spécificités domestiques.
L’enjeu est en définitive d’orienter la dynamique de « réussite » vers le bien collectif…
A.J: Absolument. Il faut faire « quelque chose de sa vie ». Et réhabiliter le droit aux erreurs, car c’est par elles que l’on comprend.
Donnez-nous une raison de croire en l’accomplissement de votre utopie alors que vous citez cette confession terrible de René Dumont : « L’homme est le pire danger pour tout ce qui peuple la planète. Lorsqu’il disparaîtra, les autres vivants pourront se réjouir de l’élimination du plus inquiétant des prédateurs»…
A.J: Vous et moi avons des enfants. Ils sont la raison pour laquelle je partage intellectuellement l’opinion de René Dumont mais m’en démarque dans la réalité. Ces enfants sont notre émerveillement, et nous donnent le devoir de leur laisser une terre vivable. Cet argument, qu’on ne comprend que lorsqu’on est parent, est le seul qui vaille. Mais il est capital.
Si vous étiez ministre, quel portefeuille aimeriez-vous gérer ?
A.J: L’Education nationale. Partout, j’écrirais : « Ici on enseigne l’art de la rencontre. »
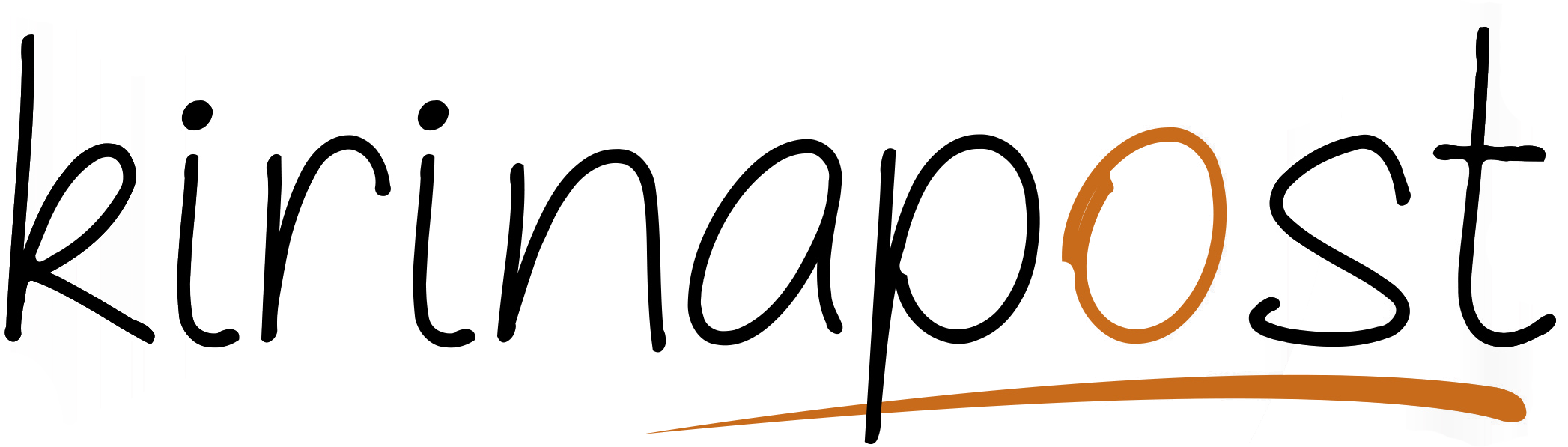





![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-120x120.jpg)




Laisser un commentaire