Après avoir reçu le Grand prix du Festival de Cannes dés son premier long métrage « Atlantique »,en 2019, la réalisatrice Mati Diop a remis ça cette année en décrochant l’Ours d’Or de la Berlinale 2024 pour son deuxième long métrage « Dahomey » en février dernier. Deux films, deux prix majeurs, mais aussi deux histoires d’une actualité aiguë pour le continent: la restitution des oeuvres d’arts pour « Dahomey » et l’émigration irrégulière avec « Atlantique ». Preuve s’il en faut que le sort de l’Afrique préoccupe au plus au point cette afrodescendante née à Paris, fruit de l’union d’une photographe française et du grand musicien sénégalais Wasis Diop. C’est peu dire donc, si elle a de qui tenir ! D’autant plus que le grand frère de son père n’est autre que l’iconique cinéaste Djibril Diop Mamebety…Son papa on dit en Afrique ! De passage à Dakar pour présenter « Dahomey », Mati Diop a accordé un entretien à Kirinapost lors de son marathon journalistique dans la capitale sénégalaise. Alors que « Dahomey » sort actuellement en France, retour sur une interview au pas de charge durant laquelle, la réalisatrice est revenue bien évidemment sur son film, mais aussi sur son cinéma… et sur son Afrique.

Mati Diop pose (samedi 1er Juin 2024) dans l’amphithéâtre de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, qui a accueilli la scène du débat dans le film Dahomey ©Carmen Abdali
Mati Diop: Je ne choisis jamais entre le documentaire et la fiction. Je choisis de faire un film. Dans le cas de Dahomey, il s’agissait en l’occurrence d’un événement qui se produit dans le réel, donc la dimension documentaire est intrinsèque. La question, c’est comment mettre en scène ce réel et quel point de vue adopter ? D’ailleurs, d’emblée dans le film, la subjectivité du regard est très forte. Le cinéma, je pense, ne devrait jamais s’enfermer, se limiter à des conventions de formats. Il doit s’affranchir de ces notions. Dahomey est un film ancré dans le réel qui ne renonce jamais au cinéma. Mais le documentaire, c’est du cinéma si on le décide ! D’ailleurs, je trouve que les questions de mise en scène que le documentaire pose sont encore plus exigeantes que celles qu’on rencontre en fiction. Parce qu’en documentaire, il n’y a qu’un seul endroit où mettre sa caméra et il n’y a qu’une prise possible.
Kirinapost: Dahomey a été projeté à Dakar. Et au cours des échanges post projection, vous avez semblé privilégier dans vos propos le terme Retour au lieu de Restitution…
Mati Diop: Je fais surtout la distinction entre « restitution » et « rapatriement ». J’accorde un sens profond au geste de restituer. Je pense que ça n’est pas le rôle d’Emmanuel Macron ou de la France de restituer son patrimoine culturel à l’Afrique. Il peut prendre la décision de rapatrier dans une démarche de réparation ce qui implique la reconnaissance d’un crime et qu’il soit légitime de rendre ce qui a été pillé mais a-t-il le pouvoir de restituer ? Je ne le crois pas. C’est à nous, africains et afro descendants à qui revient le rôle de restituer. Les anciennes puissances ont le devoir de rendre et de rapatrier ce qui a jadis été volés mais il me semble que c’est aux artistes, aux intellectuels, aux activistes et aux enseignants africains, afro descendants de prendre en charge la question de la restitution du patrimoine qui nous revient. C’est un geste de réappropriation de son histoire et de transmission de cette histoire vers la société civile, en l’occurrence la jeunesse. C’est à nous de choisir comment on restitue et comment on retransmet notre histoire.
Kirinapost: Dans le film, un des protagonistes a avancé que ces restitutions ne sont pas une priorité finalement pour l’Afrique tandis qu’un autre déplore le fait qu’elles ne concernent que quelques objets, car se déroulant au compte goutte. Vous avez tenu à donner la parole à toutes ces opinions ?
Mati Diop: Absolument, et il était important d’entendre une pluralité d’opinions. Je suis d’accord avec le fait que la restitution ne soit pas une priorité. Bien qu’il s’agisse de notre identité culturelle et qu’il soit donc une nécessité impérieuse que les Africains et Africaines puissent en bénéficier, je suis d’avis qu’il y a des chantiers plus urgents à mener. Dans le débat certains rappellent, à juste titre, que la plupart des Béninois ne parviennent pas à assurer trois repas par jour à leur famille. Il faut l’entendre. Aussi, n’est-ce pas un peu obscène de parler de restitution quand tant d’africains perdent leurs vies en mer sur les routes de l’exil ? Il est plus qu’urgent qu’ils jouissent des mêmes droits de mobilité dans le monde que leurs semblables. En réalité, il n’y a qu’un seul et même impératif, celui de justice. Ce qui urge c’est de modifier en profondeur les consciences, c’est que soit transmise à la jeunesse son histoire, son histoire africaine. C’est l’arme la plus puissante disait Mandela. Les dirigeants africains et leurs gouvernements ont un immense travail à accomplir à ce niveau. Refonder et décoloniser le système scolaire. Permettre aux jeunes de redécouvrir leur histoire dans toute sa richesse et sa complexité. L’Égypte nègre de Cheikh Anta Diop, l’histoire des royaumes, nos héros, nos héroïnes, nos penseurs d’hier, nos intellectuels d’aujourd’hui, nos écrivain.es, nos cinéastes. Il faut dire qu’on a une histoire d’une richesse inouïe, la plus longue de l’Humanité ! Et pourtant la moins transmise et étudiée. C’est une catastrophe que la jeunesse (en dehors d’une élite) soit à ce point abandonnée à elle-même et coupée de cet héritage si puissant. Notre plus grande richesse en tant qu’africain.es, c’est notre culture. La déculturation était au cœur du projet colonial d’où l’importance de reprendre radicalement possession de notre culture.
Kirinapost: Le projet colonial est à déconstruire. Une génération consciente arrive. Elle doit être encouragée par l’éducation.
Mati Diop: Oui, une nouvelle génération émerge et c’est celle que j’ai voulu dépeindre dans Dahomey. Mais on ne peut pas juste compter sur l’intelligence ou la lucidité de cette jeunesse. Il faut que le gouvernement mette en place des choses concrètes pour elle. Sous Wade et Sall, la jeunesse a été abandonnée à elle-même. L’État a une forte part de responsabilité dans la mort des milliers de jeunes qui ont péri en mer en émigrant vers l’Europe. Je sais que le chantier est vaste et que les défis sont nombreux mais j’encourage vraiment ce nouveau gouvernement à faire de l’éducation une priorité.
Kirinapost: Est-ce avant ce film, que vous avez senti chez cette jeunesse africaine une sorte d’estime de soi ou bien Dahomey est un révélateur ?
Mati Diop: Je dirais les deux… Quand je commence un film, je suis guidée par mes intuitions, par des convictions. Il me semblait impératif d’entendre cette jeunesse béninoise estudiantine au sujet du retour des trésors de leurs ancêtres. Mais pour moi, c’était surtout l’opportunité inespérée d’interroger ces jeunes sur le rapport qu’ils entretiennent avec leur histoire, notamment avec l’héritage colonial, comment ils se situent aujourd’hui par rapport à ça, comment ils se projettent dans le futur. Où ils en sont avec toutes ces questions qui, moi aussi, à vrai dire, me travaillent et me hantent. En bref, où en sommes-nous ? Mon travail de metteur en scène, c’est de créer un espace de parole et d’écoute, de créer de réelles conditions d’échange pour faire émerger quelque chose de vrai, de solide. Quelque chose qui vienne d’eux-mêmes. Qui vienne de loin et qui impacte fort ! Ensuite à chaque spectateur de se faire son avis, son idée sur ce que cette séquence finale révèle de ces jeunes et d’aujourd’hui. Je pense comme vous qu’on assiste à l’émergence d’une génération qui s’interroge autrement sur son histoire et qui s’affranchit plus nettement de toute forme de domination néocoloniale. Ce processus d’émancipation, c’est ce que j’ai voulu capter dans Dahomey. Néanmoins, on voit bien que tous les jeunes qu’on entend dans le débat ne se ressemblent pas, que chacun a sa sensibilité propre. C’est comme un portrait qui transmet une humeur, un état d’esprit. Mais plus vous vous rapprochez du portrait plus vous découvrez des nuances, des variations de couleurs, des détails… On peut aussi le comparer à un chœur composé d’une multitude de voix avec chacun son grain, son timbre.
Kirinapost: Que voulez-vous que les africains, les sénégalais en particulier retiennent de Dahomey si vous deviez le résumer ?
Mati Diop: C’est toujours difficile de répondre à cette question parce qu’il y a une palette infinie de sentiments et d’émotions qu’un spectateur peut potentiellement ressentir en quittant une salle de cinéma. J’ai avant tout envie qu’ils vivent une expérience unique. Pour moi la plus belle chose qu’un film peut offrir à un spectateur c’est de libérer son esprit, de déconstruire, même un peu, sa façon de voir les choses, d’ouvrir son imaginaire. Certes, il y a en Afrique des chantiers plus urgents que celui de la restitution mais ça me semble quand-même important qu’un maximum d’africain.es prennent conscience de l’ampleur de l’absence de leurs biens culturels et qu’à travers le film, d’une façon ou d’une autre, ils reconnectent avec une partie d’eux-mêmes. Un film sert aussi à tendre un miroir aux spectateurs. J’ai envie que cette jeunesse se reconnaisse et se sente représentée. J’ai envie que tel jeune se dise, « Moi aussi je veux prendre une caméra ! Moi aussi je peux faire mon propre cinéma, raconter mes histoires à ma façon. » Transmettre aux autres le désir de s’exprimer eux-mêmes.
Kirinapost: Tony Morrison disait qu’elle n’écrivait pas pour les blancs mais plutôt pour les siens, pour les africains, pour les noirs. Où vous situez-vous par rapport à ce débat ? Cinéma « Africain »ou cinéma tout court par exemple ? Vous filmez pour qui ?
Mati Diop: Je me souviendrai toujours de l’avant-première d’Atlantique au Grand Théâtre de Dakar en 2019. Le film y était montré pour la première fois. J’étais assise parmi les spectateurs et spectatrices qui découvraient le film en wolof dans cette salle immense. Et moi je les observais en train de regarder le film. Je n’ai pas les mots pour décrire l’émotion qui m’a saisi. Je me suis dit « Voilà. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Voici à qui je m’adresse ». Quand j’ai commencé à faire des films, j’avais 24 ans. Le cinéma que je regardais et qui me nourrissait était principalement asiatique, américain et européen. J’ai absorbé tout ce que je pouvais et je me suis identifiée aux personnages de ces films bien au-delà de leur contexte culturel ou de leur couleur de peau. Jusqu’à ce que je prenne différemment conscience de la particularité de mon histoire et que je choisisse, en 2008 d’engager mon cinéma au Sénégal. À cette époque, j’avais le sentiment inquiétant que le cinéma africain était menacé de disparition, que depuis son « âge d’or », une nouvelle vague peinait à émerger. En dehors des films de Sissako qui ont beaucoup compté pour moi, le cinéma africain se faisait très rare. De toute façon, à l’époque, il y avait un désintérêt total pour tout ce qui venait d’Afrique ! Le monde s’en fichait complètement de nous… Ce constat était douloureux pour moi, je ressentais un malaise, une colère envers cette indifférence. 2008 c’est l’année des dix ans de la mort de mon oncle. J’ai eu besoin de réfléchir à l’héritage de ses films. Peu après l’indépendance du Sénégal, il a réussi, à travers Touki Bouki, à se réapproprier une langue africaine, je ne parle pas du wolof, je parle de langage. Lorsque je vois ce film, j’entends un message qui me dit : « Nous n’avons pas à nous libérer. Nous sommes déjà libres. » Et ça, c’est révolutionnaire. Réfléchir à l’héritage qu’il a laissé c’était aussi m’interroger sur ce que je voulais proposer à mon tour, en tant que cinéaste. Quel cinéma je voulais faire et défendre ? Quel sens je voulais donner à ma pratique ? Est-ce que je voulais faire des films en France ou bien tourner au Sénégal ? J’ai ressenti le besoin de partir en quête de mes origines africaines. J’ai commencé par réaliser et auto produire Atlantiques (le court métrage de 2009) qui dépeint des heures sombres de notre histoire, celle de la période « Barcelone ou la Mort ». À l’époque, la façon dont l’émigration clandestine était traitée par les médias de masse français me rendait malade. Je ne supportais pas ce regard misérabiliste, déshumanisant, colonial. Je ne supportais pas (elle appuie sur le mot). C’est à ce moment que j’ai choisi de mettre mon cinéma au service d’une réalité africaine que j’avais à cœur de représenter autrement, que j’avais à cœur de restituer. Restituer, c’était devenu vital pour moi. En tant que Française, j’avais facilement accès à des moyens pour entreprendre un film et j’avais aussi le luxe de me déplacer au Sénégal. J’ai mis ces quelques privilèges au service d’une démarche qui me semblait juste à défendre, celle de créer du contre-récit. J’ai choisi le cinéma comme outil politique, comme outil décolonial. Il y avait aussi dans ma démarche le besoin vital de me défaire d’une certaine emprise occidentale, de me décentrer de la France.
Kirinapost: Et encore ?
Mati Diop: Ensuite, j’ai abouti le projet Mille Soleils qui enquête sur l’héritage personnel et collectif de Touki Bouki. Je devais passer par là, revenir à la source de mon histoire familiale et cinématographique. Consacrer un temps de réflexion à ce chef-d’œuvre pour mieux m’en inspirer, pour mieux m’en affranchir. J’ai consacré quasiment dix ans de réflexion à Atlantique (2019). Je tenais à consacrer un film de cinéma à cette jeunesse sénégalaise disparue en mer. J’ai longtemps été hantée par ce drame, j’avais besoin d’exorciser quelque chose à travers ce film. Une colère, une tristesse, un deuil. J’ai mis toute ma vie dans ce film. Lorsqu’il a reçu le Grand Prix à Cannes, j’étais complètement sonnée car je ne m’attendais pas à ça. Je ne cherchais pas cette lumière. Et en même temps, c’est là que j’ai compris qu’à travers la réalisation de ce film, j’accomplissais une mission. Celle de continuer à faire exister un certain cinéma africain. Raconter nos histoires. Briller sur la scène du cinéma mondial. Mais alors… est-ce qu’Atlantique est du cinéma « africain », du cinéma « sénégalais », du cinéma français ou franco-sénégalais ? On voit bien que ces terminologies deviennent vite absurdes et que d’un contexte à l’autre, le sens varie. Ce qui est certain, c’est que je suis une cinéaste franco-sénégalaise. Quant à mes films, ils ne sont peut-être ni français ni sénégalais mais tout simplement hybrides. Créoles. En tout cas, ils parlent du monde depuis l’Afrique.

« L’État a une forte part de responsabilité dans la mort des milliers de jeunes qui ont péri en mer en émigrant vers l’Europe » © Liberation portrait de Mati Diop à Paris, le 7 septembre 2024.
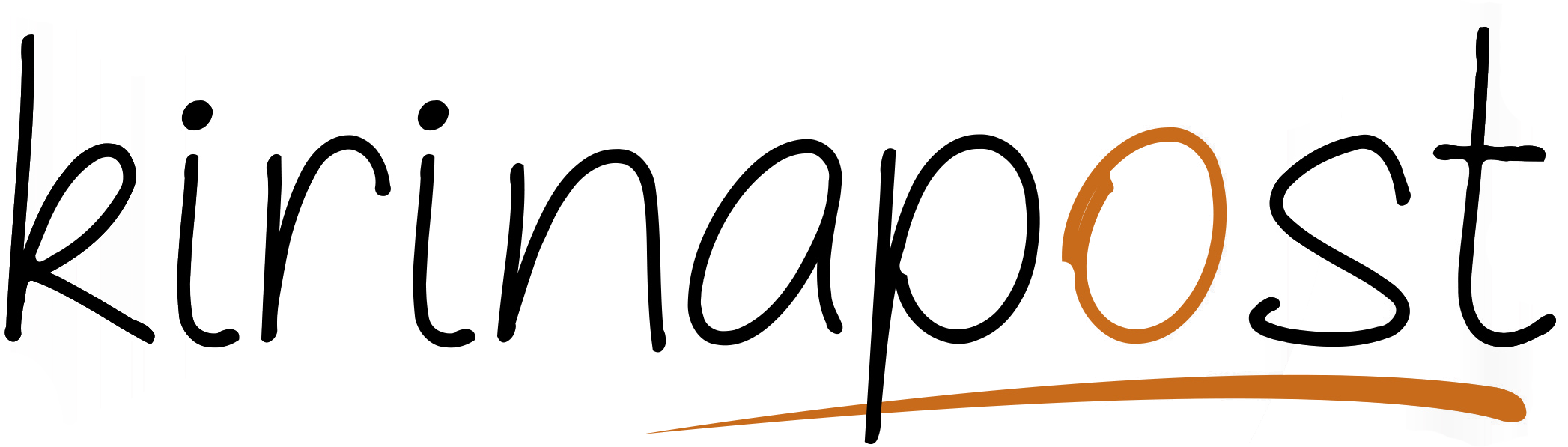










Laisser un commentaire