Si histoire est « processus », mémoire est « fait accompli »… ou la traversée à gué…. »j’ai complètement changé d’avis au bout d’une semaine de séjour à Nyamirambo. » Boubacar Boris Diop, Murambi, Le Livre des Ossements, éditions Flore Zoa, 2022, p. 264 [postface]. À l’occasion de la cérémonie commémorative Kwibuka 31, (31ème du nom), j’ai eu l’honneur, en tant qu’historien, de prendre part à un panel intitulé : « La résilience du peuple Rwandais face à l’idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs »… Voici mon texte.

De Gauche à d : Madame Berthilde Gahongayire, Directrice régionale de ONUSIDA, Docteur Fodé Ndiaye ancien Coordonnateur-Résident du Système des Nations Unies, Abdarahmane Ngaïdé, historien, mention spéciale au personnel de l’ambassade du Rwanda pour l’organisation et la modération du panel.
Apprendre une autre façon d’être un être humain.
…Merci bien…
Je me représente,
Je m’appelle Abdarahmane Ngaïdé. J’ai désormais… et toujours… l’habitude de rappeler aussi que je suis d’origine mauritanienne. Et nous sommes au mois d’avril, aujourd’hui !
En avril 1989, s’est produit un événement dramatique entre la Mauritanie et le Sénégal, connu sous le nom d’événements Sénégalo-Mauritaniens. Je suis obligé d’en parler puisque je suis le résultat exact de cette tragédie. Je vis au Sénégal et je suis devenu sé-né-galais, apprenant donc une autre façon d’être un être humain.
Lorsque je suis arrivé (en septembre 1989) ici, on m’a dit qu’il y avait le « Niit njaay ». Je ne savais pas ce que c’était un « Niit njaay ». Au fil-du-faire, je me suis rendu compte que « Niit njaay » ne pouvait être que la traduction parfaite de l’être transcendental…c’est-à-dire, celui auquel nous aspirons, pour taire nos différences et ainsi égaliser tous les « angles d’incohérence » qui génèrent les conflits.
J’ai eu la chance de visiter le Rwanda en janvier 2024. Je n’étais pas parti vérifier ce que j’entendais déjà, mais j’étais parti plutôt apprendre quelque chose de nouveau par rapport à moi-même, en tant que Abdarahmane, individu, ayant vécu un « processus » qui aurait pu déboucher sur le « fait accompli » que j’ai constaté à Murambi.
J’ai eu l’opportunité d’être intégré dans un film-documentaire commémorant les 30 ans du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda. Un film-documentaire, à venir très bientôt, réalisé par mon jeune frère Papa Alioune Dieng… et qui m’a choisi comme fil rouge du documentaire. C’est certainement pourquoi, je continue d’arborer mon foulard rouge, représentatif du sang qui coule sans aucune raison. (Toutes nos pensées vont vers les victimes et les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda.)
Donc, c’est cette légitimité-là, qui me fait prendre la parole ici en ce jour de commémoration. Je rappelle que je souhaitais démarrer – cette année – un cours en Master sur l’histoire des génocides dans le monde à partir du cas rwandais. L’idée est déjà dans le pipeline, reste sa faisabilité.
Du processus au fait accompli… aller au-delà du syndrome du trauma
Maintenant, je deviens historien…
Je viens de vous dire tout à l’heure que j’étais plongé moi-même dans un processus qui aurait pu aboutir à sa finalité.
Par conséquent, si, en tant que « victime » d’une certaine histoire, ayant cheminé en tant qu’historien, je ne peux pas apporter quelque chose de nouveau, de critique et de réfléchi, par rapport aux conflits que nous vivons dans nos pays, c’est que j’aurai échoué dans ma mission humaine.

Un public nombreux a pris part à la journée internationale dédiée au génocide des Tutsi
Il ne s’agit pas de transmettre une mémoire fracturée, sur laquelle viendraient peser plus les sentiments que la réflexion. Il est vrai que souvent chez nous, on nous enseigne que « les mots ne nourrissent pas. »
Certes les mots… en tant que « m, o, t, s »… ne nourrissent pas, mais ce sont ces mêmes mots qui ont la faculté de détruire toute entreprise. N’eût été la dévalorisation de l’humain, jusqu’à l’assimiler à un insecte, le génocide n’allait pas avoir lieu.
À partir de là, le premier enseignement que nous devons prodiguer est le retour au langage de la conversation utile et qui renforce les intercompréhensions… et pas à celui qui accentue les différences sociales.
Tant que nous n’investirons pas nos efforts dans un langage apaisé et constructeur, dans nos sociétés, en pesant les mots par lesquels nous nous désignons d’abord et nous désignons… ensuite, nous ne pourrons jamais appréhender notre propre environnement social.
Je peux dès lors, en tant qu’historien, établir un parallélisme entre le « processus » vécu en Mauritanie et le « fait accompli » constaté à Murambi, sans exagération de ma part et sans prétention de les comparer, parce qu’ils ne sont pas comparables !
L’enseignant que je suis peut s’appuyer sur ce parallélisme pour mieux arriver à cerner ce que c’est que la mémoire et ce que c’est que l’histoire.
Si nous voulons transmettre réellement les vécus historiques, en les rendant plus productifs – et pas du tout pour faire naître de nouveaux sentiments de haine ou de vengeance – nous devons certainement apprendre à comprendre tous ces détails qui complexifient davantage les relations inter-individuelles, car la proximité de nos communautés n’est pas à vérifier.
Mais comment se fait-il que ce qui existait auparavant entre Tutsi et Hutu et qui permettait de consolider les liens inter-communautaires et l’évolution sociale s’est rompu, à ne point peser comme une véritable mémoire constructive. Mémoire qui doit pouvoir permettre aux communautés d’être ensemble et de vivre dans la paix et la concorde.
L’histoire ne donne pas de leçon :narrativité, écriture experimentale, fiction et réalité.
Cela étant dit, j’ai prononcé un jour une chose qui peut être dangereuse pour l’historien que je suis : « l’histoire ne donne pas de leçon ! »
Je vais vous dire un peu pourquoi. Aujourd’hui, nous assistons à un processus génocidaire à Gaza. Et pourtant, le peuple juif a une leçon de mémoire qu’il impose au monde. Mais la leçon la plus importante semble avoir disparu : l’humanité qui a permis de reconstruire la communauté juive, jusqu’à la mettre dans un territoire.
Je crois que cela fait partie des éléments que nous devons surveiller pour qu’on puisse faire attention… même si la « théorie génocidaire » reprend forme… pour ne pas être piégé par notre propre mémoire. En survalorisant notre histoire, nous attaquons notre propre mémoire et sa faculté de produire quelque chose de « comestible » pour l’ensemble des communautés qui nous constituent.
Pour diffuser et « imposer » la grande leçon qui nous vient du Rwanda, il va falloir que nous, Africains, reprenions conscience que les sciences humaines, comme les sciences sociales, la littérature et la poésie sont nécessaires pour justement vulgariser les éléments clefs qui entrent dans la constitution d’une mémoire partagée…au-delà de toutes considérations. L’histoire, en tant que telle, en tant que science, ne passe pas…parce que nos mots sont souvent incompris.

Le ministre de l’intérieur, le Général Jean Baptiste Tine et Son Excellence Festus Bizimana, ambassadeur du Rwanda ont déposé une gerbe au Mémorial du génocide des Tutsi au Rwanda sis à la Place du Souvenir Africain à Dakar
En vue de transmettre davantage l’esprit qui nous vient du Rwanda, nous devons multiplier l’éventail des supports didactiques…c’est ainsi que nous pourrons prétendre…ensemble…faire advenir la leçon principale: la revalorisation de l’être humain et la mise en perspective d’une société nouvelle capable, non pas de taire ses conflits, mais de ne pas arriver à l’extrême.
Merci pour votre écoute et votre patience !










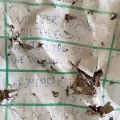
Laisser un commentaire