Dr. Alex Mvuka est analyste politique sur la région des grands lacs et directeur du Centre de Recherches et d’Analyses sur la Région des Grands Lacs.
Dr. Alex Mvuka• Les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) qui sont une milice génocidaire rwandaise opérant en République Démocratique du Congo (RDC), demeurent une pomme de discorde majeure dans le conflit opposant Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises soutiennent que ce groupe, formé des auteurs et de la progéniture des auteurs du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda, sert de prétexte aux interventions rwandaises en RDC. Et d’ajouter que Kigali procède au recyclage d’anciens membres de cette milice génocidaire – soumis à son joug – pour les redéployer sur le territoire congolais afin de justifier indéfiniment sa perpétuelle agression.
Le Rwanda a toujours nié ces accusations, avançant que cette milice génocidaire à laquelle les régimes successifs en RDC ont offert gîte et couvert et en ont fait leur bras armé, demeure une menace sérieuse pour la sécurité de toute la région des Grands Lacs.
À travers cet article, je tiens tout d’abord à souligner que la dynamique du conflit des FDLR en RDC est complexe, mal comprise et souvent délibérément mal interprétée. Par conséquent, il n’est pas aisé d’appréhender ni d’expliquer les transformations et les alliances changeantes au gré des intérêts de cette milice.
Soucieux d’apporter un peu de lumière à ceux qui se perdent dans les méandres nébuleux du phénomène FDLR, je présente, à travers cet article, des éléments factuels fondés sur la géopolitique de la région des Grands Lacs.
Deuxièmement, je tente de démontrer à quel point les combattants FDLR bénéficient de vastes réseaux locaux et de nombreuses ressources qui alimentent et encouragent leurs activités. Troisièmement, je me fais le devoir de démontrer que cette milice n’est pas simplement un acteur du conflit. Elle est devenue une idéologie intégrée aux systèmes politique, culturels et sécuritaire de la RDC.
Le concept FDLR
À la suite du génocide des Tutsi en 1994, plus de deux millions de réfugiés rwandais se sont déversés à l’est de la RDC. Parmi eux figuraient des centaines de milliers de membres de l’armée du régime génocidaire déchu du Rwanda, les Forces Armées Rwandaises (FAR), ainsi que des milices associées, dont les Interahamwe. Ces derniers ont perpétré ce qui a été décrit comme les tueries les plus brutales et les plus rapides de l’histoire moderne de l’humanité.
Aujourd’hui, les FDLR recrutent parmi les groupes armés locaux (adhérant à l’idéologie anti-Tutsi) en RDC et parmi les réfugiés hutus rwandais intégrés (jusqu’à l’assimilation) aux communautés congolaises de l’est du pays. Elles utilisent les réfugiés et les civils congolais comme boucliers humains et transforment les camps de réfugiés en sanctuaires et en bases de recrutement.
Leur mission idéologique est de renverser le pouvoir dirigé par le Front patriotique rwandais (FPR) à Kigali, de restaurer un pouvoir fondé sur la suprématie ethnique hutu et de perpétrer la propagation de l’idéologie génocidaire anti-Tutsi dans la région. L’objectif est de créer ce qu’ils appellent une « terre hutu ». De nombreux observateurs et témoins affirment que les FDLR sont responsables de graves violations des droits humains, notamment des attaques armées ciblant des femmes et des enfants, en recourant à des formes extrêmes de meurtre visant à infliger douleur et souffrance à leurs victimes. Plusieurs rapports crédibles indiquent également que ce groupe est responsable de violences sexuelles et de déplacements forcés de populations. En 2015, ce groupe a été accusé d’avoir formé et encadré la jeunesse du parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, en particulier la branche « Imbonerakure », suscitant la crainte d’un possible et imminent génocide au Burundi et poussant des milliers de Tutsi Burundais à fuir vers les pays voisins.
Très actif en RDC, les FDLR opèrent comme un groupe « fourre-tout » avec un double objectif : le changement du régime au Rwanda et l’extermination des Tutsi dans la région des Grands Lacs. Loin d’être un simple groupe d’individus ou un réseau, les FDLR fournissent un cadre de croyances, de principes et d’objectifs idéologiques que les acteurs politiques anti-Tutsi et anti-Rwanda utilisent pour légitimer leurs discours de haine et mobiliser la masse.
L’importance des bases de recrutement des FDLR
Suite à l’afflux massif de réfugiés rwandais au Zaïre voisin (aujourd’hui RDC) en 1994, environ un million de personnes se sont installées dans les camps de Mugunga et de Kibumba, près de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Ces deux camps ont attiré l’attention des journalistes internationaux, des pays occidentaux, du gouvernement congolais et des Nations Unies. Mais d’autres camps, considérés comme secondaires et par conséquent moins médiatisés, ont accueilli des centaines de milliers de personnes aux profils variés. La première catégorie comprenait l’élite et la classe moyenne, dont beaucoup ont quitté leur pays d’accueil initial pour trouver un asile dans d’autres pays africains comme la Zambie ou le Cameroun. La seconde catégorie comprenait les soldats (environ 35 000) et les membres de la milice génocidaire Interahamwe (estimés entre 80 000 et 100 000). Nombre d’entre eux sont restés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, bénéficiant initialement du soutien de la France, avant de s’allier à des groupes armés locaux et à l’armée congolaise.
Ils ont été répartis au Nord Kivu dans les camps tels que Katale, Kahindo, Kibumba, Mugunga, Lac Vert, et au Sud Kivu dans différents endroits tels que Kasha, Kalehe, INERA 1 & 2, Birava, Ijwi, Kashusha, Nyantende, Nyangezi, Chimanga, Kamanyola, Lubarika, Kanganiro, Luvungi, Sange, Kajembo, Kibogoye, Rwenena, Kiliba, Kanvivira, Munanira, Biriba et Kagunga. Ces combattants opéraient avec d’autres milices locales relativement moins structurées mais lourdement armées, entraînant une insécurité et une instabilité chroniques dans toute la région. Dans ce contexte d’anarchie, d’autres réfugiés ont été utilisés comme boucliers humains et réduits au silence.
Avec l’avènement et l’avancée spectaculaire des troupes de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) à l’automne 1996, ces camps ont disparu. Environ un million de ces réfugiés sont retournés au Rwanda. Plus d’un demi-million d’autres sont restés et se sont assimilés à la population congolaise, notamment au Nord et au Sud-Kivu, où le contexte sociologique est plus proche de celui du Rwanda.
Des localités comme Tongo et Kisheshe ont été principalement peuplées de ces réfugiés rwandais et continuent, jusqu’à ce jour, de servir de viviers de recrutement pour les FDLR. D’autres réfugiés, au nombre de plusieurs centaines de milliers, ont pris trois directions : (1) Bumba (province de l’Équateur) et Lukolela via Kisangani ; (2) vers le Congo-Brazzaville ; ou (3) vers les forêts d’Itombwe autour de Mwenga, au Sud-Kivu. Récemment, environ 4 000 anciens réfugiés rwandais ont été repérés à Rurambo, dans le territoire d’Uvira.
La RDC : un terreau fertile pour les FDLR
Pendant la guerre menée par le Front patriotique rwandais (FPR) de 1990 à 1994, la société civile de l’est du Zaïre s’est distinguée par son soutien indéfectible au régime rwandais de Juvénal Habyarimana, qu’elle considérait comme un « frère ». Son parti, le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), s’était établi et profondément enraciné dans la société zaïroise, notamment au Kivu, où il a trouvé un terreau fertile pour étendre son influence idéologique. Autant dire que déjà avant 1994, sa propagande anti-Tutsi avait pénétré et gagné les âmes d’une bonne partie de la société congolaise.
L’influence idéologique anti-tutsi exercée par le MRND a eu le mérite de constituer un effet d’aubaine pour la classe politique zaïroise. Dès lors, les idées promues par les Interahamwe – qui se sont par la suite mués en FDLR – ont bénéficié d’un large soutien de plusieurs leaders politiques zaïrois. Les acteurs populistes du Nord et du Sud-Kivu ont intégré le narratif popularisé par le MRND, imposant ainsi ses marques dans l’imaginaire collectif congolais, y compris auprès de certaines figures religieuses, notamment pendant la Conférence Nationale Souveraine, CNS (1990-1992). Ce forum national qui était censé trouver des pistes politiques pour se débarrasser de la dictature du Maréchal Mobutu, s’est rapidement transformé en un théâtre de discrimination où des orateurs talentueux se sont succédés à la tribune pour démontrer la non « congolité » des Tutsi et décider de leur extradition vers le Rwanda. Deux ans avant le génocide au Rwanda, les délégués à la CNS ont recommandé l’expulsion forcée de tous les Tutsi congolais, présents depuis des siècles en RDC. Le moins que l’on puisse dire est que le CNS s’est transformé en un procès public contre les Tutsi. Et lorsque le FPR a pris le pouvoir à Kigali, le gouvernement congolais a refusé toute coopération bilatérale avec son voisin, tandis que la société civile s’obstinait à nier l’existence d’un génocide contre les Tutsi au Rwanda. Ainsi, une rhétorique génocidaire soutenant que “les Tutsi sont un peuple dangereux” érigeant domicile en RDC.
Dès 1995-1996, l’idéologie anti-Tutsi s’était institutionnalisée. Les Tutsi congolais étaient expulsés vers le Rwanda, tandis que Kinshasa accueillait des réfugiés hutus rwandais dont les militaires (ex-FAR) et les miliciens Interahamwe étaient autorisés à conserver leurs armes. Au Sud Kivu, les tutsi congolais Banyamulenge étaient autorisés à sortir du pays, mais jamais d’y retourner. De plus, leur sortie du territoire national ne pouvait se faire que sous escorte de l’armée, qui profita de la situation pour les dépouiller de leurs biens. Les discours populaires et publics étaient faits pour les pousser à l’exil. Plus aucun document administratif ne pouvait leur être délivré. Leurs déplacements à l’intérieur du pays devinrent un cauchemar, et même les hôtels reçurent l’ordre de ne pas les accepter. À cette époque, la campagne de déportation et des assassinats dont ils étaient victimes avaient déjà commencé et prenaient de l’ampleur. Depuis lors, les Tutsi congolais sont perçus non seulement comme des ennemis de la RDC, mais aussi comme des « infiltrés ». Plus grave encore, alors que la RDC rejetait ses propres citoyens en raison de leur appartenance ethnique tutsie, les agences humanitaires locales et internationales créaient des conditions favorables à l’accueil des réfugiés rwandais, tout en excluant tout recrutement de sujets tutsi comme employés au sein de leurs agences. Un système officiel d’échange, ou plutôt de remplacement de populations était ainsi créé : les Hutus du Rwanda étaient les bienvenus au Zaïre, tandis que les Tutsi Zaïrois devenaient « persona non grata » dans leur pays et étaient ainsi destinés à la déportation vers le Rwanda.
Les organisations zaïroises de défense des droits humains sont restées silencieuses face à cette pratique éhontée de nettoyage ethnique qui se déroulait sous leurs yeux. Les églises ont également joué un rôle actif de bons samaritains, accueillant et facilitant l’installation des réfugiés hutus rwandais. Malheureusement, elles ont contribué intellectuellement à rendre leurs frères tutsi apatrides. Le FPR étant perçu comme un parti politique dirigé par les Tutsi, tandis que l’ancien président Juvénal Habyarimana ait été « vaincu », une sympathie généralisée s’est développée au sein de la société congolaise pour les réfugiés rwandais (civils et combattants). La société civile et les responsables gouvernementaux ont ignoré le fait que nombre de ces réfugiés avaient participé au massacre d’un million de personnes au Rwanda. Tous les camps de réfugiés mentionnés ci-dessus – à l’exception de quelques-uns situés dans la plaine de la Ruzizi – étaient placés le long de la frontière entre le Rwanda, leur pays d’origine, et la RDC, leur pays d’accueil. Cet emplacement géographique leur offrait un accès facile aux zones ciblées pour leurs infiltrations offensives au Rwanda. Ils pouvaient ainsi opérer librement et en toute impunité. Le comble, c’est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui était chargé de coordonner leur installation. C’est dans ce contexte politique et social qu’est née l’AFDL.
Les alliances idéologiques
Peu avant le génocide de 1994, la RDC (alors appelée Zaïre) a apporté un soutien politique, diplomatique et militaire massif au régime génocidaire rwandais. Les Forces Armées zaïroises (FAZ) ont participé à la guerre contre le FPR, mais ont subi des revers importants et humiliants, se livrant, dans leur frustration à des pillages lors de leur retrait vers le Zaïre. Par la suite, elles ont permis aux troupes rwandaises fuyant leur pays de s’installer à l’est et ont contribué de manière significative à la campagne diplomatique de soutien au régime de Habyarimana contre le FPR.
En 1994, l’ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, a soudainement pris conscience que l’Occident, autrefois son principal soutien, travaillait pour sa marginalisation sur la scène politique internationale. La fin de la guerre froide l’avait rendu moins utile aux yeux de ses anciens alliés. La catastrophe humanitaire des réfugiés rwandais dans l’est du Zaïre est alors devenue pour Mobutu une opportunité et un levier politique pour regagner une place au sein de la communauté diplomatique internationale. Ainsi il envisagea, soit de relancer une guerre contre le FPR, soit de former une coalition avec l’armée française pour utiliser les réfugiés rwandais armés afin d’attaquer le Rwanda.
Mobutu initia alors une collaboration avec le général Augustin Bizimungu, ancien chef d’état-major de l’armée du régime génocidaire rwandais défait. Bizimungu disposait d’au moins 35 000 hommes armés sur le territoire zaïrois. Le Chef d’État zaïrois a mis en place trois options.
Mis en place des trois options de Mobutu
La première option consistait à fournir un soutien militaire à Bizimungu et à ses 35 000 hommes pour attaquer le nouveau gouvernement du FPR à Kigali. Pour Mobutu, cette stratégie permettrait de regagner la sympathie de la France, et potentiellement celle d’autres membres de la communauté internationale. Bizimungu bénéficierait non seulement d’une base stratégique (zone de repli en cas d’échec de la reconquête), mais aussi d’infrastructures et des moyens mises à sa disposition.
La deuxième consistait à expulser de force les Tutsi congolais, créant ainsi une crise humanitaire inverse susceptible de mobiliser un soutien politique interne et d’atténuer la pression américaine en faveur d’un processus de démocratisation.
La troisième option sur la table de Mobutu était celle proposée par Bizimungu : organiser un autre génocide en RDC, ciblant cette fois les Tutsi congolais afin de s’emparer de leurs terres. En combinant ces trois stratégies, une crise d’identité ethnique a été déclenchée dès 1995, avec la participation active d’éléments ex-FAR et des milices Interahamwe, soutenus par l’armée de Mobutu. Par conséquent, des milliers de Tutsi congolais ont été soit déportés de force, soit contraints de fuir uniquement vers le Rwanda. Ces événements et leurs conséquences ont agi comme catalyseurs de la guerre de l’AFDL, également connue sous le nom de Première guerre du Congo, qui a conduit à la chute du dictateur zaïrois.
L’instauration d’une paix durable dans la région des Grands Lacs est l’éradication des idéologies racistes et génocidaires
Pendant la guerre de l’AFDL, les anciens soldats des FAR et les milices Interahamwe ont activement collaboré avec l’armée nationale congolaise. Ce schéma d’alliances militaires s’est poursuivi lors de la seconde guerre du Congo en 1998 et sous d’autres régimes successifs, avec une intégration significative des FDLR au sein de l’armée nationale. De nombreux membres des FDLR ont changé leurs noms pour adopter des noms congolais courants tels que Kasereka, Paluku, Mulumba ou Mbuyi. D’autres ont rejoint des groupes armés locaux. Par exemple, à Kalehe, l’un des commandants en chef est le colonel Mbangu. Pendant le génocide de 1994 contre les Tutsi, Mbangu était un chef Interahamwe à Nkombo, dans le district de Rusizi au Rwanda. La milice génocidaire rwandaise entretient désormais une collaboration étroite avec de nombreux groupes armés congolais et avec l’armée nationale congolaise (FARDC). À ce jour, l’armée nationale congolaise compte de nombreux officiers issus de la cohorte des réfugiés rwandais de 1994 et le phénomène actuel des Wazalendo trouve en partie ses racines dans l’idéologie génocidaire des FDLR.
Les dynamiques des FDLR sont complexes et doivent être analysées à travers ses sources d’approvisionnement et l’environnement favorables qu’il trouve en RDC. Aujourd’hui, plus d’un demi-million d’anciens réfugiés rwandais sont assimilés à la société congolaise. Les combattants FDLR issus de ces communautés ont été intégrés dans les institutions sécuritaires congolaises.
Bien qu’ayant été affaiblies à plusieurs reprises, les FDLR restent capables de se reconstituer en recrutant parmi les réfugiés rwandais de 1994 et leurs descendants. Elles se sont développées à la fois comme une idéologie et un groupe mobilisateur, structurés autour d’alliances mythiques fondées sur l’idée de résistance contre un « empire hima » porté par le « peuple hamitique » pour dominer ce qu’elles appellent la « race bantoue ». Il est important de rappeler qu’adhérer aux FDLR ne signifie pas appartenir formellement à une organisation, mais plutôt à prêter allégeance à un ensemble de croyances, de valeurs (ou plutôt d’anti-valeurs) et d’idées – et donc, à une idéologie – qui motive les actions de ses membres et de leurs alliés. Autrement dit, les différentes visions du monde et les récits partagés jouent un rôle déterminant. L’une des conditions essentielles à l’instauration d’une paix durable dans la région des Grands Lacs est l’éradication des idéologies racistes et génocidaires, qui alimentent le cycle récurrent de violence dans cette partie du continent.




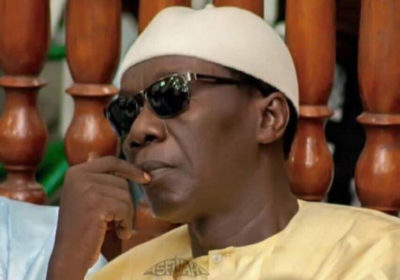
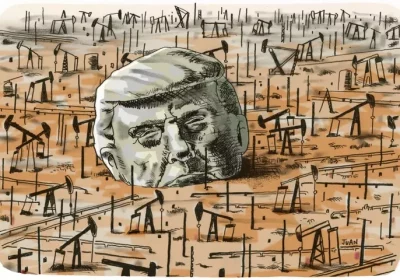





Laisser un commentaire