L’ouvrage de Grégoire Chamayou, La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire aux Editions lafabrique.fr se propose de déceler dans les conflits politiques et sociaux des années 1970 aux États-Unis les racines théoriques et pratiques du libéralisme contemporain. Ce dernier y est défini en termes foucaldiens comme un « art de gouverner» (p. 9) intrinsèquement hostile à la démocratie, construit et s’imposant par tout un arsenal d’outils politiques, militaires, juridiques, idéologiques et économiques, en réaction aux mouvements sociaux dénonçant le fonctionnement interne et l’impact public de l’entreprise privée capitaliste. L’analyse de cette répression polymorphe des mouvements sociaux permet ainsi à l’auteur de soutenir que le libéralisme est fondamentalement autoritaire, au sens où son fonctionnement requiert des formes d’interventions étatiques anti-démocratiques et violentes.
Source: journals.openedition.org
Si cette réaction aux mouvements sociaux s’est jouée sur différents terrains, c’est celui de l’entreprise privée qui retient ici l’attention de l’auteur et constitue l’objet principal de l’ouvrage. Il souligne à juste titre que cette dernière, institution centrale du monde contemporain, retient pourtant peu l’attention de la philosophie, mieux armée pour étudier le pouvoir d’État et la souveraineté politique que le « gouvernement privé » (p. 10), c’est-à-dire les rapports de pouvoir, les conduites et les formes de subjectivité qui naissent dans l’entreprise et dans les domaines de la vie humaine sur lesquels elle agit. L’ouvrage se présente ainsi comme une contribution bienvenue à une « philosophie critique de l’entreprise » (p. 11) que l’auteur appelle de ses vœux, et qui analyserait les concepts centraux de la « pensée économique et managériale dominante » (p. 11). Dans la lignée des travaux de Luca Paltrinieri en France et des Critical Management Studies anglo-saxonnes, la volonté de définir et d’historiciser l’entreprise est aussi l’occasion pour l’auteur de proposer un dialogue dynamique entre la philosophie et les sciences sociales.
Grégoire Chamayou fait le choix d’étudier une « situation » (p. 10), c’est-à-dire un ensemble de programmes, stratégies, interrogations et analyses formulés au sein de ce qu’il nomme le « monde des affaires » états-unien, plutôt qu’un corpus de textes choisis parmi les théoriciens du néolibéralisme qui donnerait à cette doctrine la fixité et la cohérence des tables de la loi. Cette méthode originale qui consiste à étudier aussi bien les théories de Carl Schmitt ou Friedrich Hayek qu’un ensemble riche et éloquent de « sources grises » – publicités, manuels de management, conférences et codes de conduite rédigés par les entreprises – permet de dessiner par petites touches un portrait idéologique et philosophique du libéralisme contemporain. Il s’agit, en somme, d’une entreprise généalogique à la manière dont Michel Foucault la définit. L’auteur prend ainsi au sérieux l’idée que notre présent est fils de la « discorde », du « disparate », de luttes et d’accidents qui permettent, si on en retrace le chemin embrouillé et complexe, de saisir sa vérité, sa contingence et sa possible transformation. Cette « fresque historico-philosophique » (p. 136) permet de mettre en avant l’hétérogénéité idéologique de la classe dominante en même temps que sa capacité à défendre des intérêts communs. À ce titre, l’ouvrage livre une approche intéressante, bien qu’indirecte, de la notion de classe sociale, qui sollicite autant Karl Marx et Antonio Gramsci que Pierre Bourdieu ou Michel Foucault.
L’ouvrage s’organise en six parties qui sont autant de fronts sur lesquels le monde des affaires a eu à se situer en mettant en place des réponses doctrinales et pratiques aux attaques qui lui étaient faites.
La première partie s’attache à définir la nébuleuse de réponses à ce qui est alors identifié comme une crise de la docilité des travailleurs dans un contexte de plein emploi et de forte syndicalisation. Chamayou met essentiellement en lumière deux types de réaction du monde des affaires qui, pour différentes qu’elles soient sur le plan doctrinal, se combinent efficacement en pratique.
D’un côté, on voit émerger et se diffuser un arsenal discursif qui accuse le travail (son coût, la conduite des travailleurs et la position de force des syndicats) d’être responsable de la crise et de la baisse du taux de profit, et un ensemble de réponses disciplinaires. De l’autre, on voit se développer toute une rhétorique participative qui critique les syndicats au nom de la démocratie et prône un nouveau management à même de faire converger les intérêts du travail et du capital. L’auteur montre ainsi que la responsabilisation, la participation directe, individuelle et dialogique, plutôt que syndicale et agonistique s’inscrivent dans une « stratégie de l’engagement » (p. 22) obéissant aux mêmes objectifs et soumises aux mêmes intérêts matériels que les mesures disciplinaires. Il décrit en effet l’imbrication de formes douces misant sur l’engagement volontaire des travailleurs et de formes répressives visant à les discipliner par la peur et le contrôle, afin de restaurer un rapport de force en faveur des classes dominantes. On peut néanmoins regretter l’absence d’une analyse plus poussée des cadres conceptuels de ces différentes « stratégies », dont la superposition est particulièrement d’actualité. Une telle analyse aurait peut-être permis de préciser la teneur de leurs affinités idéologiques et leur dimension « stratégique ». Suite ici...journals.openedition
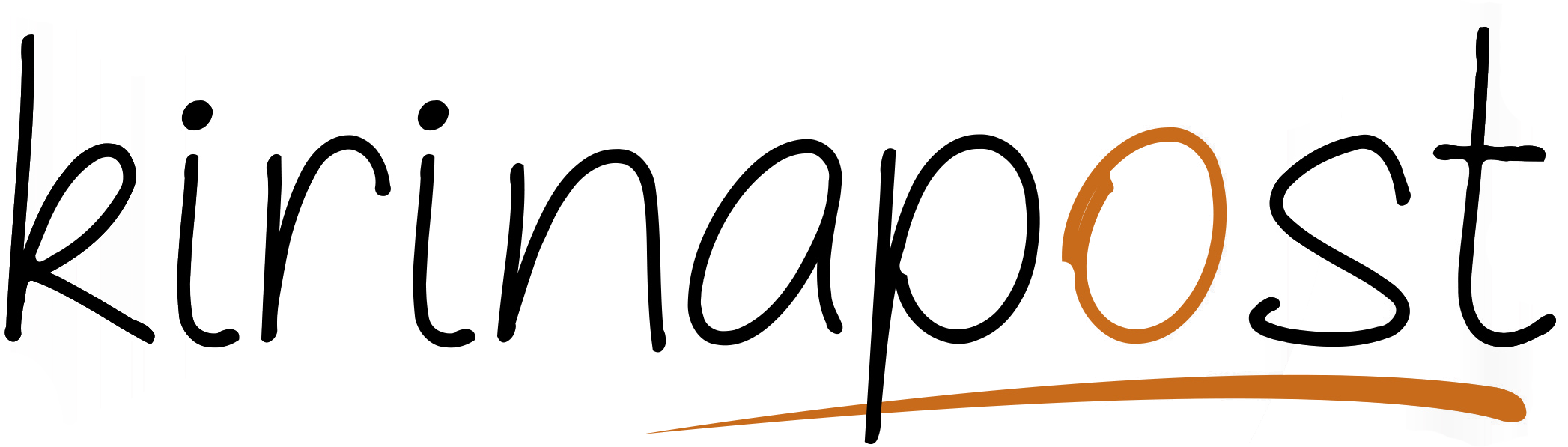



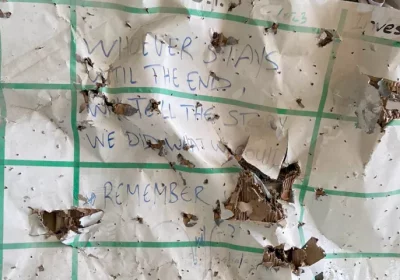






Laisser un commentaire