Les devenirs africains sont au cœur des débats sur le continent. 60 ans après les indépendances, comme des marronniers en journalisme, les mêmes sujets reviennent continuellement. Franc CFA ou pas Franc CFA, langues nationales ou langues de l’ancien colon, enracinement ou ouverture, pour n’en citer que quelques-uns. En toile de fond, toujours, l’émancipation de l’Afrique. Parmi les intellectuels et penseurs contemporains qui interviennent le plus souvent sur la nécessité pour le continent de se prendre en charge, figure en bonne place Boubacar Boris Diop. L’écrivain nous a reçu dans les locaux de la maison d’édition en langues nationales, EJO, fondée il y a trois ans avec quelques amis. Dans cette première partie de notre entretien, Boris Diop parle des limites d’une langue d’emprunt et raconte d’où lui vient cette prise de conscience de la place à accorder aux langues nationales pour quelqu’un qui a atteint la reconnaissance et la notoriété avec ses ouvrages en français.

Bubakar Bóris Jóob en wolof ©Mame Moussa Sock
« On appelle nos pays des pays francophones, anglophones ou lusophones malgré le fait que 70 ou 80% des populations ne parlent pas ces langues. 80% de la population sénégalaise parle le wolof. Pourtant on ne dit pas que le Sénégal est wolofone mais francophone à mon avis, c’est un abus de langage. » Ces propos du regretté Joseph Ki Zerbo pourraient être repris à son compte par Boubacar Boris Diop tant le penseur sénégalais œuvre pour la valorisation des langues de notre pays.
EJO pour valoriser les langues africaines
Justement, c’est pour donner toute sa place à ces langues, que l’ancien professeur de philosophie a lancé EJO-Éditions. Le mot EJO veut dire en kinyarwanda « hier et demain». Un nom d’une originalité remarquable, très séduisant pour un panafricain mais aussi pour l’auteur de Doomi Golo, un livre sur ce qu’il appelle, avec un sourire entendu, « la petite guerre que se mènent dans la fiction romanesque toutes les dimensions du temps ».
C’est dans les murs de EJO, plus précisément dans l’espace qui porte le nom de Mame Younousse Dieng – auteure en 1996 de Aawo bi, le tout premier roman en langue wolof, publié par les Editions OSAD – que Boubacar Boris Diop nous reçoit. Sans protocole, accueillant et courtois, il nous fait visiter cet agréable espace, bien aménagé, bien aéré et où une stricte distanciation physique est de rigueur en cette période de Covid-19. Nous nous y plions volontiers. L’impressionnante bibliothèque en face de nous est remplie de livres dont beaucoup sont consacrés au génocide des Tutsi du Rwanda. Bien évidemment aucun des livres de Cheikh Anta Diop ne manque à l’appel. Un immense volume violet attire le regard : ce sont les « Oeuvres complètes » d’Aimé Césaire dont Diop a traduit en wolof les pièces intitulées Une saison au Congo. Et du reste le cœur palpitant de cette bibliothèque, ce sont les ouvrages en wolof. Tous ceux des éditions OSAD sont là, en vente, de même que les publications de EJO, Doxandéem de Ibraayima Saaxo Caam, Puukare de Ceerno Seydu Sàll ou encore Bàmmeelu Kocc Barma et Doomi Golo de Bubakar Bóris Jóob… Et comme le 15 décembre EJO a fait paraître en même temps trois livres, ceux-ci sont à l’honneur dans l’espace Mame Younouss Dieng : Guddig Mbooyo, roman policier de Lamin Mbaay ; Mboorum àdduna si, de Abdul-Xadr Kebe ; et un recueil de poèmes de Làmp Faal Kala, Xelum Xalam.
« Dans une démarche panafricaine, nous avons voulu donner à une maison d’édition sénégalaise un nom emprunté au kinyarwanda. Dans Antériorité des civilisations nègres Cheikh Anta Diop nous invite à « faire le bilan du passé pour aider l’Afrique à mieux affronter le présent et l’avenir » et c’est bien notre objectif. »
Le romancier sénégalais en est persuadé : le progrès et le développement passeront par la valorisation des langues africaines. Quand on lui demande si le mouvement n’est pas trop lent, il marque aussitôt son désaccord, faisant observer qu’au contraire cela bouge en profondeur.
« Beaucoup commettent l’erreur de croire que les changements sociaux n’adviennent que dans le fracas de l’histoire, dans le bruit et la fureur, pour ainsi dire. Cela arrive, certes, tout le temps. Mais les sociétés humaines peuvent aussi n’avoir aucune conscience de leurs propres mutations, il ne faut pas négliger ce qu’on peut appeler des révolutions silencieuses, qui viennent souvent des flancs de la société. Pour prendre le seul exemple des langues nationales au Sénégal, elles n’en seraient pas là si on s’en était remis aux seules structures officielles, comme les ministères de l’Alphabétisation. L’essentiel du travail a été fait dans l’ombre par des individualités pleines d’abnégation et peu impressionnées par un environnement hostile », confie Boris Diop qui rappelle que ce mouvement, que rien ne semble désormais pouvoir arrêter, est parti du travail de Cheikh Anta Diop.
« C’est lui qui dès 1948 met l’accent dans un texte mémorable intitulé : Quand pourra-t-on parler d’une renaissance africaine ? sur l’importance des langues nationales. Il réaffirme ce point de vue en 1954 dans Nations Négres et Culture. La lecture de cet ouvrage que Dialo Diop qualifie si justement de « séminal » incite des jeunes étudiants sénégalais de France à constituer dès 1958 le fameux « Groupe de Grenoble ». Autour d’Assane Sylla et d’ailleurs chez ce dernier, Cheik Ndao, Saliou Kandji, Massamba Sarre et quelques autres rédigent «Ijjib wolof », le tout premier alphabet dans la langue de Kocc. Plus tard Pathé Diagne, Sembène, Samba Dione lanceront « Kàddu ». Sakhir Thiam, agrégé de mathématiques, s’attachera à démontrer l’efficacité de l’enseignement de cette discipline et des sciences en général dans la langue wolof. Il y aura plus tard l’Association en Recherche et Éducation pour le Développement (ARED) et l’Organisation Sénégalaise d’Appui au Développement (OSAD) sans parler du travail scientifique considérable abattu par Aram Fal et Jean-Léopold Diouf pour ne citer que ces deux spécialistes. Le magistrat Amet Diouf et Aram Fal traduiront la Constitution du Sénégal (Ndeyu àtte Republigu Senegaal). Dans le sillage de ces initiatives qui n’ont rien à voir avec l’Etat, est née une abondante littérature en wolof et en pulaar. Mes romans en font partie, je revendique ma part de cet héritage et j’essaie de m’acquitter au mieux de mon devoir de transmission. »
Dans ce long processus figure notamment Adja Khady Diop Pathé née en 1922 à Dagana, écrivaine et poétesse qui conversait beaucoup avec Cheikh Anta Diop. Elle démontre, à travers des poèmes écrits en wolof, lors de la journée internationale de la femme en 1975, que la sensibilité poétique n’était pas réservée à des lettrés occidentalisés d’après le livre Des femmes écrivent l’Afrique : L’Afrique de l’Ouest et le Sahel édité par Miller et Osuwu Sarpong. Adja Khady Diop passe quelques années plus tard à la télé sénégalaise sur des programmes d’alphabétisation exclusivement en wolof.
Pour Diop, les radios et les télévisions ont joué un rôle crucial dans cette évolution des choses, comme en témoigne notamment la place prise par les débats en wolof. C’est, estime-t-il, un changement qui va se poursuivre.

Boubacar Boris Diop: « Le romancier doit s’inscrire en faux contre « le diktat de la réception du texte » et privilégier « la logique de production du texte » ©Mame Moussa Sock
« Il n’y a pas si longtemps on pouvait entendre un orateur s’excuser avec une étrange fierté avant sa prise de parole de ne pas bien parler wolof (« Ngeen baal ma, sama wolof setul »), suggérant par là qu’il a une si maitrise parfaite du français qu’il en a perdu la mémoire de sa langue maternelle ! Le plus drôle, c’est qu’après cette déclaration on se met à malmener violemment la langue de Molière ! Aujourd’hui, la situation a évolué, ce genre d’ineptie est de moins en moins de mise dans l’espace public » note l’observateur averti de la société sénégalaise.
Cheikh Anta Diop & le Rwanda…
D’où vient cette prise de conscience de la place à accorder aux langues nationales pour quelqu’un qui a atteint la reconnaissance et la notoriété avec ses romans et essais en français ? À cette question, il avait répondu en mars 2019 dans le Monde-Afrique au cours d’une interview avec Fatoumata Seck, jeune et brillante professeure de littérature à Stanford University :
« La vraie question ne doit pas être « Pour qui j’écris ? » ou « Combien de copies vais-je vendre ? », mais plutôt « avec quels mots puis-je le mieux exprimer ce que je ressens au plus profond de moi-même ? » Il s’agit pour le romancier de s’inscrire en faux contre « le diktat de la réception du texte » et de privilégier « la logique de production du texte ». Il n’est dès lors pas étonnant qu’à la sempiternelle critique sur la faiblesse, voire l’insignifiance du lectorat des œuvres en langues nationales, Diop réponde en invoquant l’histoire universelle de la littérature, qui prouve selon lui que ce sont les textes qui créent le public et non l’inverse. « Cela a eu lieu sur la longue durée et on passe ici à côté de l’essentiel si on se focalise sur nos horizons temporels limités » précise-t-il.
D’avoir voulu aller le plus loin possible en lui-même lui a montré les limites d’une langue d’emprunt et sans cesse laissé au bout de la plume comme un goût d’inachevé. Toutefois c’est à son enfance thiéssoise qu’il faut remonter pour réellement comprendre cette relation amoureuse entre l’écrivain et sa langue maternelle.
« À Grand-Thiès, nous avions droit aux contes nocturnes de la mère Fatou Ndiaye. Comme je m’en suis souvent expliqué, j’étais probablement le plus crédule de son auditoire d’adolescents et les mots de la conteuse me faisaient éprouver avec violence toute la gamme des sentiments humains, colère, joie, haine, tristesse etc. Et ces contes étaient naturellement dits en wolof. Avec ça, un gamin découvre la puissance inouïe des mots, leur capacité à engendrer des mondes. L’expérience m’a marqué et explique bien des mécanismes de mon écriture. Mais il y avait aussi l’immense bibliothèque paternelle où je m’enfermais à lire et relire toutes sortes de livres, éprouvant là aussi les mêmes émotions, au point de pleurer sur les malheurs de Cosette après avoir fini Les misérables. Je suis donc entré en littérature par ces deux portes-là, celle de l’oralité des contes dits en wolof et celle de la tradition écrite européenne à travers la bibliothèque paternelle. Il est bien normal qu’à l’arrivée je sois à la fois l’auteur de Doomi Golo et de Murambi, le livre des ossements, que je sois en somme un métis littéraire ».
Cependant, c’est le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, qui conduira à maturité chez Diop le processus de réappropriation de la langue wolof comme outil de création romanesque.
« Mes interlocuteurs sont toujours intrigués quand j’établis un lien entre le génocide des Tutsi et ma production en wolof. En fait, rien n’est plus évident puisque si la France de Mitterrand a soutenu les partisans de la « Solution finale » au Rwanda, c’est parce qu’à ses yeux Habyarimana était le président d’un bastion francophone envahi en octobre 1990 par une guérilla anglophone, le Front Patriotique Rwandais (FPR) de Fred Rigwiema et Paul Kagamé. Pour Paris, il fallait leur casser les reins car l’influence de la France en Afrique, le rayonnement de sa langue étaient mis en péril. Ce n’est pas moi qui dis cela mais presque tous les historiens, y compris Gérard Prunier que l’on peut difficilement suspecter de sympathie pour Kagamé et qui se moque du reste de ce qu’il appelle, dans son ouvrage de référence, « la basse-cour francophone », à savoir les pays du pré-carré genre Togo, Côte d’Ivoire et bien sûr notre cher Sénégal. La question de la langue française ainsi posée est lourde de son poids de sang au Rwanda. Et cela rendait soudain bien plus compliqué mon rapport à ce qui avait été jusqu’ici, sans problème majeur, ma langue d’écriture » nous raconte l’auteur de Le Cavalier et son ombre.
Poursuivant son analyse, l’essayiste qui s’est rendu au Rwanda quatre ans après la tragédie, nous en fait l’historique.
« Le Rwanda en 1994, avec son million de morts en 100 jours, soit 10.000 meurtres quotidiens, est l’exemple parfait, non pas de la haine de l’autre mais de la haine de soi. Tutsi et Hutu sont un seul et même peuple, ils parlent la même langue, adorent le même Dieu, Imana, et vivent sur les mêmes territoires où des coutumes identiques régissent leur vie quotidienne. On ne peut donc pas parler de haine inter-ethnique, bien au contraire je tue le tutsi non pas parce qu’il est différent de moi mais parce qu’il est identique à moi, il est le miroir qui me renvoie ma propre image que je ne supporte pas, qui doit être détruite. Ce génocide avait en réalité les allures d’un suicide collectif ».

L’essayiste a participé en 1998, avec dix autres écrivains africains, au projet d’écriture sur le génocide des Tutsi au Rwanda : « Rwanda : écrire par devoir de mémoire » ©Mame Moussa Sock
Nous l’interpellons alors sur la remarque de l’historien Abdarahmane Ngaïdé quant à la wolofisation du pays et au danger de voir le wolof remplacer le français et à son tour étouffer les autres langues nationales.
Boubacar Boris Diop dit comprendre les craintes de Ngaïdé un intellectuel à l’endroit de qui il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges.
« Si on s’y prend mal, le risque est réel. Au Sénégal, le wolof est une langue transethnique, que presque tout le monde parle et comprend plus ou moins. C’est une chance, mais cela ne veut pas dire qu’il faut foncer tête baissée. L’idée de coupler partout le wolof avec une langue régionale, en les mettant sur un pied d’égalité, eh bien, cette idée fait lentement son chemin depuis quelques années. Par exemple, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis les étudiants ont le choix entre une première langue et une deuxième, qui peut être indifféremment le pulaar ou le wolof. Les professeurs Sokhna Bao Diop et Oumar Djiby Ndiaye ont en charge ces deux enseignements. À EJO, nous avons jusqu’ici publié du wolof par la force des choses mais nous n’excluons aucune langue de notre pays. À vrai dire, nous avons reçu un manuscrit en langue pulaar mais des spécialistes consultés nous ont dissuadé de le publier… ». Jugeant ce sujet particulièrement sérieux, Boubacar Boris Diop insiste sur la nécessité d’une réflexion apaisée car, prévient-il, « faute de consensus là-dessus nous nous condamnons à laisser le français arbitrer cette querelle artificielle pour l’éternité ». À Suivre…
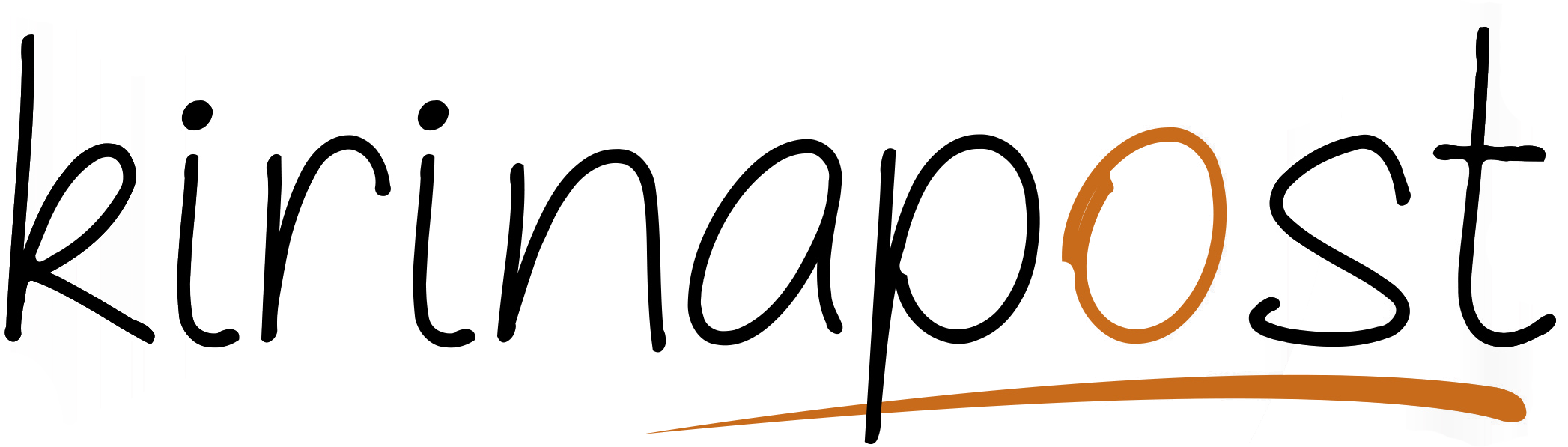


![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-400x280.jpg)



![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-120x120.jpg)



C’est super cette interview ! Bravo les journalistes ! et Chapeau à Boris !