À l’heure où le coronavirus continue de sévir dans nombre de régions du monde, l’Afrique affiche des chiffres relativement faibles, allant à l’encontre des prévisions occidentales. Les mesures appliquées ont été pour le moment efficaces, mais les populations vivant majoritairement d’économie informelle ont du mal à suivre. Comment les pays du continent font-ils face aux conséquences de cette situation sanitaire ? Quelles sont les pistes pour construire « l’Afrique d’après » ? Éléments de réponse avec Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.
Qu’en est-il de la situation sanitaire en Afrique face à la crise du Covid-19, alors qu’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU prévoyait une possibilité d’avoir des « millions de morts » en mars dernier ?
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, affirmait en mars dernier sur une chaîne de télévision française radiodiffusée, en parallèle, sur RFI que l’Afrique dénombrerait « nécessairement des millions de morts » créant selon stupeur, anxiété ou colère. Pourquoi ce traitement toujours différencié et spécifique de l’Afrique ? Pourquoi toujours renvoyer le continent dans les limbes de The heart of darkness de Joseph Conrad « the horror ! the horror ! ». Durant cette séquence médiatique, aucun élément méthodologique n’a été apporté pour justifier la position de M. Guterres, laissant plus sûrement entrevoir des représentations multiséculaires négatives de l’Occident sur l’Afrique, projection de ses propres peurs. Cette lecture soulève, par ailleurs, de nombreuses questions, lorsqu’à longueur de journée, on entend sur les chaînes en continu françaises qu’il faut penser le monde d’après. Le renouvellement paradigmatique ne concernerait, suivant cette logique, qu’une petite partie du monde et serait, décidément, loin d’être inclusif.
Sans autre forme de procès, rappelons également que l’OMS a récemment revu les prévisions du nombre de décès sur le continent africain à la baisse. Le continent ne dénombrerait plus « que » 190 000 morts. Là encore, ce chiffre laisse perplexe. Il ne s’agit pas de crier à l’hallali contre cette organisation – déjà largement vilipendée –, mais le hiatus entre la déclaration de Guterres et ces nouvelles projections crée un climat d’incertitude et de défiance à l’égard de la communauté internationale ; à témoin les représentants de l’OMS ont été déclarés, la semaine dernière, persona non grata au Burundi et invités à quitter le pays dans les plus brefs délais.
Depuis le début de la pandémie, le continent africain est celui qui a enregistré le moins de décès. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine, le 15 mai, 2 559 morts étaient confirmées pour une population africaine estimée à 1,2 milliard de personnes. D’où des spéculations selon lesquelles les vrais chiffres ne seraient pas connus, mettant les gouvernements en accusation. L’hypothèse est plausible, mais des personnes souffrant de graves insuffisances respiratoires, nécessitant des soins appropriés, se repèrent… Seuls les scientifiques, et après des études contradictoires, pourront expliquer cette faible létalité. Pour l’heure, certains avancent que la pyramide des âges et l’extrême jeunesse de la population sont un avantage alors que le virus toucherait plutôt les personnes âgées. L’écrivain Gauz[1], le 18 avril, signait un papier au titre éloquent « Le coronavirus n’a plus de vieux à tuer sur ce continent ». D’autres, acquis au protocole du professeur Didier Raoult, avancent que les Africains ont tellement ingurgité de nivaquine depuis leur enfance qu’ils seraient immunisés contre la maladie. Ces différentes assertions mériteront d’être approfondies, car tous les Africains ne sont pas logés à la même enseigne. Tous, considérant leurs petites bourses ou même l’éloignement d’un poste de santé, ne peuvent se procurer ledit médicament. Le paludisme pour lequel la nivaquine est préconisée reste un fléau et tue en moyenne 450 000 personnes par an.
Sans certitudes scientifiques, les précautions restent de mises et tout triomphalisme serait, sans aucun doute, prématuré. En revanche, il y a peut-être une leçon que nous pouvons d’ores et déjà retenir, c’est que traiter invariablement de manière différenciée le continent africain n’est plus possible sinon à susciter des réactions épidermiques et à masquer avec force peine un racisme structurel. Et comme le souligne l’intellectuel Felwine Sarr, témoignant dans cette séquence d’un destin plus sûrement partagé, « Les Européens s’inquiètent pour nous et nous nous inquiétons pour eux ». Comme l’affirmait récemment encore Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, il est nécessaire sinon urgent de désoccidentaliser notre regard : ce serait peut-être là un premier pas vers le monde d’après.
Des révoltes ont éclaté au Nigeria et au Burkina Faso pour réclamer le droit de retourner travailler afin de pouvoir se nourrir. De fait, est-il judicieux d’appliquer en Afrique les mêmes mesures sanitaires prises par exemple en Amérique ou en Europe, ou ne devraient-elles pas être adaptées au contexte social et économique des pays ?
Tout d’abord, il faut rappeler qu’en Europe il n’y a pas eu une réaction unilatérale dans la gestion de la crise du Covid-19. Tous les pays n’ont pas souscrit au confinement comme la Suède, par exemple. Il y a eu des « arts de faire », suivant la terminologie de Michel de Certeau, dans la manière de gérer cette crise. Il convient peut-être également de rappeler que les États-Unis ont réagi bien plus tardivement dans l’adoption de mesures sanitaires que nombre de pays africains, ce qui pourrait expliquer la très forte mortalité à laquelle ils sont actuellement confrontés. Aujourd’hui, ils ont à déplorer près de 90 000 décès (sur 328,2 millions d’habitants). Par conséquent, on observe que les situations sont extrêmement variées et opposer États-Unis et Europe versus Afrique dans cette séquence, qui certes est loin d’être terminée, est une grille d’analyse peu pertinente.
Dans de nombreux articles on a pu lire que la distance sociale pouvait s’avérer plus difficile à faire respecter dans les pays d’Afrique où la proximité physique est culturelle et nécessairement plus importante qu’ailleurs renvoyant à une image de communautarisme ou de surpopulation, opposée à l’individualisme des sociétés occidentalisées, ce qui reste toutefois à nuancer en fonction des conditions socio-économiques. Si certaines mégalopoles comme Lagos réunissent X millions d’habitants sont souvent citées en exemple, cette situation ne saurait être représentative alors que la densité moyenne sur le continent est de l’ordre de 42 habitants au kilomètre carré.
En ce qui concerne l’adoption des mesures sanitaires, telles que le lavage fréquent des mains, le port du masque, nombre de pays ont été plutôt réactifs. Au Maroc tout comme au Sénégal dès le début de la crise, les masques ont été mis en vente dans les supermarchés. Très rapidement, les ateliers de couture ont également confectionné des masques en tissu.
Il y a eu une extraordinaire mobilisation des lanceurs d’alerte sur les réseaux sociaux, des artistes, qui par la musique, slam, rap, ou graffitis sur les murs des villes, tous rivalisant de créativité, se sont mis au service de leur pays pour informer les populations sur les gestes barrière et les règles sanitaires à respecter, créant les conditions d’un consensus, d’une unité nationale et mettant temporairement de côté leur opposition avec leurs gouvernants respectifs. Des chercheurs de l’université de Kampala ou de Dakar ont créé des gels hydroalcooliques sans attendre des livraisons de l’étranger. En Tunisie, certains experts ont développé la reproduction de respirateurs à partir d’imprimantes 3D. Dans cette séquence, nombre de pays africains ont montré leur capacité de résilience, de réactivité, d’innovation et de concorde nationale, tandis que l’Occident sombrait, dans certains cas, dans des polémiques et montrait une cohésion sociale fragile.
Évidemment, il serait hasardeux de sombrer dans un afro-optimisme béat en obérant les difficultés rencontrées dans nombre de pays. Il y a des réalités qu’on ne saurait ignorer et l’état des prestations sanitaires reste un véritable enjeu. La crise du coronavirus a levé le voile, sur ce que d’aucuns connaissaient déjà : le manque de matériel et de services adéquats. La République centrafricaine compte, par exemple, trois lits de réanimation pour une population de 4,6 millions d’habitants. Certains hauts représentants de l’État préfèrent se faire soigner hors Afrique ; un choix qui est loin de créer les conditions de la confiance dans leurs propres services de santé. Aussi le Premier ministre de Côte d’Ivoire, pour une pathologie autre que le Covid-19, a dernièrement été hospitalisé en France ; petit privilège tandis que les lignes aériennes entre les deux pays sont suspendues depuis mars… Pour paraphraser une fable de Jean de la Fontaine, selon que vous serez puissants ou misérables, votre parcours de santé différera. Ce qui est vrai en Afrique l’est tout autant, à quelques exceptions près, dans des pays occidentaux.
Si la crise sanitaire n’a à ce jour pas eu lieu en Afrique, en revanche la crise économique touche déjà de nombreux pays due au ralentissement économique mondiale. Les craintes d’une récession planent et les chiffres de la croissance sont revus partout à la baisse, rappelant la dépendance des pays africains à l’égard de l’étranger. Les envois d’argent par la diaspora sont également en diminution ce qui impacte les revenus déjà frugaux de nombre de foyers qui comptent sur cet apport dans leur budget.
La structure du marché de l’emploi est telle qu’aujourd’hui la majorité des gens vivent du secteur informel. Selon les chiffres de l’OCDE, et qui restent à ce jour tendanciels, seuls 10 % des diplômés d’une classe d’âge ont accès à l’issue de leur cursus à un emploi décent[2]. Si l’on surajoute les non-diplômés et les enfants qui n’ont pu être scolarisés – 90 millions d’« enfants fantômes » sans identité légale n’ont pas accès à un parcours scolaire en Afrique – plusieurs millions de gens vivent du système D, au jour le jour, n’ayant pas la possibilité de constituer des épargnes. Toutefois, là encore, il faudra dans le temps long regarder avec précision comment dans certains cas, les populations privées de travail ont bon gré mal gré composé avec les règles de confinement. Est-ce que les tontines (forme d’épargne communautaire) les ont aidées, durant cette période, à supporter les difficultés du quotidien ?
Le Nigeria, qui tire ses revenus essentiellement de la rente pétrolière, a été fortement touché par la crise en raison de la chute du prix du baril. Les manifestations pour retourner travailler et se nourrir sont certes dues au confinement, mais s’inscrivent dans un temps plus long que la crise du Covid-19. Depuis août 2019, en contravention avec les textes de la CEDEAO et de la ZLEC, le pays a fermé unilatéralement ses frontières avec l’ensemble de ses pays voisins. L’objectif avancé par le président Buhari, ce qui du reste est toujours d’actualité, est de diversifier l’économie de son pays et de protéger une agro-industrie rizicole naissante contre la contrebande de riz en provenance du Bénin. Depuis cette décision, il y a des tensions sur cette denrée, car le pays n’est pas en capacité d’autosuffisance et d’assurer les conditions de sa souveraineté alimentaire. Quoi qu’il en soit, le Nigeria a décidé de reprendre le monopole de ses importations sur cette céréale, mais les taxations douanières (de l’ordre de 70 %) ont, depuis plusieurs mois déjà, contribué à la flambée des prix et créent l’exaspération. Rappelons enfin que, contrairement, à d’autres pays où les gouvernements ont observé une plus grande tolérance à l’égard du confinement – au Sénégal, par exemple si l’État d’urgence a été décrété le gouvernement n’a pas opté pour cette solution afin d’éviter une crise sociale – , au Nigeria des règles strictes ont été édictées au point de créer des tensions entre les populations et les forces de l’ordre. Le 16 avril, 18 personnes ont été tuées par la police pour non-respect des règles de confinement. Le 27 avril, des ouvriers cherchant à braver l’interdiction et à reprendre leur activité dans la raffinerie d’Aliko Dangote, à Lagos, a créé une vive altercation avec les forces de l’ordre. Par conséquent, dans le cas du Nigeria, les émeutes s’inscrivent dans la courte et la moyenne durée tout autant qu’elles sont plurifactorielles. Considérant ces différents événements et le risque d’embrasement, le président Buhari a annoncé un déconfinement progressif à compter du 4 mai tout en imposant un couvre-feu nocturne et le port obligatoire du masque.
Au Burkina Faso, par exemple, la situation est un peu différente. Le pays est sous tension depuis plusieurs mois. L’État est défait après avoir subi plusieurs attaques terroristes et est dans l’incapacité d’exercer ses prérogatives régaliennes. Les gouvernants sont mis à rude épreuve et leur crédit est largement entamé. Au vu des risques encourus par la population – attaques djihadistes, déplacement de leur lieu d’habitation en vue de se protéger et l’ensemble des maladies qu’ils affrontent annuellement comme le paludisme -, la peur n’est pas de mourir du coronavirus (51 décès recensés). Pour ces différentes raisons, les Burkinabè ont manifesté pour retourner travailler, pour la réouverture des marchés et assurer le menu quotidien.
Tout comme en Europe, la gestion de la crise et l’adoption du confinement auront différé en Afrique d’un pays à l’autre, d’où des tensions plus ou moins aiguës à analyser pays par pays.
Ces mesures sous-entendent un financement conséquent de la part des États. Sont-ils en capacité d’y subvenir ? Bénéficient-ils d’aides internationales, notamment du Fonds Monétaire International ? La piste de l’annulation de la dette est-elle intéressante et plausible ?
Un des problèmes de nombre d’États africains, c’est qu’ils sont dans des situations d’extraversion économique (financière, budgétaire) et alimentaire, c’est-à-dire qu’ils dépendent de l’extérieur. Sur le plan économique, les chefs d’États africains sont suspendus aux classements des « doing business » établis de concert par le FMI et la Banque mondiale, afin de s’attirer les faveurs des investissements directs étrangers (IDE). Plus les classements sont bons surtout en termes de « climat des affaires » – ce qui présuppose des mesures prises pour la transparence des circuits financiers, et une lutte contre la corruption -, plus la situation leur est favorable pour attirer les IDE. En cas de crise économique mondiale, outre le prix des matières premières, ce sont les premiers budgets susceptibles d’être revus à la baisse.
Nombre d’économies africaines sont peu compétitives, dans la mesure où les pays exportent des matières premières, dont le prix est fixé par des bourses internationales, transformées dans des pays étrangers et qu’ils rachètent par la suite, sous forme transformée, à prix élevé. Sur le plan alimentaire, le même schéma prévaut depuis la libéralisation et l’adhésion en 1994 aux accords de l’OMC. Il en résulte qu’il est plus intéressant d’importer des produits souvent issus de l’agro-industrie brésilienne ou asiatique que de consommer local. Par exemple, nombre de pays seraient tout à fait en capacité de produire localement du riz. Un projet PPP (partenariat public privé) a ainsi été lancé dans la vallée du fleuve Sénégal. Cependant, les pays qui adoptent progressivement ce tournant du consommer local ne sont pas encore au stade de la souveraineté alimentaire et dépendent, par exemple, de l’importation du riz asiatique. En l’absence de solidarité internationale, la bourse sur le prix du riz pourrait s’envoler et préfigurer des situations de famine dans les pays où, par héritage colonial, cette céréale s’est imposée comme denrée alimentaire de base.
Par conséquent, nombre de pays africains sont en situation de dépendance d’où l’urgence à changer de modèle de croissance, à privilégier le made in Africa, quitte à recourir au cas par cas au protectionnisme comme l’a souligné dans son ouvrage, l’économiste togolais Kako Nubukpo[3].
Concernant le sujet de l’annulation ou le moratoire sur les dettes des pays africains, ce sont là des solutions plausibles, mais qui nécessitent, au préalable, de comprendre la structure de la dette de chacun des pays africains. En effet, le temps a passé pour l’Afrique francophone où son seul partenaire économique était la France. Aujourd’hui, cette structure est beaucoup plus complexe et la dette est aussi bien extérieure, impliquant plusieurs acteurs, qu’intérieure, impliquant une redevabilité de l’État à ses souscripteurs nationaux. Il est, par ailleurs, intéressant de noter que cette question de l’annulation de la dette suscite des débats aussi bien parmi les pays créditeurs que parmi les pays débiteurs.
Des ministres des Finances et du budget béninois et sénégalais se sont opposés sur ce sujet par voie de tribunes interposées dans Jeune Afrique. Le ministre béninois Romuald Wadagani souligne que cette réponse, quoique parant aux urgences, ne permet pas de réformes structurelles. Il souhaite que les Africains payent comptant leurs dettes au risque d’être déclassés par les agences de notation dans les mois ou années à venir et donc d’être contraints par la suite d’emprunter à des taux plus élevés : « Les appels à l’allègement de la dette ont un côté ‘déjà vu’ avec des résultats controversés. L’option d’un soutien à l’endettement adéquat et responsable me semble un meilleur choix qu’un appel à l’indulgence. Il est également impératif qu’il serve à répondre à des besoins concrets, avec efficacité et efficience. Ceci appelle à la transparence dans sa gestion ». Le ministre sénégalais Abdoulaye Daouda Diallo, quant à lui, souligne qu’« annuler la dette des pays africains est vertueux et bien-fondé ». Il souligne : « (…) l’objectif des moratoires sur des périodes suffisamment longues et de l’annulation de la dette institutionnelle est de libérer des capacités budgétaires pour renforcer les fondamentaux, de manière à maintenir les capacités de production et le pouvoir d’achat des ménages, notamment ceux qui sont vulnérables ». Ce débat sur l’annulation de la dette, solution à laquelle le Pape François a souscrit, ne concerne pas seulement les hommes politiques en responsabilité. Des intellectuels comme Felwine Sarr, professeur d’économie, ont également plaidé pour que les pays africains payent leurs dettes : « Économiquement, la dette n’est pas un problème si elle est sous contrôle, c’est-à-dire bien investie. Malheureusement, certains États africains profitent de cette crise pour jouer sur ce que je nomme la politique de la compassion et demander l’annulation de leur dette. Or, nous ne devrions pas tendre la main. Il faut changer de discours. Assumons nos dettes, payons-les, gérons-les comme il faut et arrêtons de venir quémander une annulation tous les vingt ans ». Son positionnement est un peu différent de celui des hommes politiques, il s’agit pour lui de rompre avec l’image d’une Afrique qui tend la sébile, suspendue aux délibérations des gouvernants des grandes puissances de ce monde.
Enfin, sur le sujet de l’aide, là encore les débats sont nombreux. Lors d’une interview croisée accordée par Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, et Tidjane Thiam, récemment nommé aux côtés de trois autres personnalités comme envoyé spécial de l’UA contre le coronavirus, se sont opposés à tout « corona moral », en clair pas de conditionnalité de l’aide. De nombreux experts internationaux, mais également des personnalités publiques engagées dans leur pays dans la lutte contre la corruption, se sont, quant à eux, fermement opposés contre cette disposition afin qu’il y ait une transparence totale sur l’utilisation des fonds. Ce combat est clairement mené pour qu’il n’y ait pas de détournements de la part de gouvernements kleptocrates et pour que l’argent serve réellement aux populations dans le besoin[4].
Les enjeux sont donc économiques, politiques et idéologiques. Le monde d’après ne surgira pas avec la fin de l’été. Depuis plusieurs années, le continent africain est entré dans une phase de transition et des tensions ont pu être cristallisées par la crise du coronavirus tout comme cette dernière a révélé de fortes capacités de réactivité, de résilience et la nécessité de changer de modèle de développement en capitalisant sur les ressources internes du continent. Sans doute, au regard des débats, et seuls les Africains auront les réponses, faudra-t-il sur le court et le moyen terme parer aux urgences en négociant avec les membres de la société civile. Dans le même temps, des pistes de réflexion seront à investiguer afin de créer les conditions d’un nouveau système, celui de « l’Afrique d’après ».
Source: www.iris-france.org
————————————————————————-
[1] L’écrivain a été multi primé pour son livre Camarade Papa. En 2018, il a reçu le Prix ivoire et, en 2019, le Grand Prix littéraire d’Afrique noire.
[2] « (…) seule une minorité de jeunes ont un “bon” emploi. Le salariat dans le secteur formel — soit le type d’emploi le plus proche d’un emploi “décent” — n’est l’apanage que d’environ 7 % des jeunes dans les pays à faible revenu et 10 % dans les pays à revenu intermédiaire », Henri-Bernard Solignac-Lecomte, « L’Afrique est-elle vraiment bien partie ? », Alternatives économiques, 1.07. 2013.
[3] Kako Nubukpo, L’Urgence africaine. Changeons de modèle de croissance, paru en septembre 2019 aux éditions Odile Jacob. Ce combat l’anime depuis plusieurs années déjà et l’a poussé à lancer un appel avec le prospectiviste sénégalais Alioune Sall signé par 54 intellectuels « Coronavirus : pour en sortir plus forts ensemble».
[4] Dans une étude de la Banque mondiale, publiée le 18 février, et intitulée L’aide financière accaparée par les élites, il est avancé que 5 % des financements se retrouveraient dans des comptes offshore. Le taux attendrait même 15 % pour sept pays les plus dépendants des aides de la Banque mondiale, comme le Burundi, la Guinée-Bissau ou encore la Sierra Leone.
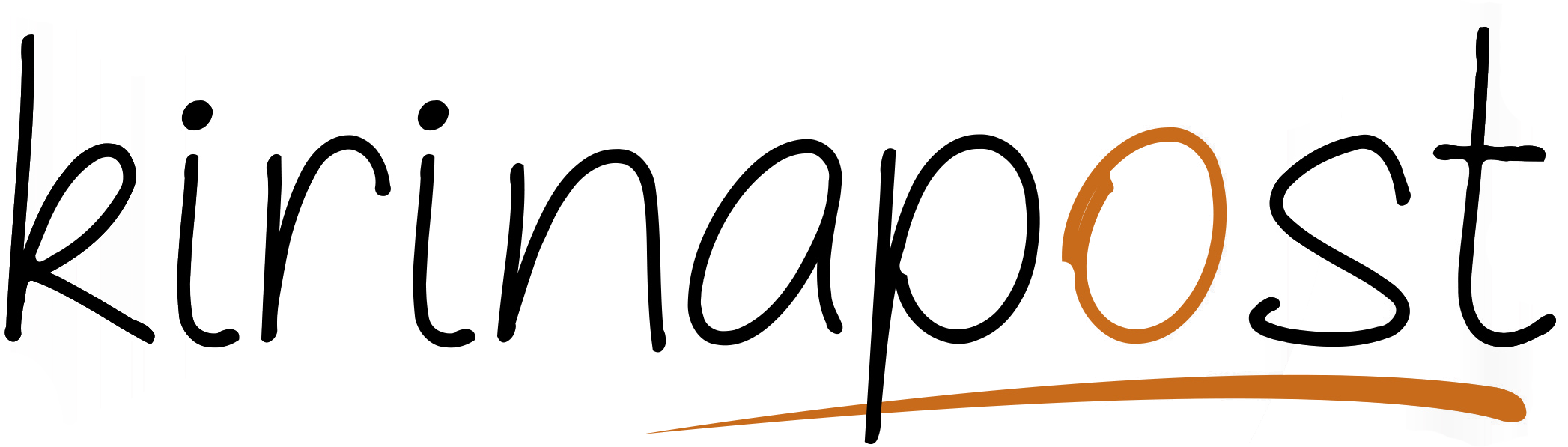










Laisser un commentaire