Il m’arrive très rarement de partager des articles. Mais celui-ci, signé Peter Doyle et publié dans Financial Afrik le 20 octobre 2025, m’a arrêté, presque bouleversé. Il y a dans ce texte une clarté rare, une lumière morale que l’on ne rencontre plus guère dans le langage technocratique de l’économie. Doyle ne se contente pas d’écrire : il témoigne. Il parle avec la gravité de celui qui a vu de l’intérieur la mécanique froide d’un système et qui ose, enfin, nommer l’injustice. Ce n’est pas un simple diagnostic économique — c’est un acte de conscience.
C’est à partir de cette parole courageuse, lucide et profondément humaine que je voudrais proposer quelques réflexions sur la portée intellectuelle et politique de ce texte, et sur ce qu’il révèle du rapport entre vérité, économie et responsabilité mondiale.
Ancien cadre senior du FMI, l’économiste américain s’exprime ici avec la liberté de celui qui connaît de l’intérieur les logiques institutionnelles et les dérives structurelles d’un système financier international qui prétend servir la stabilité, mais qui en réalité engendre souvent la vulnérabilité et l’injustice.
Je suis très impressionné par cette analyse d’une rare objectivité. Elle témoigne d’une éthique de l’intellectuel — au sens de cette responsabilité morale qui oblige à nommer les choses, à résister aux conformismes de l’expertise et à replacer la vérité au-dessus des convenances diplomatiques. En cela, Peter Doyle rejoint la tradition de ceux, comme Joseph Stiglitz, qui, bien qu’ayant appartenu aux sphères dirigeantes du FMI ou de la Banque mondiale, ont su garder cette conscience critique qui empêche de se rendre complices d’un ordre inéquitable.
Le texte de Doyle, sous des dehors techniques, soulève en réalité une question fondamentale : comment une institution multilatérale censée incarner la rigueur et la transparence peut-elle se tromper à hauteur de 40 % du PIB d’un pays ? La réponse est à chercher du côté de ce que Doyle appelle lui-même la “précipitation” — une culture managériale où la vitesse d’exécution, la satisfaction hiérarchique et la conformité à des modèles préétablis l’emportent sur la vigilance intellectuelle, la prudence scientifique et la probité morale.
L’affaire sénégalaise qu’il décrit ne doit pas être perçue comme une anomalie, mais comme une illustration paradigmatique de ce qui se joue dans le “kindergarten” global de la gouvernance économique : un système où les nations du Sud sont infantilisées, notées, corrigées, et sommées d’apprendre à bien gérer selon les standards d’une rationalité importée, pendant que les fautes structurelles des institutions internationales sont passées sous silence. Ce déséquilibre cognitif et symbolique nourrit une violence silencieuse, une forme d’injustice épistémique où la parole du Sud reste minorée, même quand elle dit vrai.
Le texte de Doyle est d’autant plus fort qu’il déplace la focale : il ne se contente pas de dénoncer les incohérences du FMI, mais il met à nu le cynisme bureaucratique qui permet à des technocrates, des responsables politiques et des bailleurs d’échapper à toute responsabilité. Il montre comment, par un effet d’aléa moral, les mêmes acteurs qui ont failli continueront à agir sans crainte de sanction, convaincus qu’ils seront, une fois encore, absous par le discours de la “transparence institutionnelle”.
En proposant que le Sénégal suspende le remboursement des dettes non déclarées en attendant un audit complet, Doyle rompt avec la logique de soumission économique. Il plaide pour une approche de la dette fondée sur la vérité et la souveraineté des peuples, et non sur la conformité comptable. Ce faisant, il réintroduit dans le débat une dimension éthique de la dette, trop souvent effacée par la technicité des analyses financières.
L’ancien président Macky Sall, présenté ici comme l’architecte d’une catastrophe budgétaire, n’est qu’un maillon d’un système plus vaste : celui d’une économie mondiale où la complaisance mutuelle entre dirigeants locaux et experts internationaux neutralise toute exigence de redevabilité. L’appel de Doyle à la révocation des responsables du FMI concernés — voire de la directrice générale elle-même — n’est donc pas une posture radicale, mais un rappel salutaire que la responsabilité doit redevenir le principe cardinal de la gouvernance mondiale.
Ce texte courageux nous oblige à repenser la place du FMI, non seulement comme acteur économique, mais comme institution morale. Il pose la question du rapport entre la science économique et la vérité sociale : peut-on continuer à parler de développement lorsque les instruments censés l’accompagner creusent la dépendance et la défiance ?
En définitive, l’intervention de Peter Doyle sur le cas sénégalais n’est qu’une illustration exemplaire d’une crise plus profonde : celle d’un système international qui confond expertise et autorité, efficacité et précipitation, gestion et domination. Par son courage intellectuel et sa rigueur éthique, Doyle nous rappelle que la véritable science économique commence là où s’arrête la soumission à la routine — là où la pensée retrouve sa responsabilité envers les peuples qu’elle prétend servir.




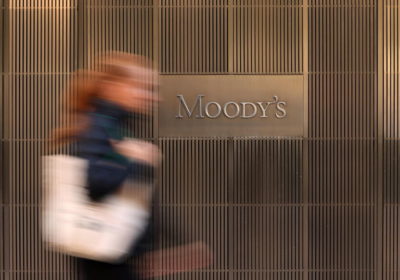




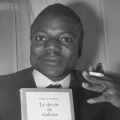

Laisser un commentaire