À la suite du décès du sociologue Momar-Coumba Diop, j’ai posé trois questions à quelques personnes qui le connaissaient bien ou ont collaboré à ses ouvrages. Professeur Mouhamadou Mbodj, Professeur Boubacar Barry, Professeur Babacar Fall « Baker », Professeur Ibrahima Thioub, Docteure Fatou Sow, Professeur Adebayo Olukoshi, Docteur Cheikh Oumar Bâ, Professeure Fatoumata Hanne, Docteur Hamidou Dia, Docteur Serigne Mansour Tall, Docteur Ramata Thioune, Docteure Ndeye Astou Ndiaye, Docteur Hady Bâ se sont prêtés à l’exercice dans cet article paru dans le journal du Codesria.
1. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
2. Comment il/son œuvre vous a influencé.e ?
3. Lequel de ses ouvrages vous a personnellement le plus marqué.e ? Pourquoi ?
Avant de leur donner la parole, je me suis prétée au jeu….

«Momar-Coumba Diop,paix à son âme, est un mentor et un passeur transdisciplinaire et intergénérationnel» Dr Rama Salla Dieng
Momar-Coumba Diop, qui s’est éteint le 7 juillet à Paris, fut littéralement l’un des éditeurs d’une page de l’histoire du Sénégal. Sociologue, Momar avait le flair de l’historien. Mieux encore, sa recherche cou-ronnée d’une riche œuvre intellectuelle s’étale sur trois décennies et visait à remembrer une historiographie politique, économique et sociale du Sénégal de la fin des années soixante-dix à nos jours.Discret, généreux et bienveillant, Momar-Coumba Diop fut avant tout un rassembleur de lumières d’une discrétion généreuse et bienveillante. « C’est le prototype du chercheur en sciences sociales complet », comme en témoigne encore le Professeur Barry, qui lui a exprimé sa reconnaissance en signant la préface des mélanges édités par Ibnou Diallo, Ibrahima Thioub, Alfred Inis Ndiaye et Ndiouga Benga. Je fais certainement partie de la « famille intellectuelle très étendue » de Momar-Coumba Diop.
C’est d’abord à la bibliothèque de l’Institut Africain de Développement Économique et de Planification (IDEP) où j’ai travaillé à la section de recherche sur les politiques de développement de 2010 à 2013 que j’eus à lire en profondeur quelques uns des ouvrages de Momar-Coumba Diop, dont le nom m’était déjà devenu familier pendant ma formation initiale en science politique à Bordeaux. Par ailleurs, quel.le étudiant.e digne de ce nom travaillant sur le Sénégal l’aurait ignoré ? Momar était une référence incontournable dans la pensée politique sur la construction de l’État-nation au Sénégal.
En 2013, Carlos Oya, professeur d’économie politique du développement qui assurait l’encadrement de mon mémoire de master à l’École des Études Orientales et Africaines (SOAS) de l’université de Londres, et par ailleurs « mouridologue des campagnes et des paysans» à l’instar de Jean Copans et de Donal Cruise O’Brien, me présenta à Momar-Coumba Diop, ancien « mouridologue des villes » pour paraphraser Copans, dans son fameux chapitre sur « la famille très étendue de Momar-Coumba Diop ».
Mon projet de recherche portait sur la transition du Sénégal des politiques de réduction de la pauvreté à l’émergence, de la fin des années quatre-vingt-dix à nos jours. Je le rencontrai en personne pour la première fois en 2014 à son bureau de l’IFAN de Dakar, après de nombreux échanges par e-mail sur mon mémoire de master. Il me présenta alors à ses amis chercheurs économistes et sociologues de l’université et des cadres et fonctionnaires au ministère de l’Économie et du Plan. Il fallut juste que Diop leur passât un coup de fil ou leur envoyât un message pour que certaines portes jusqu’alors hermétiques s’ouvrissent comme par enchantement. De Gaye Daffé à Seydou Nourou Touré, de Aminata DiawCissé à Aboubakry Lom, de Aliou Faye à Amadou Tidiane Dia, et tant d’autres que je ne citerai ici par souci de n’oublier personne, je pus conduire de nombreux entretiens qui enrichiront ce travail.
En outre, la riche et longue liste d’ouvrages de référence coordonnés par la bibliothèque de la SOAS me permit de me familiariser avec sa bibliographie incontournable. De plus, je pus lire plusieurs de ses travaux moins connus comme son chapitre particulièrement important intitulé :« Du “socialisme africain” à la “lutte contre la pauvreté” : la fin des ambitions de développement» dans l’ouvrage Le Sénégal face aux défis de la pauvreté : les oubliés de la croissance, édité par Abdoulaye Diagne et feu Gaye Daffé et publié par Karthala en partenariat avec le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) et le Centre de Recherches sur les Politiques Sociales (CREPOS). Dans ce chapitre, il explique comment la lutte contre la pauvreté est devenue la nouvelle pensée hégémonique, montrant qu’au fond, ce qui est en jeu est une remise en cause lente, mais continue du modèle de redistribution et des réseaux de solidarité jusqu’alors dominants.
J’eus l’occasion de constater la générosité et l’humilité de l’homme et l’esprit pénétrant et la capacité d’analyse aiguisée de l’intellectuel avisé et féru de l’exploitation de données de diverses natures. Plus important encore, la jeune chercheuse en herbe qui fut introduite à l’idée de « trespassing » par Carlos Oya, qui m’obligea à lire Albert Hirschman, fut séduite par la liberté de l’intellectuel Momar-Coumba Diop et par sa faculté à toujours aller au-delà des clivages disciplinaires pour offrir des perspectives riches sur l’objet d’étude donné.
En effet, dans un entretien de 1993 avec Camille Donzelli, Hirschman disait que la notion de « trespas-sing » est fondamentale dans sa réflexion : « Les tentatives de me confiner dans une zone spécifique me rendent malheureux. Lorsqu’il me semble qu’une idée peut être vérifiée dans un autre domaine, alors je m’aventure volontiers dans cette direction. Je pense que c’est un moyen simple et utile de découvrir des sujets “connexes”. »
C’est ainsi que Momar-Coumba Diop me recommanda de ne pas interroger les seuls économistes et leurs écrits, mais aussi les historiens, les philosophes, les sociologues et anthropologues, les juristes et les politistes et surtout les praticiens du développement et fonctionnaires. Cela me permit de mieux comprendre les raisons de certaines politiques de développement, car comme le disait Souleymane Bachir Diagne dans un court livre du CODESRIA la Culture du développement :« On ne peut pas avoir économiquement raison si on a culturellement tort. »
Momar-Coumba Diop avait rassemblé différentes expertises disciplinaires pour mieux analyser et décrire les mutations profondes du Sénégal sur trois décennies. Ses amis proches: Mamadou Diouf et Mouhamadou Mbodj, sont aussi historiens. De ce trio, le Professeur Boubacar Barry, historien lui aussi, dira dans la préface de Comprendre le Sénégal et l’Afrique d’aujourd’hui Mélanges, offerts à Momar–Coumba Diop, qu’ils étaient particulièrement dési-reux de « promouvoir les mutations sociales, économiques, et politiques pour mieux comprendre les crises de la construction de l’État postcolonial déjà récurrentes à cette époque ».
Les autres amis et collègues proches de Momar-Coumba Diop sont de diverses chapelles disciplinaires, ce qui a certainement déteint sur l’approche méthodologique multidisciplinaire et multidimensionnelle de Diop. En effet, selon Barry dont le dernier entretien avec Diop remonte au 4 mai, le sociologue fut le prototype de l’intellectuel africain soucieux de créer un espace propice à une production intellectuelle organique loin de la dichotomie entre élites du pouvoir politique exclusif et intellectuels enfermés dans leur tour d’ivoire universitaire au profit de la seule recherche: « Mon ami laisse un patrimoine en manuscrits et en travaux inachevés. Tant et si bien qu’il faudrait des équipes interdisciplinaires pour terminer ce qu’il a commencé », selon Barry.
Lors de mon retour à Dakar en 2014, à la fin de mon master, je lui fis aussi part de l’obligation où je me trouvais de remettre à l’année suivante mon projet de poursuivre mes études à la SOAS en engageant un doctorat du fait du manque de financement. Momar prit personnellement l’initiative d’activer ses contacts à la Direction Générale de la Recherche et au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’auprès du Professeur Chérif Daha Ba pour leur demander de m’aider dans ma quête de financement pour mes études doctorales. Même si ces démarches ne furent pas fructueuses, je compris que désormais, Momar m’avait acceptée comme membre de sa « famille très étendue ».
Je finis par décrocher l’unique bourse de la Fondation Mo Ibrahim pour la gouvernance et le développement en Afrique de la SOAS grâce aux recommandations de Carlos Oya, Adebayo Olukoshi et Momar-Coumba Diop (pendant son séjour à Londres en 2014). Aussi bien pour mon mémoire de master que pour mon projet de thèse, Momar me recommanda de choisir un « titre moins orienté », il me conseilla par exemple, pour la thèse, au lieu de parler « d’accaparements de terres », de choisir un titre qui me permettrait d’analyser la nature de cette ruée et les logiques qui la sous-tendent.
À cette époque, les ouvrages de Momar qui m’ont le plus marquée furent d’abord Le Sénégal sous Abdou Diouf, dans lequel Momar Coumba Diop ouvre la voie à son œuvre éditoriale en reconstituant la crise hégémonique des années soixante-dix et La transition de Senghor à Diouf qui aura un impact considérable sur l’État postcolonial, et sur la nature de la reproduction des élites politiques avec l’avènement du multipartisme. De même, cette transition mena aussi à de grandes et profondes mutations de la société sénégalaise avec la centralisation de l’exercice du pouvoir.
Le Sénégal contemporain fut publié en 2002 et dans son introduction, Momar dira que cette synthèse de travaux de recherche entrepris à partir de 1987 fut marquée par sa collaboration avec le CODESRIA. Ce projet avait pour objectif :« […] de construire un ensemble de données devant servir à la ré-daction d’une économie politique du Sénégal. […] Nous cherchions ainsi à manifester notre présence dans l’espace universitaire par la production de savoirs pertinents, visant à une certaine universalité. […] Dans cette quête intellectuelle, la rencontre avec le Codesria et les encouragements et échanges avec des collègues sénégalais ou des universités étrangères ont constitué une ressource importante. »
La Construction de l’État du Sénégal publié aussi en 2012, est le fruit d’une longue collaboration entamée avec Donal Cruise O’Brien en 1994 et à laquelle se joignit Mamadou Diouf, enchanté par l’idée. S’y rajoutent les deux volumes du Sénégal sous Abdoulaye de Wade et Sénégal (2000-2012). Les institutions et politiques publiques à l’épreuve d’une gouvernance libérale, qu’il m’offrit en 2014. De ces ouvrages, l’analyse aiguë de Momar sur la nature de l’exercice du pouvoir et l’évolution de celle-ci de Senghor à Wade en passant par Diouf me permit de comprendre qu’il était vital de concevoir la pratique de l’exercice positif du pouvoir avec les formes d’hybridation qui se donnent à voir, au-delà des théories, souvent normatives et hors-sol, de l’idéal-type de l’État-nation.
Plus largement, de l’œuvre de Momar naquit mon goût pour l’édition d’ouvrages et de numéros spéciaux et pour le fait de suivre un projet de sa conception à sa publication avec les contributions de collègues, qui requiert non seulement une grande discipline, mais aussi et surtout une probité intellectuelle et éthique. Méthodologiquement, je commençais à avoir un grand appétit pour la discipline historique et l’analyse du temps long, tout comme Momar, et pour l’ethnographie, car en poli-tiste formée à l’analyse d’économie politique, je suis convaincue de la nécessité de combiner plusieurs disciplines pour parvenir à se rapprocher au plus près des réalités sociales dans leur intégrité.
Toutefois, je partage la frustration d’Adrian Adams, dont les travaux ont porté sur la vallée du fleuve Sénégal, dans la conclusion de sa « Lettre ouverte à un jeune chercheur», à propos de l’histoire et de l’anthropologie comme disciplines et de leurs limites.J’ai revu Momar au Sénégal pendant mes enquêtes de terrain en 2017 et nous sommes restés en contact. Cela faisait trois ans que je souhaitais l’interviewer dans le cadre de mes entretiens de 30 minutes et il avait donné son accord.
Je le lui rappelai dans un e-mail de janvier 2021 que j’avais partagé avec lui et le Professeur Abdou Salam Fall sur leurs hommages respectifs au Professeur Abdoulaye-Bara Diop auquel il répondit qu’il «n’oubliait pas sa dette». Malheureusement, ce projet ne s’est pas concrétisé.
Merci pour tout Momar, reçois en retour ces quelques mots de tes amis, collègues et admirateurs et admiratrices de ton travail si rigoureux. Repose en paix !
À la suite du décès de Momar, j’ai posé trois questions à quelques personnes qui le connaissaient bien ou ont collaboré à ses ouvrages.
1. Comment vous êtes-vous rencontrés ? 2. Comment il/son œuvre vous a influencé.e ? 3. Lequel de ses ouvrages vous a personnellement le plus marqué.e ? Pourquoi ?
Professeur Mouhamadou Mbodj
J’ai cheminé avec Momar-Coumba (« Max » pour les proches) et le défunt ElHadji Salif Diop, au lycée Blaise Diagne, de la sixième à l’annexe, jusqu’à la faculté des lettres où on a suivi des chemins différents, mais parallèles. Ensuite nous avions pris le chemin de Paris pour les études doctorales. Quelques années plus tardrevenus au pays, nous nous sommes retrouvés jeunes assistants à la fa-culté des lettres. C’est là où je lui ai présenté Mamadou Diouf. Nos relations débordèrent de l’enceinte de la faculté durant notre expérience de jeunes fondateurs de fa-milles. On l’appelait Max depuis le lycée, et il commença à m’appeler «Inge » à cause de mon penchant pour les gadgets et outils électroniques.
La fin des années1970 et le début des années1980 correspondent à une crise d’identité et de direction des sciences sociales. Pour nous, la discipline historique était la pièce maîtresse de cette évolution. Les brèches dans la cuirasse de la théo-rie dépendantiste offraient possibilité té d’une nouvelle lecture de la trajectoire du Sénégal. La première opportunité fut l’exercice prospectif de Sénégal en l’an 2000, inauguré par la Direction Nationale Plan vers le milieu des années1980. Elle nous invita avec Momar-Coumba (Sociologie), Mamadou Diouf (Histoire), Tafsir Ndiaye (Droit), Pros-per Youm (Économie), etc., tous iconoclastes qui influencèrent fortement le document final. À partir de cet exercice, notre petit groupe d’universitaires décida, sous l’im-pulsion de Momar, de partager avec le public nos réflexions lors de l’exercice de prospective, mais avec un focus sur les fondements structurels et les mécanismes struc-turels qui expliquaient la situation du Sénégal à l’époque. Le résultat publié fut Sénégal, Trajectoires d’un État (1960-1990), Dakar, CODESRIA, 1992. À cette occasion, Momar prit tour à tour ses habits de sociologue, de documentaliste, et d’éditeur.
Des habits qu’il continua à porter jusqu’à son décès.Max était un homme rigoureux dans tout, mais d’une simplicité désarmante. Il croyait à l’amitié sans calcul, et à l’engagement sans compromission. Il aimait travailler avec les historiens, car il pensait que les sociétés évoluent à leur propre rythme, sans forcément s’arrimer à mouvement planétaire. En fait, des causes similaires peuvent avoir des résultats diffé-rents, et cela sous l’effet des facteurs historiques propres à chaque société. Et on peut dire que c’est ainsi que Momar adopta lhistoriens et que les historiens adoptèrent Momar.
Professeur Boubacar Barry
J’ai écrit la préface pour l’ouvrage en hommage à Momar avec des témoignages de l’ensemble des collègues en sciences sociales sur Momar-Coumba Diop. Je dois dire que je ne pouvais pas exprimer toute l’affection et toute la reconnaissance de tous ces chercheurs qui ont partagé avec Momar l’angoisse et la joie de la recherche. J’ai rencontré Momar grâce à mes jeunes collègues Mamadou Diouf et Mouhamadou Mbodj, qui étaient très pertinents et qui avaient l’art de provoquer tout le monde. On doit beaucoup à ce petit groupe et à leur rigueur scientifique dans la période après Mai68.Momar était un chercheur en sciences sociales complet. Il savait écouter les gens et les rassembler pour produire un savoir pour comprendre le monde et comprendre l’Afrique. C’est le pourquoi du titre de l’ouvrage avec les mélanges en son honneur. Parmi ses ouvrages, Le Sénégal sous Abdou Diouf a ouvert la voie aux autres. Jean Copans dira de cet ouvrage qu’il « deviendra l’ouvrage fondateur de ce qu’on pourrait appeler par la suite “l’Observatoire des sciences sociales” ». Je comprends la peine de tous ceux qui voient se terminer une collaboration de longue haleine. Il suffit de lire les ouvrages de Momar pour voir le nombre de relations qu’il a tissées aux niveaux sénégalais, africain et mondial. Ces ouvrages collectifs sont plus nombreux que ses ouvrages personnels, c’est une marque de générosité.Je lui ai parlé longuement le 4 mai avant de partir pour les États-Unis. Nous avons échangé sur ce que je devais faire concernant d’une part, la préface de l’ouvrage de grande synthèse de ses travaux, et d’autre part, la réédition de l’ouvrage sur le Sénégal et ses voisins dont je dois écrire la postface.Mon ami Momar-Coumba Diop laisse un patrimoine très riche en manuscrits et en travaux inachevés, il faut des équipes multi- et transdisciplinaires pour terminer ce qu’il a commencé.
Professeur Babacar Fall « Baker »
Historien de l’Institut d’Études anAvancées de Saint-Louis et ami de longue date de Momar Coumba Diop, il se rappelle avoir connu Momar qui était surnommé affec-tueusement « Max » à la cité universitaire au début des années1970. « Il est arrivé un an avant moi, lui en sociologie et moi en histoire et on a sympathisé. Momar-Coumba Diop fut le premier disciple de Abdoulaye-Bara Diop, suivi de mon frère Abdou-Salam Fall. Puis il est parti faire ses études à Lyon. Nous avons toujours eu des relations très proches d’estime mutuelle. Nous nous sommes retrouvés par la suite à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD). De l’œuvre intel-lectuelle de Momar, c’est certainement l’ouvrage intitulé Le Sénégal et ses voisins qui m’a le plus marqué, car le Sénégal est perçu comme un pays de grande diplomatie, mais est paradoxalement victime de la logique d’extraver-sion qui a longtemps caractérisé le pays en l’éloignant quelque peu de ses voisins immédiats. » Fall, qui a collaboré à ses derniers travaux, y compris aux mélanges en l’honneur de Momar-Coumba Diop, a aussi contribué (avec un co-auteur) à un chapitre sur les relations entre le Sénégal et la Mauritanie de la nouvelle version de l’ouvrage sur le Sénégal et ses voisins. Son souhait personnel est que les deux derniers projets de Diop puissent voir le jour : la réé-dition de Le Sénégal et ses voisinset l’édition de l’ouvrage sur l’histoire intellectuelle de l’UCAD qu’il n’avait pas encore fini.« Mon seul regret est que Momar reste l’exemple des universitaires communautaire sacrifiés par un système dont les canaux de reconnaissance sont promeuvent les solitaires et les carriéristes. Mais quand tu crées des publications en communauté, ces publications ne sont malheureusement pas valorisées par le système quelque peu inique du Cames qui cautionne dans une certaine mesure l’individualisme et le carriérisme. Quand tu es un iconoclaste comme Momar, soucieux de construire une communauté intellectuelle, tu es un peu sacrifié à tes dépens. » « Le legs de Momar est immense, il suffit de voir tous les hommages qui lui sont rendus pour le constater. Le regret est que cela soit post-mortem, et donc on doit transformer le système de valorisation et de reconnaissance des intellectuels de la trempe de Momar. Momar, c’est un peu la mauvaise conscience du système. Mais les travaux de Momar sont fondateurs, car ils rendent compte de toute une période sur l’économie arachidière puis sous Diouf et Wade et ces travaux sont décidément incontournables. »
Professeur Ibrahima Thioub
Historien et ancien recteur de l’UCAD, qui a écrit l’introduction des mélanges cités plus haut, il retient de Momar-Coumba Diop sa rigueur de chercheur en sciences sociales et sa capacité à servir de mentor aux intellectuels de toutes générations. Aussi se remémore-t-il avec émotion sa première rencontre avec Momar, qui eut lieu dans un couloir du département d’histoire, la semaine où Thioub fut recruté à ce département de l’UCAD.« Il me dit: “Vous êtes la nouvelle recrue du département ? Est-ce que la recherche vous intéresse ?” Après mes deux réponses positives, il me dit avant de disparaître, sans me dire son nom : “Quitte ce couloir, car rien n’intéresse ceux qui y restent à papoter !” »Thioub contribuera par un chapitre à l’ouvrage Le Sénégal et ses voi-sins coordonné par Diop, puis à l’ouvrage sur Le Sénégal contemporain par un autre chapitre, qui l’a particulièrement marqué, car « Momar m’a fait écrire puis réécrire ma contribution à l’ouvrage pendant un an », l’encourageant à aller au-delà de ses limites « par une constante et douce pression ». Et l’ancien recteur de l’université de Dakar de préciser que toutefois, l’ouvrage qui l’a le plus marqué reste Sénégal, trajectoires d’un État, à cause des riches contributions de Souleymane Bachir Diagne sur « L’avenir de la tradition » et d’Aminata Diaw sur « La démocratie des lettrés », laquelle scella son « amitié indéfectible » et sa complicité » avec la défunte professeure de philosophie. Enfin, Thioub souligne la générosité intellectuelle de Momar et sa capacité à encadrer, à servir de mentor aux plus jeunes. Son seul regret est que Momar Coumba Diop, qui avait une vision prospective incroyable, ait dédié tout son temps et son énergie à « faire les carrières uni-versitaires des autres [les nôtres], au détriment de la sienne ». Il se souvient du reste du seul conseil qu’il [Diop] lui a donné quand il fut nommé recteur: celui de nommer un directeur des archives au rectorat.
Docteure Fatou Sow
Sociologue du CNRS et de l’Ifan à la retraite, elle livre ce témoignage:« Lorsque j’ai rencontré Momar-Coumba Diop, il appartenait à une génération beaucoup plus jeune que la mienne (nous avons dix ans de différence). C’était celle de jeunes frères et neveux. Je suis entrée à l’université de Dakar, bien avant lui. J’ai commencé à la faculté des lettres, puis ai été transférée à l’IFAN lorsque le département de sociologie a été fermé sur décision du président Senghor. Je ne l’ai pas connu comme enseignant au dépar-tement de philosophie où il a com-mencé sa carrière. Il m’a rejointe à l’IFAN où il a continué sa carrière, pour des raisons médicales que je ne connaissais pas à l’époque. C’est lui qui m’a rendu visite dans mon bureau, car, disait-il, “je connais bien tes jeunes frères et sœurs”, pour lesquels il avait une grande affection. J’avais aimé cette approche très familiale et bien sénégalaise. Nous avons renforcé durant toutes ces années nos relations d’amitié affectueuse, qui ont été à la base de nos relations acadé-miques. Il avait une grande affec-tion et une admiration profonde pour mon mari, Pathé Diagne, qui le lui rendait bien.Je ne peux pas dire de Momar qu’il m’a formée ou influencée. Nous n’entretenions pas ces rapports. Ce que je retiens de lui, c’est sa grande maturité intellectuelle, sa rigueur scientifique, son exigence de qualité. Il avait cette réputation, tant et si bien qu’il était souvent sollicité pour des relectures critiques de tra-vaux de ses collègues et d’autres personnes. Il avait cette qualité ex-ceptionnelle de scruter vos écrits et vous en sortiez enrichi, tout en gardant sa modestie habituelle. Il avait le sens du partage. Il a fait publier de nombreux travaux de jeunes chercheurs et chercheuses qui n’auraient pu le faire sans lui. L’université de Dakar n’offrait pas cette opportunité et les maisons d’édition étrangères étaient prudentes.Momar a enrichi les sciences so-ciales africaines par ses propres travaux. Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il y a associé avec générosité et compétence ses collègues. C’était un honneur et un défi de travailler avec lui, car tout en vous faisant confiance, il vous obligeait à une production de qualité. J’aimais plusieurs de ses ouvrages qui donnaient de belles informa-tions, d’excellentes analyses sur le Sénégal et ses voisins. Tous ces travaux sont des mines de ressources pour la recherche. Mais j’avoue avoir un faible pour le volume sur L’art de gouverner, dans lequel j’ai publié un article sur les femmes et la terre et ma chère Aminata Diaw, philosophe, sur les femmes à l’épreuve du politique. J’avais aimé qu’il écrive en introduction :« Les contributions présentées dans cet ouvrage par Aminata Diaw, Fatou Sow, Philippe Antoine, Agnès Adjamagbo et Fatou Binetou Dial s’éloignent de certains clichés et raccourcis, ces paroles paresseuses qui empêchent de penser et de dire la vérité à propos des femmes. »
Pr Adebayo Olukoshi
Professeur distingué à l’université du Witwatersrand et ancien secrétaire exécutif du CODESRIA, il a rencontré feu Momar pour la première fois dans les couloirs du Codesria. C’était pendant les années où Thandika Mkandawire était à la tête du Conseil. « C’était une période où beaucoup d’entre nous, la troisième génération de spécialistes des sciences sociales africaines, at-teignions la majorité et le Codesria était le point central de notre quête d’alternatives aux sciences sociales traditionnelles… » Sa première impression de Momar est la suivante : « Dans les insurrections universi-taires que beaucoup d’entre nous ont essayé d’organiser, je me souviens que Momar était de loin l’un des collègues les plus calmes, les plus doux et, sans doute, les plus réfléchis. Il prenait son temps pour intervenir dans un débat, mais lorsqu’il le faisait, sa contribution était tou-jours d’une profondeur qui exigeait une attention particulière. Son “jumeau” à l’époque était Mamadou Diouf, éminent historien avec qui il a réalisé quelques publications communes. À l’époque, il était difficile de faire la différence entre les deux ; ils nous ont inspirés en tant qu’excellent duo de jeunes uni-versitaires qui ont ouvert la voie avec un courage admirable et un esprit de collaboration.» À la question de savoir ce qu’il re-tient de la contribution de Momar, Olukoshi dira que selon lui, la plus grande contribution de Momar et le plus grand impact qu’il a eu sur lui découlent de ses contributions à notre compréhension des nuances de la politique contemporaine du Sénégal. Selon lui, Momar combinait des connaissances approfondies avec une capacité d’analyse compétente, ce qui signifie que plusieurs de ses interventions en sont venues à acquérir un statut sui generis. Son dernier hommage à Momar est le suivant :« En Momar, nous avons eu la chance d’avoir un érudit de premier ordre qui se distinguait également par les grands principes humanitaires selon lesquels il organisait sa vie. Le vide qu’il laisse sera extrême-ment difficile à combler, mais nous espérons que son exemple incitera de nombreuses autres personnes à perpétuer son héritage. Adieu cher collègue et ami. »
Dr Cheikh Oumar Bâ
Socioanthropologue et directeur de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), il se rappelle avoir rencontré Momar en tant que jeune étudiant en 1994 dans le cadre de la rédaction de sa thèse et a par la suite connu 30 ans de compagnonnage avec lui. Comme il le souligne :« Cela en dit long sur la constance dans l’amitié que Momar porte à ses amis. Depuis lors, on a gardé le contact. Il y a moins d’un an, il m’a dit qu’on devait faire un livre sur les politiques agricoles au Sénégal. On peinait à le finaliser et il m’a mis en contact avec Ibnou Diallo, l’un des intellectuels sénégalais et africains les plus prolifiques, Momar personnifie la générosité: c’était un “passeur intergénération-nel”. Avec la création du Crepos, ils furent une dizaine de jeunes chercheurs avec Momar, dont Al-fred Inis Ndiaye, Ibrahima Thioub, Mansour Tall et Cheikh Oumar Bâ. On a servi comme premiers membres du Crepos. À la création de l’Ipar, Momar nous a permis de décrocher une bourse de recherche de l’Union européenne. Pour moi, les qualités principales de Momar sont la simplicité, la bonté, la rigueur scientifique et l’honnêteté intellectuelle.Son livre sur La Société sénégalaise. Entre le Local et le Global est l’un des livres qui m’ont le plus marqué. »
Professeure Fatoumata Hanne
Socioanthropologue à l’université Assan-Seck de Ziguinchor, elle pour sa part a rencontré Momar à l’IFAN dans le bureau de Abdou Salam Fall au cours de son DEA de socioanthropologie sous la direc-tion du professeur Abdoulaye-Bara Diop. En 2000, elle travaillait avec Tidiane Ndoye et Abdou-Salam Fall sur l’apport de l’Internet dans la mise en réseau des organisations de la société civile, dans le bureau de ce dernier qui se situait non loin de celui de Momar. De cette première rencontre physique avec Momar-Coumba Diop, dont elle avait étudié les textes lors du cours d’Alfred Inis Ndiaye, ce qui l’avait le plus marqué fut son humilité et son élégance intellectuelle.
D’entrée de jeu, il s’est intéressé à notre travail et a partagé des idées sur le fonctionnement des organisations de la société civile, orientant ainsi de manière très subtile l’analyse que nous pourrions en faire. Plus tard, en tant que consultante junior sur un autre projet de Abdou-Salam Fall sur les approches quali-tatives de l’étude de la pauvreté, Momar leur avait fourni de riches contributions quant à l’orientation de leur travail, au détour de conversations anodines. Momar lui fit aussi des suggestions de lecture des ouvrages du CODESRIA et la mit en contact avec Aminata Diaw et Jean-Bernard Ouédraogo. Il n’eut de cesse de partager des opportunités de financement de recherche.« Son ouvrage qui m’a le plus mar-qué est :Sénégal. Trajectoire d’un État, car il y offre une nouvelle lecture de la construction de l’État à travers la portée et la signification des pratiques, notamment du modèle wolof de l’État. Cet ouvrage a inspiré le cadre théorique de mon travail de thèse et m’a poussée à lire les politiques publiques d’une autre manière pour analyser leur influence sur le champ sanitaire et leur capacité à produire des reconfigurations professionnelles qui vont donner lieu à des formes d’administration et de gouvernance assez particulières. Momar avait un côté visionnaire, car il a montré comment la trajectoire économique, notamment celle des laissés-pour-compte, a produit des formes de violence particulières. »
Dr Hamidou Dia
Socioanthropologue, chargé de recherche à l’Institut de Recherches pour le Développement (IRD), il a connu Momar en 2006 par l’intermédiaire de Jean Copans qui était son directeur de thèse, et est resté en contact avec lui depuis lors. Copans lui a suggéré de le rencontrer en lui disant que c’était un des plus grands chercheurs africains, et que faire sa connaissance allait lui être bénéfique. Lors de leur rencontre à Dakar, Momar lui a donné beaucoup de conseils: sur la socialisation professionnelle, sur la pratique du terrain, sur les concepts, les méthodes et les outils, sur les pratiques d’écriture et éditoriales… Momar lui a aussi donné beaucoup de contacts. À la question de savoir quelle influence Momar a eue sur lui, Hamidou dira s’être « africanisé » (sic) à son contact. En effet, selon lui, Momar lui a ouvert tout un pan de la recherche africaine en sciences sociales qu’il ne connaissait pas. Momar l’a ouvert au travail comparatif, à l’intérêt pour l’approche multidisciplinaire des objets. Mais c’est le goût de Momar pour le travail interdisciplinaire qui le marquera le plus :« Momar travaillait beaucoup avec les historiens, les politistes… les économistes, les linguistes… les anthropologues… donc c’était quelqu’un de très ouvert personnellement et scientifiquement. » À la question de savoir lequel des ouvrages de Momar l’a marqué le plus. Hamidou répondra :Le Sénégal sous Abdoulaye Wade, qui est selon lui « un ouvrage de maturité »,du fait que Momar était rodé à la pratique de l’écriture collective, donc possédait le sens du questionnement, maîtrisait la mise en perspective, faisait dialoguer les disciplines et organisait la pluralité du regard sur le Sénégal. Selon lui, ce chef-d’œuvre qui a nécessité deux tomes est « son ouvrage le plus complet ».
Docteur Serigne Mansour Tall
« J’ai connu Momar il y a très longtemps quand je préparais ma thèse sur les investissements im-mobiliers des émigrés. Il m’a aidéà affiner ma problématique. Plus tard, quand j’étais à l’IRD (Orstom), on nous demandait de le rencontrer pour partager avec lui nos méthodologies et nos résultats de recherche. Il m’a accompagné dans mes premières années de re-cherche. Ma soutenance a coïncidé avec un travail qu’il a coordonné avec Thandika Mkandawire, avant sa transition vers l’Institut de Recherche des Nations unies pour le Développement Social (UNRISD), sur les technologies de l’infor-mation et de la communication. Momar a fait appel au Dr Cheikh Guèye et à moi-même pour des contributions et nos articles ont été retenus pour être publiés dans la Revue d’Économie Politique Africaine (ROAPE). Momar me demandait aussi de relire des textes ; il précisait “Mansour, je veux une correction hostile”, c’est-à-dire une révision très critique.Son ouvrage qui m’a le plus mar-qué fut Le Sénégal des migrations, car il n’existait auparavant aucun ouvrage faisant l’état des lieux sur cette question qui était l’apanage du Nord. Le fait d’avoir publié et réuni les chercheurs, y compris moi, qui travaillaient sur cette thé-matique, était novateur. Tous ses ouvrages portaient les points de vue des chercheurs africains à tra-vers des problématiques d’intérêt pour le continent et pour le monde.En définitive, on aimait tous Momar pour sa discrétion. Il réunis-sait des expertises transversales des sciences sociales et fédérait des réflexions croisées dans une approche intégrée sans pour au-tant se mettre au premier plan. Il relisait et faisait relire des articles, affinait la problématique des uns et des autres. Il se battait pour que les gens soumette dans les délais afin d’être publiés. Il sait beaucoup donné pour l’édition scientifique africaine.»
Docteure Ramata Thioune
Économiste et environnementaliste, elle a connu Momar-Coumba Diop au Centre de Recherche sur le Développement International (CRDI) qu’il fréquentait assez régulièrement avec ses collègues feu Alioune Camara et Moussa Dramé, anciens de l’École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD). Elle se rappelle de conversations qui étaient très profondes et engagées autour des problématiques majeures gouvernant le Sénégal, sa passion. Ramata demeure fascinée par la constance et l’engagement de Momar-Coumba Diop pour des ttransformations profondes nécessaires au développement de son pays. Si elle a éprouvé un grand plaisir à lire tous les ouvrages du sociologue, celui portant sur le Sénégal sous Abdoulaye Wade l’a particulièrement tntouchée. Au-delà de l’homme Wade, ce livre expose les opportunités, mais surtout les facteurs structurels qui plombent le décollage du proces-sus de développement économique et social de notre pays, contraintes qui, pour elle, sont pour la plupart encore très actuelles.
Docteure Ndeye Astou Ndiaye
Politiste, elle a rencontré Momar Coumba Diop « doublement » :d’abord à travers ses écrits, notamment à travers l’article « Le baobab déraciné » avec feue Aminata Diaw et Mamadou Diouf, puis durant sa double licence en droit et en science politique.
«À mon retour de Bordeaux, je l’ai rencontré chez lui à la cité des enseignants par le truchement d’un ami proche universitaire, alors qu’il était déjà malade. Je regrette de ne pas l’avoir connu plus jeune. L’ouvrage qui m’a principalement marqué fut La Construction de l’État au Sénégal avec Donal Cruise O’Brien et Mamadou Diouf. Cet ouvrage me semble capital, car c’est un travail très fouillé de trois chercheurs avec des trajectoires différentes touchant différents domaines – politique, économique, religieux –, de manière historique et prospective. Ce travail m’a don-né envie de faire un travail ethnographique plus rigoureux pour medéfaire de toutes ces idées qu’on avait de l’Afrique comme terrain, afin de mieux voir l’État.»
Docteur Hady Bâ
Philosophe, il a rencontré Momar-Coumba Diop dans le cadre de ses activités syndicales. Il a beaucoup d’admiration pour le travail intellectuel de Momar sur l’histoire politique du Sénégal. Pour lui, il était important que ce travail soit mené et organisé par un Sénégalais de la trempe de Momar, qui avait une vision distanciée et interne de l’histoire politique du Sénégal. En tant que catalyseur, il a pu réunir les plus grands penseurs sénéga-lais et africains et d’autresintellectuels vivant au Sénégal pour les faire travailler ensemble à la documentation de ce qui se passe dans le pays. L’ouvrage de Momar- Coumba Diop qui l’a le plus marqué est Le Sénégal sous Abdou Diouf.
Pr Ferran Iniesta(Message au Pr Babacar Fall, publié avec leur autorisation).
«Mon cher ami, Le temps s’écourte pour nous tous. Momar Coumba, notre ami (toi, tu me l’avais presenté, et aussi à ton frère Abdou Salam) est déjà parti et il laisse un vide : heureusement, on a plein de bons souvenirs, mais il n’est plus parmi nous.Son départ m’a pris par surprise, avec la tristesse de ne pas lui avoir dit au revoir, mais aussi avec la compensation d’avoir échangé souvent avec lui pour la prépa-ration de nos textes destinés aubouquin d’hommage… et aussi un soulagement savoir qu’il l’a vu publié et que nous tous nous avons pu nous écrire et même causer par whatsapp longuement. Sentiments contradictoires, mais il a été une personne magnifique, bien au-de-là de ses qualités de scientifique qui l’ont distingué.»
Source: Codesria
Photos: Sud Quotidien, Codesria
Notes1. Y compris celui-ci : Changement agraire, sécurité alimentaire, mi-gration et développement durable au Sénégal et au Zimbabwe (nu-méro thématique), Afrique et dével-oppement, vol. 47, no 3, 20222. “An Open letter to a Young Researcher”, A f r i c a n A ff a i r s.

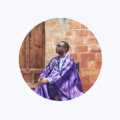


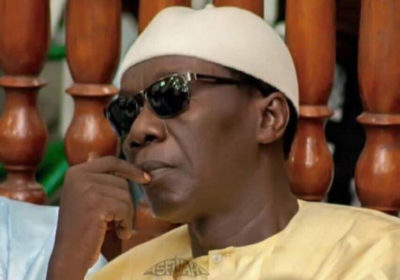
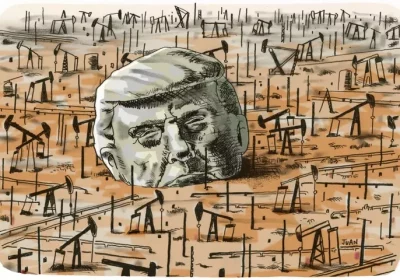





Laisser un commentaire