La Guinée a accueilli la majorité des réfugiés fuyant les guerres civiles sierra-léonaises et libériennes au tournant du millénaire. Sur les sites des anciens camps, l’histoire ne s’est jamais vraiment effacée.
En Guinée forestière, le long d’une piste quittant la route nationale qui relie Conakry à N’zérékoré, Kouankan est un gros village presque comme les autres. C’est ici que l’un des plus importants camps de réfugiés du continent s’est installé au début des années 90 pour accueillir les populations civiles fuyant le Libéria voisin, et dans une moindre mesure la Sierra Leone, en proie à une terrible guerre civile qui s’éternisa jusqu’au début des années 2000. La localité conserve les stigmates de cette période troublée, à commencer par son camp, devenu village annexe peuplé de réfugiés toujours aussi désabusés.
En ce mois d’août pluvieux, Youssouf Soumaoro, fils du chef de quartier Kouankan 2 défunt deux jours plus tôt, me guide à pied à travers brousse vers ce que l’on appelle toujours « le camp des Libériens ». Et pour cause, 206 familles, soit environ 900 personnes, y viventencore. Une goutte d’eau en comparaison avec les 40 000 réfugiés qui s’y sont entassés au pic de la guerre civile. Néanmoins, un sort peu enviable s’y déroule. En chemin, les travailleurs agricoles délaissent de plus en plus le français au profit de l’anglais pour nous saluer.
En effet, si le camp de réfugiés abrite plusieurs groupes ethnolinguistiques comme les Mandingo (Malinkés côté guinéen), les Loma (Toma côté guinéen), les Kissi ou les Bandi, tous sont liés par la maîtrise de l’anglais, le Libéria étant un pays anglophone contrairement à la Guinée issue de l’ancien empire colonial français. C’est donc dans cette langue que nous échangeons avec le responsable du camp Fombah Junior Dulleh et son équipe, ainsi qu’avec les nombreux curieux venus assister à la rencontre. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui administrait le camp lors de la crise, se serait retiré en 2017, après avoir mis en œuvre son plan de rapatriement volontaire des réfugiés.
Depuis, les réfugiés restés au camp n’ont bénéficié d’aucune aide. Pourtant, une catégorisation avait bien été instaurée par le HCR afin de distinguer les réfugiés désireux de rentrer au pays de ceux préférant rester. Mais voilà, la majorité des personnes encore présentes au camp de Kouankan ont besoin d’une troisième alternative.
À leurs yeux, vingt ans après les accords de paix, un retour au Liberia reste impensable en raison des traumatismes subis, mais également des conditions de sécurité insuffisantes. Car si le gouvernement libérien a tout fait pour convaincre la communauté internationale que la paix et la stabilité étaient de retour sur le territoire, certaines communautés exilées appréhendent le retour dans un pays ethniquement fragmenté où les équilibres ont été bouleversés. Selon les responsables du camp, les incursions de rebelles libériens à Guéckédou en 2000 et 2001 visaient, du moins en partie, la communauté libérienne exilée en Guinée.
Il faut dire que même les rapports du HCR font état de la présence d’éléments armés au sein du camp de réfugiés de Kouankan, au moins lors de l’année 2002. Ainsi, il est également probable que certains réfugiés réticents à l’idée d’un retour puissent l’être en raison d’une implication passée dans le conflit. En outre, un ancien réfugié libérien devenu entrepreneur justement rencontré à Guéckédou dévoile les trois raisons ayant pu conduire, selon lui, les réfugiés à rester en Guinée : les traumatismes subis au Libéria, la survenue d’un mariage mixte ou lorsque la Guinée est la terre d’origine des ascendants.
Emmanuel Tono, de son nom, confie plus tard se trouver dans cette dernière situation. Bien que conscient de l’existence de ces réfugiés en dehors de ses frontières nationales, le gouvernement libérien n’a jamais proposé de plan ni même manifesté de volonté pour les rapatrier.
Malheureusement, si les anciens ont leurs raisons de ne pas rentrer en Libéria et que les jeunes générations ont été bercées par les récits de leurs aînés, l’intégration des réfugiés du camp de Kouankan ne semble pourtant guère plus évidente. La persistance d’un mode de vie communautaire sur le site de l’ancien camp en est l’illustration, qui plus est dans des conditions difficiles.
Les habitations de fortune en terre cuite semblent avoir remplacé les tentes du HCR. Certaines infrastructures de l’institution ont certes été récupérées, mais le manque de moyens humains et financiers n’a pas permis de les pérenniser. L’ancien hôpital abrite désormais des chambres d’habitation précaires, tandis que l’école est abandonnée et que la pompe du forage n’est plus fonctionnelle. Résultat, ici pas d’accès à l’eau potable, à l’électricité, aux soins ou à l’éducation pour les enfants.
Même si les écoles de Kouankan pourraient accueillir ces derniers, l’éducation se paye encore en Guinée, ce qui limite son accès par endroit. De toute façon, les familles de réfugiés n’expriment pas une grande volonté d’intégration, y compris pour les enfants, qu’elles préfèrent ne pas envoyer dans les écoles francophones, d’autant que réfugiés et autochtones partagent parfois déjà des langues locales. L’absence de volonté donc, mais aussi la peur de l’intégration, par crainte qu’elle ne les enferme ici.
C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle beaucoup de réfugiés ne sont pas enregistrés comme tel, la seconde étant la complexité des démarches administratives. Cependant, même les habitués du renouvellement de la carte de réfugié rencontrent des difficultés pour y parvenir ces dernières années, au point de voir leur document expirer, sans solution. Selon eux, les administrations concernées ne répondent plus aux sollicitations. Une absence de réponse ne signifiant pas un refus, il est possible que le coup d’État de 2021 qui a bousculé l’administration soit à l’origine de ces dysfonctionnements. À moins que le plaidoyer du Libéria en faveur d’une acceptation internationale de son calme retrouvé n’ait accéléré la fin des octrois du statut de réfugié.
Quoi qu’il en soit, les moyens de subsistance sur place sont limités aux travaux agricoles, généralement comme main d’œuvre bon marché pour des paysans de Kouankan ou locataire de terrain. Les conflits fonciers pour cultiver son propre jardin sont monnaie courante et témoignent de la difficulté à installer un modèle de cohabitation sain et durable, à défaut d’un départ ou d’une réelle intégration. En réalité, cette affaire est symptomatique de l’enjeu global de l’accompagnement et du suivi post-guerre.
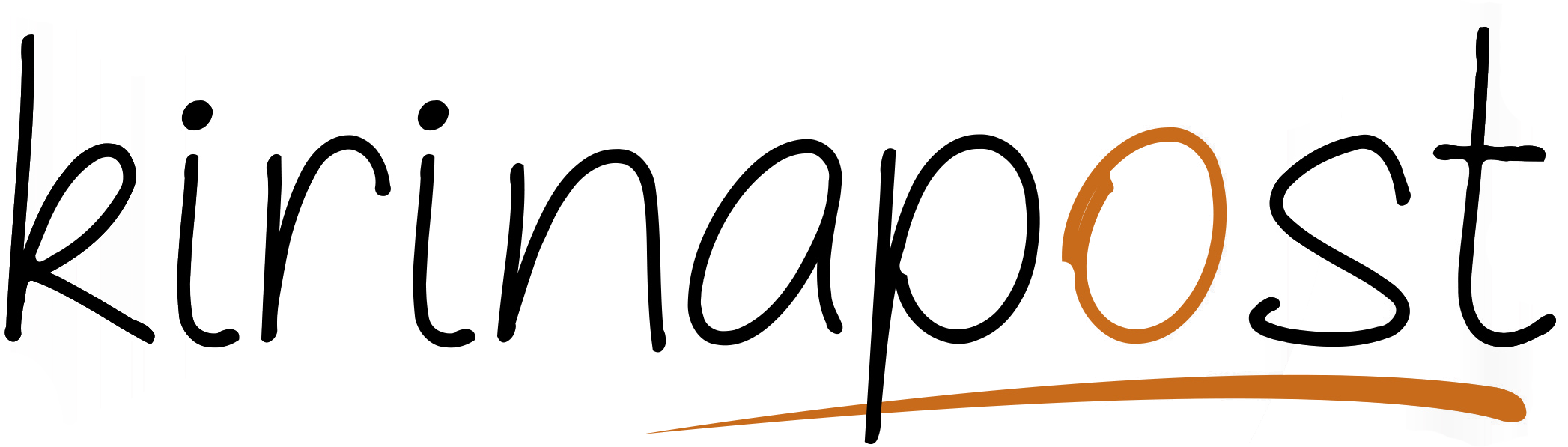










Laisser un commentaire