Maître des percussions, éducateur et fervent panafricaniste, Olatunji a influencé à peu près tout le monde aux États-Unis où il a élu domicile, de John Coltrane à Spike Lee, tandis qu’en Europe, c’est un autre grand artiste, Serge Gainsbourg, qui a « emprunté » les rythmes de Babatunde pour son album Gainsbourg Percussions, sorti en 1964. Source: Lucas Keen pour Panafrican music.
Dans son autobiographie publiée à titre posthume, le percussionniste explique que l’art du tambour est « une sorte de trinité très spéciale » constituée de l’esprit de l’arbre dans lequel le fût est taillé, de la force vitale de l’animal dont le cuir devient la peau du tambour, et du propre esprit de celui qui le frappe. Trois éléments qui, ensemble, produisent « une force irrésistible » et fournissent « l’équilibre qui confère au tambour son pouvoir de guérison ». Revenons sur la vie de Olatunji en une trinité d’actes, comme autant d’hommages rendus à l’artiste.
Le gosse du village
L’histoire d’Olatunji est digne de celle d’Homère, rien de moins. Né en 1927 dans le petit village de pêcheurs d’Ajido, à une soixantaine de kilomètres de Lagos, il reçoit le nom de Babatunde, qui signifie « le père est revenu », car il voit le jour deux mois à peine après le décès de son père, qui était en passe de devenir le chef de la communauté. Alors que ses proches nourrissaient l’espoir qu’il prenne la place de son père, c’est finalement sa mère, potière de profession, qui déterminera le parcours de l’enfant.
Dans son livre The Beat of My Drum, Babatunde raconte : « Il n’existait pas d’école de percussions, mais n’importe quel gosse au village est en contact avec les tambours, les danses et les chants… Moi, je suis allé plus loin, car j’ai décidé de suivre les joueurs de tambour partout où ils se rendaient. Ils allaient de marché en marché, de village en village, et je ne les lâchais pas. » Consciente de la passion de son fils, la mère de Babatunde lui fabrique son premier tambour, un instrument en argile appelé « apesin », et son destin sera dès lors scellé.
Adolescent, il s’installe dans la capitale fédérale et poursuit sa formation musicale au sein de l’Église méthodiste, où on l’embauche comme choriste et accompagnateur. Jeune adulte dans la capitale, c’est par hasard qu’il tombe dans le magazine Reader’s Digest sur un article évoquant une bourse d’études au Morehouse Liberal College of The Arts d’Atlanta, une « université traditionnellement noire » [Historically Black Colleges and Universities – HBCU; NdT], auquel il dépose une candidature. Suite à son admission, il quitte le Nigéria pour les États-Unis en 1950.
Le panafricain
« Ils n’avaient aucune idée de l’Afrique », écrira Babatunde à propos de cette époque. Conscient de la nécessité d’éduquer ses pairs au sein de Morehouse, Olatunji se lamente, lui qui avait envisagé une carrière de diplomate avant de quitter le Nigéria : « L’Afrique avait tant apporté à la culture mondiale, et pourtant ils n’en savaient rien. Je les invitais dans ma chambre et nous parlions de leur héritage africain. » Formant une troupe de tambours et de danse, il commence à animer des programmes scolaires sur les arts du spectacle africains. Et voici que la transmission de la pratique du tambour, qui allait devenir l’œuvre d’une vie, commence pour de bon.
Élu président de la All-African Students’ Union of the Americas, il participe à la All African People’s Conference à Accra en 1958, où il côtoie rien de moins que WEB DuBois, Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba. La même année, il entre en contact avec l’arrangeur du Radio City Music Hall, Raymond White, qui l’invite à collaborer sur un spectacle donné dans ce célèbre music-hall de New York. Leur African Drum Fantasy sera montré quatre fois par jour, pendant sept semaines, et c’est lors de l’une de ces représentations que Babatunde est repéré par Al Han, alors directeur de Columbia Records.
Han signe immédiatement un contrat avec le jeune percussionniste et, ainsi débute « l’Année de l’Afrique » de Babatunde avec la sortie en février 1960 de son premier album, Drums of Passion, chez Columbia Records. Avec les arrangements de Babatunde pour ensemble de batteurs et de voix, ce glorieux enregistrement stéréo donne à entendre un chant de louange à l’orisha Shango exécuté sur le motif transatlantique de la cloche, version longue, qui inspirera nombre de batteurs de jazz tels qu’Elvin Jones et Art Blakey.
L’album compte également la chanson « Jin-Go-Lo-Ba », qui mérite que l’on s’y penche avec attention. Conversation rythmique entre le tambour mère (iya ilu) et le tambour bébé (omele) qui souligne un chant très entraînant en forme de question-réponse, « Jin-Go Lo-Ba » sera « emprunté » par Serge Gainsbourg quatre ans plus tard pour son disque Gainsbourg Percussions, dissimulé sous le titre « Marabout ». Gainsbourg a également repris certaines des interpolations « Kiyakiya » et « Akiwowo » de Drums of Passion ainsi que certains éléments du « Umqokozo » de Miriam Makeba. Malheureusement, ce sampling avant l’heure a été réalisé sans l’autorisation des auteurs, et Babatunde ne sera jamais crédité. En 1969, c’est au tour du groupe de rock latino Santana de reprendre « Jin-Go-La-Ba » rebaptisé « Jingo » sur leur premier album éponyme, où l’on découvre que Carlos Santana est cité comme auteur-compositeur, bien que la chanson ait été entièrement composée autour du riff musical du morceau de Babatunde. La Suite ICI.
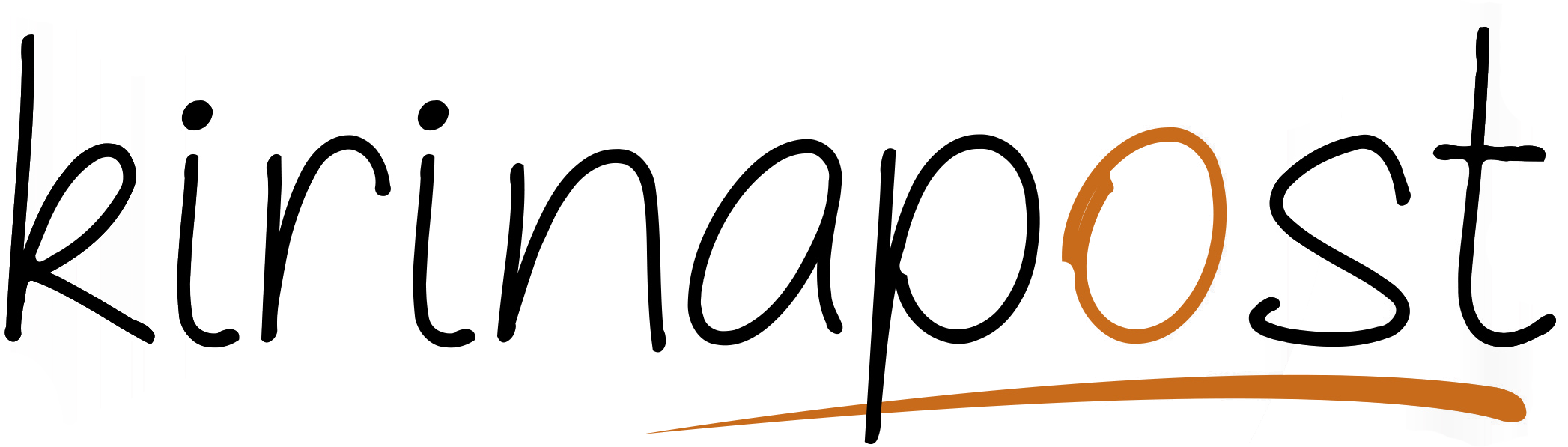



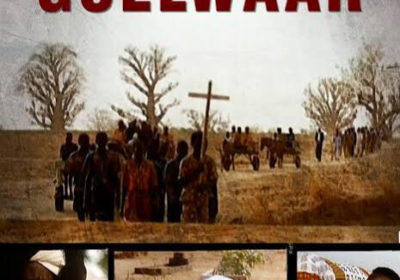
![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-400x280.jpg)





Laisser un commentaire