L’écrivain Boubacar Boris Diop, Prix Neustadt 2022 a prononcé le discours inaugural du Neustadt Lit Fest (Le Neustadt Lit Fest est parrainé par le magazine de renommée internationale de l’Université de l’Oklahoma, World Literature Today) le 25 octobre dernier aux Etats-Unis. Un événement retransmis en direct dans une quarantaine de pays. » J’aimerai vous raconter l’histoire de Youmané. » C’est par ces mots, que le penseur sénégalais a attaqué son allocution…
Dans cette histoire-là, l’orpheline à peine sortie de l’adolescence s’appelle Youmané. J’aime tant ce nom que je me demande aujourd’hui encore si je ne l’ai pas inventé moi-même. Je n’écoutais en effet pas passivement la conteuse, mes vives réactions faisaient partie intégrante du déroulement de son récit. Youmané, donc. Sa mère lui a interdit d’aller aux séances de tam-tam nocturnes mais l’appel du rythme la rend quasi folle et elle s’y rend en secret chaque soir, « quand la terre est froide » comme disait joliment la conteuse. Youmané ne se rend juste pas compte qu’elle est le seul être humain normal dans une assemblée d’êtres surnaturels, les « Djinns ». Elle y noue une idylle avec un jeune homme, bien évidemment beau en diable. Et ce qui ne devait pas arriver arriva : elle tomba enceinte. Mais comment fait-on pour raconter leur torride relation charnelle à des enfants de huit ou neuf ans ? Je me souviens encore avec un petit sourire amusé de la petite merveille narrative de la conteuse : chaque nuit, disait-elle, un vent violent soulevait la robe de Youmané sur le chemin du retour chez elle. Rien de plus. Mais au bout de quelques coups de vent qui étaient en réalité de sauvages coups de reins, elle tombait enceinte !
Que se passait-il ensuite ? Si Youmané a été punie par sa mère ou si son enfant a plus tard conquis des royaumes, je n’en sais à vrai dire rien. Et pour être franc, c’est parce que cela ne m’intéressait pas du tout. J’ai seulement en mémoire les battements de mon cœur lorsque j’imaginais Youmané seule au mileu de ces Djinns aux faces tordues ou, pis encore, triangulaires, prêts à boire son sang à chaque instant. Le fait est que des innombrables fables que j’ai entendues dans ma prime enfance, il ne me reste que de vagues impressions au sens littéral du terme, le souvenir fragile de couleurs bleu-de-nuit ou grises comme sur un tableau et, dans cet abîme de formes enchevêtrées, des êtres vulnérables face aux éléments déchaînés. Et soit dit au passage, ces êtres apeurés étaient souvent des jeunes femmes, comme dans le conte du « Bracelet de soleil » que je crois bien avoir repris sous une forme ou une autre dans la plupart de mes romans. Ce que j’ai appris très tôt avec ces histoires, c’est à quel point ce qui se passe dans un récit, son contenu en somme, est accessoire, que l’on peut bien arrêter de lire un roman avant d’arriver à sa dernière page, après une bonne provision de fulgurances narratives, que ceux qui demandent qu’on leur résume Anna Karénine – ou n’importe quelle autre grande fiction – ne savent peut-être pas au fond ce qu’écrire veut dire.
Pour une raison ou une autre – serait-ce du reste là une règle universelle ? – le conte ne pouvait êrre dit que la nuit. Cela rendait plus vrai et inquiétant cet univers fantastique auquel je me suis familiarisé bien avant la lecture de Kourouma ou d’Amos Tutuola et plus tard des auteurs latino-américains de Rulfo à Cortazar, Marquez ou Sabato, ce dernier étant un de mes auteurs préférés. Cela veut dire que le « réalisme magique » ne m’a pas vraiment impressionné : à Macondo, j’étais en terrain connu.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces contes ont été pour moi, avant même l’école qui m’avait initié aux mystères de l’alphabet, le meilleur atelier d’écriture romanesque. L’aura de ces histoires fantastiques tenait en grande partie à une certaine impénétrabilité. Le sens en était tout entier dans une sorte d’orgie sonore et dans une puissance d’évocation qui leur donnait de la profondeur. Je crois bien que si je ne m’étais pas si souvent égaré dans le dédale des paroles de la conteuse, je n’aurais pas eu plus tard tant de plaisir à relire encore et encore des ouvrages totalement hermétiques. Je ne me suis jamais senti vexé de n’avoir pas pu accéder au » message » – mot horrible entre tous… – d’un auteur. En vérité, beaucoup de textes ne m’étaient et ne me sont toujours un délice que par leurs vibrations et parce qu’ils virevoltaient, si j’ose dire, dans tous les sens. Il n’est pas étonnant que j’aie choisi de faire de Khadija, l’héroïne de mon troisième roman, Le Cavalier et son ombre, une conteuse hors pair.
Quelques années avant ces fables entendues dans la ville de Thiès, la Médina où j’étais né avait été mon école de la vie. Ou de la rue, car l’on y vivait dehors par la force des choses. Seul le recul me permet de me rendre compte aujourd’hui que c’était un bidonville d’une pauvreté crasse comme le sont de nos jours certaines zones périphériques de la ville. Adolescent, je ne ressentais nullement la misère de ce lieu d’une glorieuse modernité, à l’origine de toutes les modes. Dans Doomi Golo, la Médina s’appelle Niarela. S’y côtoyaient les plus brillants esprits, médecins et avocats, artistes et surtout sportifs, en particulier certains de ceux qui restent aujourd’hui encore les figures de légende du football et du basket-ball au Sénégal. Elle était mitoyenne du quartier européen du Plateau et n’hésitait pas à le toiser, bien qu’on fût à l’époque coloniale. Entre les deux, avait été construite Rebeuss, la plus grande prison du pays – qui s’y trouve encore – et où faisaient de fréquents séjours certains de nos aînés si prompts à défier la loi, surtout la loi des Toubabs. L’un d’eux était Yadikone, le « Bandit d’Honneur » immortalisé hors-caméra par le grand réalisateur Djibril Diop Mambety. La Medina était aussi, bien entendu, le théâtre d’affrontements épiques entre les « Rouges » de la SFIO de Lamine Guèye et les « Verts » de Senghor, poète bien plus progressiste – ou moins réactionnaire – que son rival « socialiste » d’alors, mon grand-oncle maternel, soit dit au passage. Senghor a du reste fini par devenir le Père de l’Indépendance du Sénégal et son premier président. Le pays aurait peut-être pu trouver mieux mais ça, c’est une autre histoire…
C’est là qu’est né le « Culture et Loisirs Club ». J’en étais un des fondateurs avec les frères Bèye, les jumeaux Assane et Ousseynou, Ben Diogaye Bèye devenu cinéaste de renom, feu Assane Preira et enfin Babacar Mbow le Maître de Ndem, alias « Chacun » et aujourd’hui une grande figure de la spiritualité mouride. Nous avions près de la Corniche un ciné-club où nous disséquions des heures durant les tout premiers films africains, tous des court-métrages, à l’exception de La Noire de… de Sembène Ousmane, père du cinéma africain dont le film Borom Saret a été plusieurs fois au centre de nos débats, tout comme Afrique-sur-Seine de Paulin Soumanou Vieyra, Sarzan de Momar Thiam et un de nos favoris Et la neige n’était plus… de Ababacar Samb Makharam.
Cependant nos activités les plus importantes tournaient autour des livres. Si j’y ai découvert La plaie de Malick Fall, Les bouts-de-bois-de-Dieu de Sembène, L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane ou Kocoumbo, l’étudiant noir d’Aké Loba, notre événtail de lecture allait au-delà de l’Afrique. Nous avons lu en des séances collectives parfois houleuses L’étranger de Camus ou tel autre classique français ; le nom du Grégoire Samsa de La métamorphose de Kafka revenait souvent dans nos blagues. Je me souviens aussi que l’un d’entre nous, Ousseynou Bèye, à ce jour un de mes meilleurs amis, aimait répéter le fameux « Heureusement, on peut agir… » du Chen de La condition humaine d’André Malraux. Nous organisions aussi des discussions sur l’économie et la politique. J’apprendrai plus tard que notre goût précoce pour les échanges sur les affaires de la cité avait attiré l’attention d’une formation communiste clandestine qui nous envoyait régulièrement l’un ou l’autre de ses recruteurs. Pour couronner le tout, nous avions créé un journal – ronéotypé, il va de soi – appelé « Le bourgeon ». J’en avais moi-même trouvé le titre dans un article du poète David Mandessi Diop disparu dans un crash aérien au large de Dakar à l’âge de 33 ans, texte où il écrivait ceci : « La littérature est l’expression d’une réalité en mouvement, elle part de la réalité, la capte, saisit ce qui n’est que bourgeon et l’aide à mûrir… »
En y repensant, je suis ahuri que nous ayons pu faire tant de choses à un si jeune âge…
Il n’est en revanche pas étonnant que j’aie écrit mon premier roman, La cloison, autour de la seizième année. À la main, bien évidemment, avec l’application de l’adolescent timide et affreusement bègue que j’étais. J’y racontais l’amitié entre le collégien sénégalais Kader Cissé et son condisciple français Lucien Gercet. Tous deux, de condition très modeste, fréquentaient le même lycée Van Vollenhoven, majoritairement Blanc, où j’avais moi-même subi des discriminations de la part des profs et surtout d’un certain monsieur… Luc Nègre. La cloison dénonçait donc vaillament le racisme et sa fin était d’une consternante naïveté : la « cloison », symbole de la division entre deux races, prenait feu de manière spectaculaire et les deux jeunes gens étaient réconciliés à tout jamais par cette tragédie qui les mettait l’un en face de l’autre. Je n’avais pas écrit plus de deux cents pages juste comme ça, sans savoir où j’allais : je prétendais être publié comme tous les grands auteurs que j’avais eu tant de plaisir à lire et relire. Envoyé par la poste, le plus sérieusement du monde, à « Présence africaine », en ce temps-là l’éditeur parisien de référence pour tout le monde, le manuscrit m’avait valu une lettre-standard de refus signée par un certain Jacques Howlett. D’ailleurs le nom de ce dernier est la seule chose dont je me souvienne vraiment à propos de cette mise à feu ratée.
Très vite après est arrivé le temps où, à la Fac de Lettres, il fallait se taper les classiques du marxisme et se décider clairement entre Mao, Tito, Staline, Trotsky voire un peu plus tard Enver Hodja. Cela n’empêchait heureusement pas de lire Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Mongo Beti, Amilcar Cabral et Aimé Césaire. Bien au contraire, tous ces auteurs allaient bien ensemble.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette période, y compris à propos du Club Frantz Fanon fondé dans un autre quartier dakarois où avait déménagé ma mère. Le plus important dans ces années ardentes, ça a été mes lectures en solitaire. Le centre culturel américain m’a permis à l’époque de lire tout Steinbeck mais aussi des romanciers comme Erskine Caldwell, Lumière d’août de Faulkner et Native Son de Richard Wright. Au centre culturel français, j’ai découvert et lu tout Sartre à l’exclusion de ses massifs et arides traités philosophiques. J’en étais d’ailleurs arrivé à me déclarer « existentialiste » quand mes camarades en pinçaient grave pour le marxisme et à choisir comme nom de plume celui du Boris Serguine de la trilogie sartrienne Les chemins de la liberté.
Je m’étais entiché comme presque tout le monde de la littérature latino-américaine au point d’écrire dans mon premier roman Le temps de Tamango, que « Cent ans de solitude est le chef-d’œuvre absolu de la littérature universelle. » Enthousiasme juvénile mais qui disait bien le choc émotionnel que m’avait causé le livre de Garcia-Marquez. Je serais bien plus mesuré aujourd’hui !
Toutes ces lectures et toutes ces activités, souvent extrêmement précoces, s’intégraient au parcours classique d’un auteur « francophone ».
Il y a eu cependant un coup d’arrêt à partir de 1998. C’est l’année où je me suis rendu pour la première fois au Rwanda avec un groupe d’auteurs de différents pays africains pour y constater l’ampleur des dégâts causés par le génocide contre les Tutsi et, si tel était notre désir, en témoigner dans une œuvre de fiction. Cette singulière intitiative d’écrivains allant opérer sur le terrain d’une massive tragédie contemporaine avait été baptisée : « Rwanda : écrire par devoir de mémoire ». L’expérience m’a peu à peu amené à faire du génocide des Tutsi au Rwanda le centre de ma réflexion et à privilégier ma langue maternelle dans la création littéraire. En somme : à trouver les mots pour dire en wolof un génocide qui avait complètement bouleversé mon champ mental.
De fait, Le Cavalier et son ombre, évoqué un peu plus haut, est le premier livre où je parle du génocide au Rwanda. Il avait eu lieu quatre ans plus tôt et, n’ayant jamais daigné m’y intéresser, j’y voyais, avec la désinvolture typique des auteurs de ma génération, un désastre africain « de plus ». J’étais si ignorant des faits réels survenus entre avril et juillet 1994 au Pays des Mille Collines que mon récit confondait allègrement bourreaux et victimes. Les chefs des camps de l’ex-Zaïre que j’y dépeignais en héros étaient en fait les génocidaires qui venaient de s’enfuir du Rwanda après y avoir commis les pires atrocités. L’épisode occupe certes une infime place dans le roman mais c’était tout de même bien embarrassant, au vu de l’importance historique de l’événement. Le génocide de 1994, c’était au moins dix mille morts par jour pendant cent jours et sans un seul jour de répit pour les Tutsi machetés, brûlés vifs, jetés vivants dans des fosses d’aisance ou délibérément infectés par le virus du sida. Un malheur gigantesque s’était abattu sur un petit pays d’Afrique et quatre ans plus tard je continuais à le lire à l’envers. En creusant un peu, je me suis aperçu que si les tragédies africaines se répétaient avec une sinistre régularité, c’est parce que nous ne savions ni les prévoir ni même simplement accepter de les voir pendant qu’elles mettaient des villes entières à feu et à sang.
Comment ne pas se remettre en question après un tel constat ? Je ne voulais plus me laisser piéger par les vieux stéréotypes faisant de l’Afrique une terre assoifée de sang et où l’on se massacre, presque sans raison, depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi Murambi, le livre des ossements est de loin mon livre le plus documenté. Pour l’écrire, j’ai lu ou visionné tout ce que je pouvais trouver sur l’histoire du Rwanda. J’ai discuté avec les survivants et avec les tueurs dans leurs prisons. Il en a résulté une moisson de faits que j’ai tenu à exploiter avec beaucoup de prudence. Jai par exemple évité que la description fidèle de certains actes de barbarie n’incite le lecteur à voir dans tout mon récit de la pure invention. La lancinante question de savoir si on peut écrire de la fiction sur un génocide est ici reposée : quel lecteur pourrait bien, en effet, croire des horreurs proprement incroyables ? C’est du reste pour cette raison que tout roman sur le génocide n’a de cesse de nier d’être un roman. J’ai écrit Murambi, le livre des ossement en veillant à rester un ton en dessous et ce n’est pas donc pas un hasard s’il est plus accessible que tous mes autres livres, des Tambours de la mémoire aux Traces de la meute. Écrire dans l’odeur de la mort fait vite passer l’envie des élégants jeux de piste et de miroir. Ces « signatures » d’une esthétique romanesque d’avant-garde à laquelle j’étais si attaché avant le Rwanda, m’ont soudain semblé bien dérisoires face à tant de souffrances humaines. Si j’avais fait l’éloge des assassins réfugiés au Congo, c’était à cause de telles pirouettes d’écriture : on ne m’y reprendrait plus.
Pareille expérience peut faire perdre à n’importe qui son innocence : au-delà de la littérature – je sais que je n’écris plus de la même manière depuis la parution de Murambi – j’ai voulu comprendre ce qui était arrivé.
J’ai en particulier découvert que c’est pour défendre le rayonnement de sa langue que l’Etat français s’est impliqué dans ce génocide de façon résolue et active aux côtés des assassins de vieillards et de nouveaux-nés. Longtemps niée avec indignation par les intellectuels parisiens, cette complicité est désormais largement documentée et même reconnue par tout le monde, y compris dans la société française.
Quant à moi, jusqu’à ce séjour au Rwanda, j’avais fustigé « l’impérialisme » et « le néo-colonialisme » car des ouvrages théoriques, ceux des classiques marxistes, de Fanon, Nkrumah ou Cheikh Anta m’avaient appris à les avoir en horreur. Cela restait toutefois purement abstrait. Les morts du Rwanda ont apporté à cette réflexion leur insupportable poids de sang. En fait, j’ai surtout été amené à analyser la domination dont restent victimes les anciennes colonies françaises soixante ans après leur prétendue indépendance et que résume bien le singulier néologisme – « Françafrique » – forgé par François-Xavier Verschave. Au-delà de l’ouvrage Négrophobie que j’ai co-écrit en 2005 avec le même Verschave et Odile Tobner, je n’ai cessé de dénoncer ce système de pillage économique mafieux et anachronique.
Tout cela m’a permis de mieux comprendre pourquoi la France investissait sur le continent africain autant d’argent et d’énergie pour la défense de sa langue. Or, celle-ci restait l’instrument privilégié de ma fiction romanesque. J’ai alors davantage pris conscience d’être partie prenante d’une littérature africaine extravertie, écrite dans les langues coloniales et »historiquement condamnée », pour reprendre le mot de David Mandessi Diop. Au-delà de Ngugi et Cheikh Anta Diop, The Novel in Africa de John Coetzee m’a sérieusement interpellé. Elisabeth Costello y dit en effet ceci à l’écrivain nigerian Emmanuel Edugu : « Le roman anglais est avant tout écrit par les Anglais pour les Anglais. C’est son essence même, c’est ce qui fait que l’on parle du roman anglais. Le roman russe est de même écrit par des auteurs russes pour leurs compatriotes. Mais le roman africain, lui, écrit par les Africains, ne s’adresse pas aux Africains. Certes, les romanciers africains parlent de l’Afrique, décrivent des expériences africaines, mais j’ai l’impression qu’ils sentent tout le temps par-dessus leur épaule le regard des étrangers en train de lire leur texte. Que cela leur plaise au non, ils se sont résignés au rôle d’interprètes, ils expliquent l’Afrique. Or, comment un romancier peut-il explorer un univers humain dans toute sa profondeur s’il lui faut mobiliser autant d’énergie pour l’expliquer à des étrangers ?» J’ai rarement lu quelque chose d’aussi puissant et définif sur ce que Ayi Kwei Armah appelle sobrement « notre problème linguistique ».
L’envie d’écrire en wolof avait toujours été là, diffuse, non maîtrisée mais c’est ce cycle de réflexion, déclenché par le désir de mieux comprendre le génocide des Tutsi au Rwanda, qui a favorisé le passage à l’acte.
Et nous voici revenus à la conteuse : n’ayant jamais mis les pieds dans une école, c’est en wolof qu’elle me décrivait les noces de Youmané et de la tempête. Sans le savoir, elle me préparait à la création dans ma langue maternelle…
Le passage d’une langue à l’autre mériterait que l’on s’y arrête longuement. Le temps imparti ne me le permet pas. Qu’il me suffise de dire que je dois à mes trois romans, Doomi Golo, Bàmmeelu Kocc Barma et Malaanum Lëndëm – tout comme à la traduction de la pièce de Césaire, Une saison au Congo – une joie jamais ressentie lorsque j’écrivais en français.
Ce processus de retour à soi, éminemment politique, ne saurait se limiter à la sphère de la création littéraire. Nous avons ainsi créé, des amis et moi-même, la maison d’édition en langues africaines EJO qui porte – ce n’est évidemment pas un hasard – un nom rwandais « … Ce groupe éditorial dispense du mieux qu’il peut des cours de wolof et nous sommes également à l’origine de defuwaxu.com, premier et à ce jour unique journal sénégalais en ligne et en wolof.
D’être né à Dakar et d’y être revenu après quelques années passées à Thiès – tout à la fois la ville de la conteuse et de la bibliothèque paternelle dont j’ai souvent parlé – a eu un impact certain dans ma formation intellectuelle. J’ai pu presque sans effort me débarrasser de mes oripeaux d’écrivain francographe pour dire au plus près, dans leur langue, les rêves et douleurs des miens mais aussi de toute l’humanité.
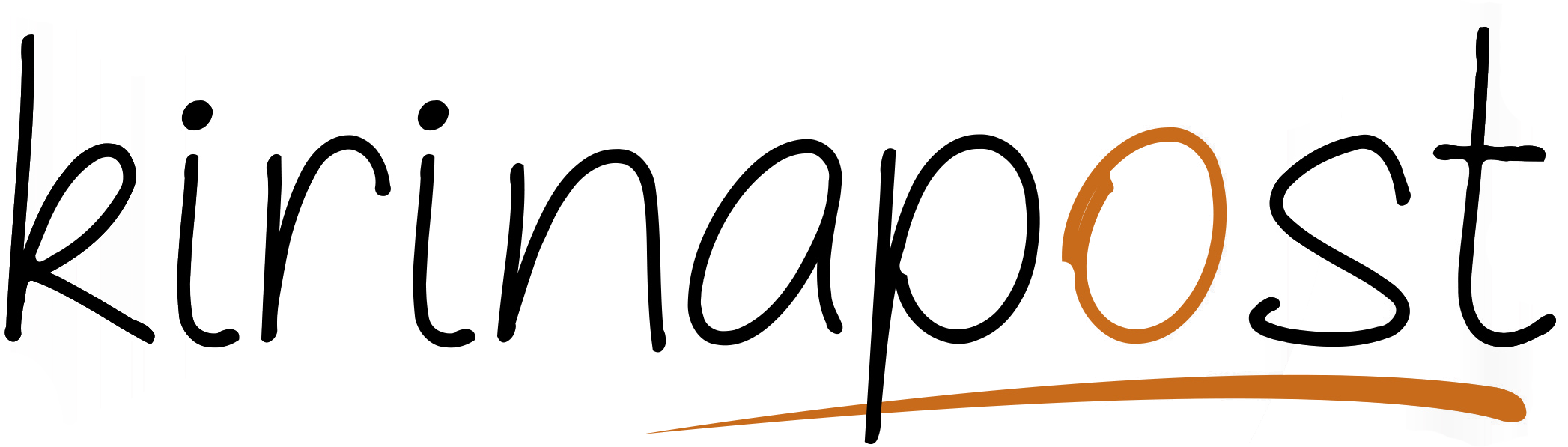










Laisser un commentaire