Dans le torrent de réflexions, de commentaires, de discours, de revendications qui alimentent aujourd’hui les débats sur la gestion de la cité au terme des 100 premiers jours du régime souverainiste en place, il nous semble que les débats sont trop souvent monopolisés par deux types d’approches, deux « écoles » qui s’opposent vivement, mais qui en définitive reposent sur un même postulat : celui d’un régime tout puissant, vu comme une entité homogène au service d’une politique cohérente.
Pour les uns, la puissance au service de l’État est un outil servant à résoudre tous les problèmes, pourvu qu’on lui en donne les moyens en termes d’outils et de stratégie. Pour les autres, cette puissance représente surtout une menace pour les libertés publiques et la démocratie, l’argument du couperet des impôts sur fond de reddition des comptes n’étant alors qu’un instrument aux mains des gouvernants pour mieux asseoir leur diktat sur les acteurs de la vie politique et de l’oligarchie économique et médiatique qui ne veut pas voir ses privilèges voler en éclats.
Or, un examen attentif et surtout dépassionné des pratiques étatiques ou des interactions gouvernement–population montre le manque de pertinence d’un tel a priori plaçant l’action de gouvernance au cœur d’un débat plus idéologique que pragmatique. Bien que ces deux modes de pensée monopolisent les arènes politiques et médiatiques, ils traduisent bien mal une réalité beaucoup plus complexe, où s’enchevêtrent les stratégies des uns et des autres. Ils oublient surtout de poser une question essentielle : celle du fonctionnement interne des services étatiques et de leur adéquation par rapport aux orientations qui leur sont données.
Faut-il sortir de l’oligarchie pour impulser un changement inclusif?
L’oligarchie, d’un point de vue sociologique, c’est l’actuelle classe dirigeante, qui mêle pouvoir économique, pouvoir politique, hauts fonctionnaires, dirigeants de grands médias.
L’autre façon d’envisager l’oligarchie, c’est comme un système de gouvernement dans lequel un petit nombre de personnes va imposer ses décisions à l’ensemble de la société. Il y a une confusion des intérêts et un va-et-vient permanent des personnes entre les différents cercles. C’est dire que nous vivons dans un pays singulier, où l’Etat apparaît tout à la fois garant de l’intérêt général et prisonnier des intérêts particuliers qui le composent ou le travaillent de l’intérieur (« bastilles » administratives, « corporations » ou syndicats de fonctionnaires, groupes de pression ou lobbies de toute nature).
Un obstacle des plus sérieux contre la mue de nos institutions est l’existence de cette oligarchie qui exerce un pouvoir invisible au-delà des changements électoraux et de la liberté de la presse. Les élites précédentes avaient une conscience de leurs devoirs et de leurs obligations. L’oligarchie actuelle estime avoir tous les droits. Selon Hérodote, l’oligarchie se justifiait par le fait de placer au pouvoir les plus vertueux ; aujourd’hui, les puissants visent avant tout la conservation de leur puissance. L’argent devient le principal signifiant de la réussite sociale.
Fini le clivage fondamental qui en démocratie sépare le domaine public, l’intérêt général et le domaine privé relatif aux intérêts privés, par ailleurs légitime. En oligarchie, la coupure est horizontale, elle se situe entre les membres du sommet de la pyramide et le corps social. Raison de plus de dénoncer ceux qui se mettent au service de l’État pour pouvoir, après un passage provisoire, mettre à profit leurs connaissances acquises pour faire fortune. Nous ne citerons pas de noms mais les exemples font foison.
Reprendre le pouvoir au profit des masses
L’oligarchie dépouille au fur et à mesure l’État de ses recettes et de ses capacités de régulation au sein de l’industrie financière. Au Sénégal, il y a fort à parier que les entreprises qui ont pris les risques les plus inconsidérés, ayant conduit à la crise du système financier que nous expérimentons actuellement, sont celles qui ont réalisé les dépenses de lobbying les plus élevées à ces élections de 2024.
Mais il ne faut pas trop se focaliser sur l’appareillage politique. L’oligarchie est un système dans lequel le politique n’est pas le pouvoir essentiel. Il faut mettre l’accent sur le pouvoir économique, avec une politique de nationalisation des secteurs stratégiques.
Comment pouvons-nous reprendre le pouvoir collectivement sur les banques ? Comment redonner de la liberté aux médias, qui sont un enjeu essentiel de la délibération démocratique, aujourd’hui contrôlés par des grands pouvoirs capitalistes ? Quelle sera la posture de ce nouveau régime souverainiste face à la particularité de la situation d’une demande sociale criarde, où cette oligarchie n’a pour but essentiel que de maintenir son système de privilèges complètement démesurés?
Instaurer un nouvel art de gouverner
Aujourd’hui, la plus farouche opposition est cette oligarchie qui a directement le pouvoir par la monopolisation du capital, grâce aux anciens régimes wadiste puis yaakariste qui étaient leurs représentants.
Ce nouvel art de gouverner impose un changement de nos représentations traditionnelles de l’État au Sénégal, où politiques et fonctionnaires de l’Exécutif prétendent décider de l’intérêt général, loin d’un Parlement réduit jusqu’à nouvel ordre à un rôle de défiance et d’hostilité cripto-personnelle contre le chef du gouvernement, sur fond de neutralisation des contre-pouvoirs.
L’absence de majorité parlementaire absolue des tenants actuels du pouvoir contrarie les résultats issus de l’élection présidentielle qui ont amené l’élection du tandem Diomaye-Sonko et l’exécution des réformes portées. De quelle marge de manœuvre dispose ainsi un gouvernement qui met l’intérêt général au centre de son action dans une telle situation de blocage institutionnel ? Si des accords qui semblent somme toute compromis, n’émergent pas pour un fonctionnement plus fluide du pouvoir de délibération, la dissolution de l’Assemblée nationale est inévitable.
Les urgences foisonnent dans un État où tout est à refonder. Les chantiers de la souveraineté doivent privilégier la révolution écologique et agricole : adapter l’appareil industriel à la conversion écologique, abandonner les projets pharaoniques, les constructions d’infrastructures budgétivores, et s’attaquer à cette lancinante demande sociale et instaurer de véritables politiques de jeunesse axées sur une éducation citoyenne et patriotique et une adéquation métiers/emplois.On peut le faire tout de suite. Ce serait déjà énorme.
Se muer en État partenaire plus ouvert
La piste de refondation de l’État semble trouver la panacée dans celle d’un État partenaire plus ouvert au secteur privé national, à l’expertise de la décision privée. Une telle métamorphose des comportements politiques et des attitudes culturelles marquerait un approfondissement de la démocratie elle-même.
La classe détentrice du capital veut un périmètre étatique et responsabilités réduits quand ce nouveau régime anti-système et redistributeur veut un État à responsabilités accrues. Dans le premier cas, le moins d’État contribue à la déchirure sociale, au risque d’une explosion sociale. Dans le second cas, le plus d’État correcteur voit ses « marges » d’intervention se réduire face au pouvoir du marché et des autres États, et aussi en raison d’une tendance à la sclérose de l’action publique. Le risque est alors le coma. En fait, dans les deux hypothèses l’Etat s’affaiblit, parce qu’enfermé dans une logique profonde de délégation des pouvoirs.
Nous sommes habitués à une conception de l’Etat où le politique — c’est-à-dire les centres ministériels — prétend savoir de source sûre ce qui doit nous réunir et impose, en conséquence, sa vision et ses solutions, alors que des exemples proches, au Ghana ou au Cap-Vert, révèlent une conception plus humble du travail étatique dans une démocratie où la principale responsabilité du politique n’est pas d’imposer, mais de créer les conditions de reconnaissance du bien commun.
C’est un sujet qui interpelle citoyens ou gouvernants. L’enjeu est également de greffer l’expertise à la décision. L’ère de l’expertise doit donc aussi être celle de la divulgation et de la dissémination des informations.
Et l’implication des citoyens, aidés des experts dans les décisions collectives apparaît comme le moyen privilégié de créer une véritable «société de la connaissance», où existe encore la politique, c’est-à-dire la maîtrise du cours des choses et le nécessaire impact positif sur la vie des bénéficiaires.
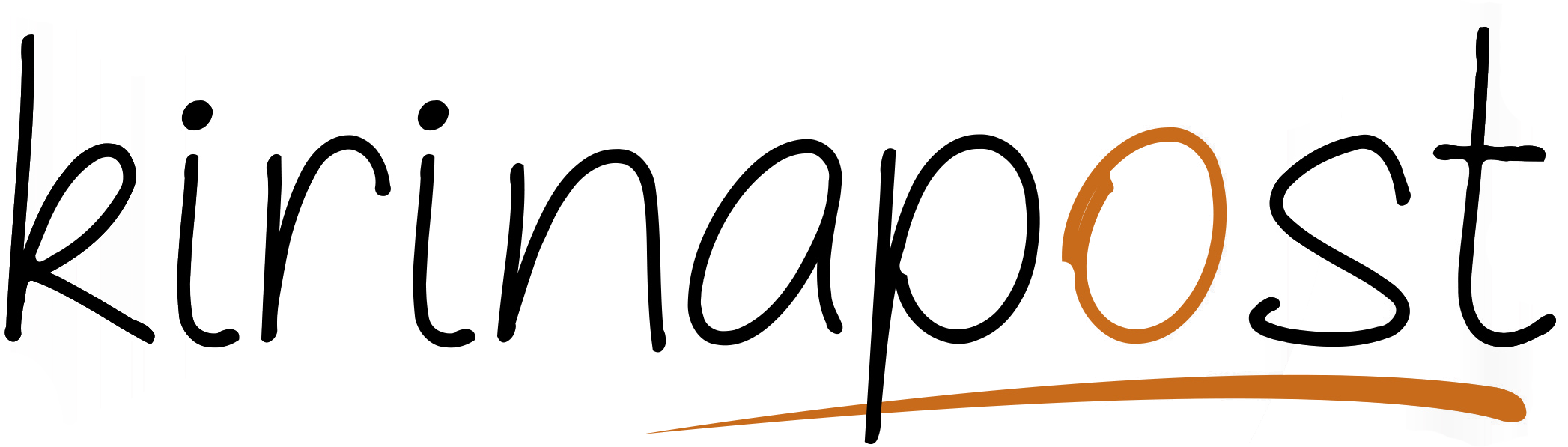




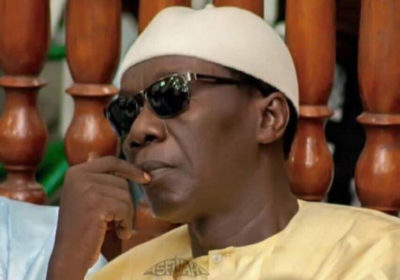

![[NECROLOGIE] – Mort de Boncana Maïga : une flûte se tait, l’Afrique cubaine orpheline, Information Afrique Kirinapost](https://kirinapost.com/wp-content/uploads/2026/03/FB_IMG_1772327871171-120x120.jpg)



Laisser un commentaire