Que peuvent les classes moyennes ? De Londres à Santiago, la révolte des déclassés. Plus instruites que leur aînées, les jeunes générations voient leurs aspirations contrariées par la précarité qui les frappe. Au point parfois de déclencher une colère contagieuse. Source: Raphaël Kempf pour Le Monde-Diplomatique.
«Ma tente est quelque part par-là, à côté de celle du service technique, où l’on s’occupe d’Internet, des liens avec les autres occupations, des mises à jour sur Facebook. Ici, il y a la cuisine, qui sert petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et ici, c’est la tente “thé et empathie”, avec un piano, du thé et du café gratuits ! » A Londres, devant la cathédrale Saint-Paul, au cœur de la City, des dizaines de tentes ont fleuri depuis le 15 octobre 2011. M. Amir Imran nous fait faire le tour du propriétaire.
Il dort ici depuis le début et ne quitte le camp que deux jours par semaine, pour suivre ses cours. Agé de 24 ans, il est arrivé dans la capitale britannique quelques mois plus tôt pour finir des études de journalisme. Il vient de Malaisie, où « il y a une loi draconienne qui permet d’emprisonner quelqu’un si on le suspecte de troubler l’harmonie et l’ordre public. Là-bas, je participais à des mouvements pour le droit à la liberté de manifester. Il nous fallait un permis pour protester. Ici, c’est plus simple, quand même ! ». Il était naturel pour lui de rejoindre les militants d’Occupy the London Stock Exchange (« Occuper la Bourse de Londres »).
Lancé à New York le 17 septembre 2011, le mouvement Occupy (« Occuper ») prétend s’inscrire dans la lignée des « indignés » espagnols et ferait écho à sa manière au « printemps arabe ». Si les situations diffèrent, si les revendications sont parfois nébuleuses, de Londres à New York, de Madrid à Tel-Aviv, on retrouve le même malaise face à un ordre politique qui échappe au contrôle des citoyens et à une oligarchie qui accapare les richesses. Et toujours ce sentiment exaltant d’appartenir à quelque chose de global. Mais, au-delà du souhait des manifestants, peut-on réellement réunir toutes ces mobilisations dans une même catégorie ? Du Caire à Athènes, de Santiago du Chili à San Francisco, assistons-nous à l’émergence d’un « peuple mondial en lutte » ?
La question est posée à deux étudiants chiliens qui, depuis le mois de mai 2011, participent au mouvement pour une éducation publique et gratuite, dans ce pays où la plupart des universités ont été privatisées par le régime du général Augusto Pinochet en 198. Le Chili a en effet connu au cours de l’année 2011 les plus grandes manifestations populaires depuis le retour du pays à la démocratie. Les étudiants ont entraîné dans leur sillage familles et lycéens. Ils en sont venus à poser la question des inégalités et de la réforme de l’impôt, mais aussi celle de la représentativité du système politique. Ils ne se réclament ni des « indignés » ni du « printemps arabe » : ils ont construit leurs revendications par rapport à la situation dans leur pays, mais disent exprimer une colère qui dépasse les frontières du Chili.
Pour M. Andrés Muñoz Cárcamo, « c’est un phénomène global contre la manière dont le système économique fait du profit et détruit les structures sociales. Au Chili, c’est dans l’éducation ; ailleurs, c’est différent ». Tout en prenant soin de souligner les particularités de chacun de ces mouvements, son camarade, M. Vicente Saiz, reconnaît l’existence d’une « base commune » : « Les gens se battent pour prendre eux-mêmes les décisions. » Et il est vrai que l’on retrouve partout cette volonté de récupérer un pouvoir confisqué, le désir de participer réellement à la vie publique et à la manière dont les sociétés sont gouvernées — ce qui s’exprime souvent à travers le simple mot de démocratie.
A la Puerta del Sol, un panneau : « On se retrouve dans les quartiers »
A Madrid, l’ampleur de la colère qui a rempli la Puerta del Sol le 15 mai 2011 — et donné naissance au mouvement dit « 15-M » — a surpris M. Carlos Paredes, qui avait pourtant contribué à organiser cette première manifestation. Le mouvement ¡Democracia real ya ! (« Démocratie réelle maintenant ! »), dont il est l’un des porte-parole, avait été créé quelques mois plus tôt autour de huit propositions allant de la suppression des privilèges de la classe politique à l’application effective du droit au logement et à la réforme de la loi électorale.
Mais, pour cet entrepreneur de 32 ans qui exerce son activité dans les services informatiques, la motivation à battre le pavé est à la fois plus profonde et moins précise que ces quelques propositions. Il y a en Espagne, explique-t-il, « un plafond de verre » qui limite l’épanouissement personnel et professionnel de la population. « Ceux qui sont en haut restent en haut, et ceux qui sont en bas tombent toujours plus bas. L’impossibilité de progresser économiquement et socialement m’a amené à rechercher d’autres voies. Puis j’ai trouvé ¡Democracia real ya ! » Il ne se revendique d’aucun parti ou syndicat, ne se réfère à aucune idéologie politique. Mais il critique, outre un système économique toujours plus inégalitaire, une démocratie qui ne représenterait plus personne, ni en Espagne ni en Europe. Il fustige ainsi ces « coups d’Etat financiers » qui ont porté trois personnalités non élues et issues du monde de la finance à des postes importants : M. Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne, M. Lucas Papademos à celle du gouvernement grec et M. Mario Monti à la présidence du conseil italien.
Cette crise de la représentativité explique l’émergence spontanée d’un ensemble de mécanismes visant à l’adoption des décisions par consensus. C’est parce que les « indignés » se sentaient exclus du politique qu’ils ont élaboré des techniques délibératives aussi inclusives que possible. Ainsi, dès le soir de la manifestation du 15 mai, certains ont proposé de rester sur la Puerta del Sol. L’occupation a duré plus d’un mois, ponctuée d’assemblées générales, de discussions et de groupes de travail sur les thèmes les plus divers. Toutes les personnes rencontrées à Madrid — mais aussi dans les autres mouvements Occupy — nous raconteront avec émotion ces assemblées de plusieurs milliers de personnes, parfois. Le philosophe José Luis Moreno Pestaña, lui, parle d’une « jouissance dans la discussion publique».
M. Ivan Ayala a 31 ans. Il prépare une thèse à l’université Complutense de Madrid sur les fondements méthodologiques de l’économie néoclassique. Il raconte : « J’ai participé à plein temps au mouvement. Au début, c’était impressionnant. Il y avait des groupes de travail qui comptaient cinq cents membres ! Et c’était émouvant d’arriver à Sol et de voir quatre mille personnes en assemblée, en train de discuter comme dans l’agora grecque. » Par rejet du système partisan, le 15-M refuse de se définir comme un mouvement de gauche. Pourtant, sa critique des banquiers, des politiciens, du néolibéralisme et des spéculateurs constitue bien une analyse de gauche, estime M. Ayala. Mais son véritable succès, « c’est que ce soit délibératif, populaire et massif. Maintenant, dans tous les quartiers, tous les villages, des assemblées sont en train de se former ».
C’est ainsi que le 15-M s’est réinventé et a pu poursuivre ses actions en décidant d’arrêter le campement et l’occupation permanente de la Puerta del Sol. On retrouvera cette caractéristique dans les autres mouvements : c’est quand les « indignés » décident de lever le camp qu’ils peuvent s’étendre et toucher un large public, plus populaire, en s’ancrant dans le local. Le 12 juin 2011, quand l’occupation de la Puerta del Sol prend fin, la multitude d’affichettes personnelles épinglées sur la place disparaissent au profit d’une grande pancarte : « Nos vemos en los barrios » (« On se retrouve dans les quartiers »).
A la diversification géographique du mouvement répond l’émergence d’une pluralité d’actions. Une plate-forme a par exemple été créée pour venir en aide aux locataires menacés d’expulsion : lorsque des familles prennent contact avec les « indignés », ceux-ci viennent nombreux le jour prévu pour l’expulsion et arrivent parfois à l’éviter ou à la reporter de plusieurs mois. Ils occupent aussi des immeubles vacants pour y loger des familles dans le besoin.
Permettre de pointer les failles du système démocratique
Le 15-M permet ainsi de mobiliser et d’attirer l’attention sur des questions qui, hier, étaient bien moins visibles. L’avocate Liliana Pineda participe à la lutte pour la gestion publique de l’eau. La communauté de Madrid envisage en effet de privatiser l’entreprise Canal de Isabel II. « Cette campagne, explique-t-elle, est un exemple de collaboration entre le mouvement et certains partis politiques, à travers une plate-forme. Le 15 mai, beaucoup de choses avaient déjà été organisées. Mais, grâce aux “indignés”, il y a eu beaucoup plus de monde à la manifestation du 8 octobre, car la plate-forme était présente dans de nombreuses assemblées populaires. Et des partis politiques — Izquierda Unida, Equo — ont également participé. » L’événement est d’importance, car le 15-M semblait jusque-là refuser tout contact avec les partis politiques, même ceux qui peuvent être proches de ses positions.
Cette question du rapport à la politique n’a jamais été aussi épineuse qu’à l’approche des élections législatives du 20 novembre 2011, qui ont vu la victoire du Parti populaire (PP) de M. Mariano Rajoy (conservateur). Quelle position adopterait un mouvement social qui se veut non partisan face à une échéance électorale aussi importante ? Créer un parti pour « en finir avec le bipartisme », comme certains le proposèrent en juin 2011 ? L’idée fut rapidement enterrée. S’abstenir ? « Nous n’avons jamais appelé à l’abstention, insiste M. Paredes. Nous avons appelé à voter pour des partis minoritaires, car nous étions contre le bipartisme du PP et du PSOE [Parti socialiste ouvrier espagnol]. » Il s’agissait seulement d’identifier — grâce à de savants calculs — le parti minoritaire qui avait le plus de chances, dans chaque circonscription, de battre le candidat d’un des deux grands partis. Cela n’a pas empêché la droite de l’emporter, mais a permis de pointer les failles du système démocratique espagnol. C’est pour le transformer que M. Paredes et ses compagnons réfléchissent aujourd’hui à un projet de « démocratie 4.0 » dans laquelle les citoyens pourraient voter par Internet sur les projets de loi soumis au Parlement.
Mais le véritable succès du mouvement, au-delà de cette inventivité permanente, c’est le poids qu’il a acquis dans le débat politique. Comme aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les « indignés » espagnols affirment que leurs propositions sont désormais sur la scène publique. Et surtout, souligne M. Paredes, ils ont « réussi à internationaliser le mouvement. Occupy Wall Street [OWS] et les mouvements israéliens (7) dérivent d’une certaine façon du 15-M ».
Comment, à l’automne 2011, un petit camp de manifestants dans le sud de Manhattan a-t-il pu se transformer en un « soulèvement global», dans ce pays où les mobilisations populaires semblaient appartenir à l’histoire ? Engagé avec les campeurs new-yorkais, l’avocat Alexander C. Penley rappelle l’importance des précédents qui l’ont rendu possible, comme le mouvement syndical du début de 2011 dans l’Etat du Wisconsin, et considère que le « printemps arabe » a servi d’exemple. « Si une telle chose s’était passée en France, ça n’aurait pas eu le même impact, parce que, vous savez, les Américains se disent que c’est normal, ces manifestations en France, en Europe. Alors qu’au Proche-Orient… Ces pays étaient connus pour être si fermés, bloqués. Si ça marche là-bas, quelque chose peut se passer ici. »
C’est peut-être la raison pour laquelle l’appel à occuper Wall Street, lancé sur Internet par le magazine canadien Adbusters, connu pour sa critique radicale de la publicité, a eu un impact aussi fort. Le 17 septembre, quelques centaines de personnes sont venues manifester dans le quartier financier de New York et se sont finalement retrouvées, presque par hasard, à Zuccotti Park, une place coincée entre quelques gratte-ciel, à deux pas de Wall Street et de Ground Zero. « Quelqu’un a lancé l’idée de faire une assemblée générale, comme en Grèce ou en Espagne », se souvient David Graeber, anthropologue ayant enseigné à Yale et militant anarchiste, qui s’est impliqué dans la planification de l’occupation. Ce jour-là, chose si rare aux Etats-Unis, les gens ont commencé à parler politique, dans la rue, dans l’espace public. Et des revendications ont émergé, diverses, sérieuses ou saugrenues. Lors de la première assemblée générale d’OWS, on a ainsi discuté de l’annulation de l’arrêt « Citizens United » de la Cour suprême, qui en janvier 2010 a renforcé la capacité des entreprises à peser sur le pouvoir politique; mais aussi du retour de la loi Glass-Steagall, dont l’abrogation par M. William Clinton en 1999 a permis l’expansion d’une finance sans contrôle. Et, de manière plus fantaisiste peut-être, certains ont aussi appelé au déboulonnage de la statue du taureau, sur Broadway, si emblématique des rêves de puissance de Wall Street.
Dans les jours qui suivent, les manifestants se font plus nombreux, des tentes émergent : une vie s’installe à Zuccotti Park. On continue à faire des assemblées générales, on s’organise en groupes de travail, on adopte la « déclaration d’occupation de New York ». La place agrège les gens les plus divers. Outre de jeunes hommes blancs diplômés, sont également venus des sans-abri, des minorités et autres « voix marginalisées », dont l’inclusion sur le long terme est un défi — pas forcément gagné. Certains s’affirment communistes ou socialistes, ou désignent le capitalisme comme la cause du problème. D’autres veulent, au contraire, conserver ce système et l’économie de marché, et en demandent uniquement la régulation. La Suite ICI: monde–diplomatique
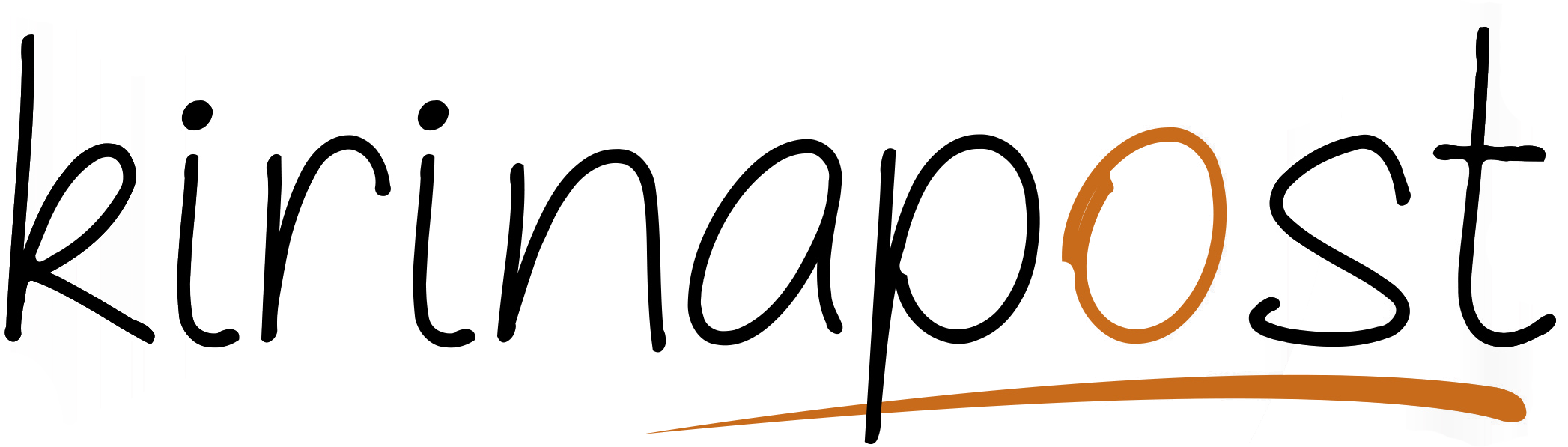










Laisser un commentaire