AU PROFESSEUR ALIOU SOW (Ancien ministre)
« Les chansons sont l’histoire d’un peuple, vous pouvez apprendre plus sur les gens en écoutant leurs chansons que de toute autre manière, car dans les chansons s’expriment toutes les expériences et toutes les blessures, toutes les colères, toutes les craintes, tous les besoins et toutes les aspirations ».
(John Steinbeck, cité par Aliou Kissima Tandia, in Poésie orale Soninké et éducation traditionnelle, Dakar, NEAS, 1999, p. 9.)
Les Gnawa ? Pluriel de gnawi… si l’on s’amuse à l’analogie, on trouve littéralement ceci : « Habitant du Ghana ». Nous pouvons aussi penser au « Legh’na » (chant en Naar Ganaar).
Mais évitons tout raccourci… restons dans la polysémie, sinon nous risquons fort de ne point appréhender le « réel historique », c’est-à-dire ce présent complexe à l’intérieur duquel se déroule un passé, mort-vivant, et un futur en gestation.
Les trois moments se rencontrent, sans se soucier de leur temps de conjugaison. Car il s’agit là de tentative de « perpétuer » en adaptant/adoptant, selon les époques et les acteurs en présence, les figures du changement. Celles qui participent de la visibilité des communautés anciennement dominées. Il s’agit de cette manière de faire, qui n’entame point l’essence de ce qu’on souhaite ne plus être, tout en se remémorant les ancêtres et les douleurs qui ont jalonné leurs existences.
Rappelons les Gnawa, dispersés à travers le Maghreb… comme des « îles noires », ont fini par former une mosaïque aussi complexe que leurs origines ethniques, géographiques, cosmogoniques, « leurs couleurs », leurs chansons, leurs danses… de Lila derdeba au Maroc… en passant par le Stambali en Tunisie, le Diwane en Algérie, le Makeli en Libye… toutes ces manifestations dites de “possession” s’apparentent au Bori des Haoussa… rites qui ont fini par entrer aujourd’hui dans la rubrique “Musiques du monde”
Esclaves furent leurs ancêtres, arrachés à leur milieu culturel et transplantés dans un nouvel univers cultuel, qui allie économie et géographie, et dans lequel ils devaient jouer un rôle plus que secondaire. Leur « culture » est donc assignée « a-domicile ». Elle est scellée par une docilité transmissible, résultant d’un véritable processus de “dressage”.
Une place singulière, malgré où grâce à la religion. Car la religion « autorise », dans ces cas-ci, la perpétuation des relations d’interdépendance, rappelant celles fondées sur des allégeances antérieures à la « modernité ».
En deux exemples : entre sacrifices, offrandes et litanies… »com-plaintives »…
– LE MÛSSEN DES ISEMGAN-S (MAROC)
Dans le chapitre III de son ouvrage, intitulé « Chorfa et Isemgan-s, rejouer le contre-don », Salima Naji analyse, à partir des manifestations des Mûssem de la Zawiya d’Imi n’Tatelt, la complexité du processus de mutations des rapports entre les Chorfas et la communauté noire, qui lui est affiliée depuis toujours. La particularité de cette zawiya est qu’elle ne figure sur aucune carte. Car le village est « accroché au milieu de vastes étendues arides ». Le saint célébré « est mort au milieu du XVIe siècle… les demeures dans leur noblesse semblent avoir été érigée à partir du XVIIe siècle » (pp. 21-22).
Donc, au mois de février la communauté organise un double mûssem : celui des descendants directs de Sidi Mhammd ÙYa’qûb et celui des Isemgan, les esclaves dont la particularité est d’associer les deux communautés noire et blanche !
La communauté dans son ensemble se subdivise en « nobles » et en « ignobles ». En effet, « les descendants du saint sont (…) dans un système à part, clos sur lui-même », « les Blancs non-Chorfas, groupe autochtone et sédentaire, Iznagen, et enfin les Noirs, descendants d’esclaves, considérés par essence comme ignobles. Il est symptomatique que tous ces laïcs se revendiquent sans filiation, les « Iznagen » autochtones comme les Noirs prétendus non-autochtones » (pp. 69).
Il faut noter que la communauté noire est subdivisée en trois groupes : H’arratîn-s (« hommes libres… de second ordre. Leur valeur est nettement inférieure à l’homme libre ». Ils semblent conserver un ancien état de servitude », p. 70), Isuqyn-s « celui, littéralement, [qui se vend] au souk ». Un Asuqi n’a aucun statut social, sa dignité est quasi inexistante parce qu’il ne peut que vendre, au jour le jour sa force de travail. » L’Asuqi est généralement noir de peau, mais « on l’oppose au « vrai » descendant d’esclaves » (p. 71). Et, les Isemgan-s : « Semg (plur. isemgan) renvoie à la couleur de peau, à l’obscurité, c’est-à-dire au Noir, mais à un Noir dont le statut d’esclave est un statut supérieur parmi ceux de l’obscurité » (p. 71).
Quel est donc ce puits profond, sans fond, et au fond duquel se retrouve ce « Noir non-autochtone » ? Il m’a semblé que ce « fond » est rendu dans les déclinaisons de leur mûssem, ouvert aux Blancs, et surtout aux jeunes Chorfas qui semblent le préférer à celui « privé » des descendants directs du saint. Il est plus festif. Salima Naji perçoit, dans les manifestations du mûssem des Isemgan, une sorte de révolte contre l’ordre discriminatoire qui se perpétue malgré toutes les mutations liées à la libération des esclaves, à l’introduction de l’école et à l’ouverture au monde des Noirs marocain d’abord, et ensuite au monde de manière générale.
Salima Naji poursuit : « les sacrifices et les rituels des procession Isemgan-s ne sont pas vraiment liturgiques. Ils font appel à des sphères plus troubles… moins austères et plus séduisantes. »
Si les Isemgan ne se réclament pas Gnawa, ils utilisent des instruments qui rappellent ceux des Gnawa : les crotales (Tîqrqawin), le tambour (Ganga) et les tambourins (bendir). L’obscure domine la manifestation du mûssem des Isemgan-s, comme des réminiscences d’un monde Noir enfoui dans leurs entrailles, et qui s’expriment en toute liberté. D’ailleurs la fête débute l’après-midi « dans une logique de fin de corvées et le soir on se dégage du temps pour soi, c’est l’heure de la fête ».
Comme les Haratin de Mauritanie, qui chantent les louanges du prophète (le mdeh ennabi) la nuit du jeudi au vendredi, le vendredi étant une journée de repos.
2- MEDH ET IDENTITÉ DES HARATINS… « MODERNITÉ RÉACTIVE » ? (MAURITANIE)
La vie, temple de la liberté, se chante… et dans son sillage sonore, des lambeaux – (entre applaudissements, chuchotements… et autres bruits étrangers à la chanson liturgique elle même, éléments qui semblent cependant garantir une part de son esthétique, sans rompre le « fil gris » qui traduit la revendication en abime dans les chants et les transes qui les jalonnent) – s’inscrivent comme des éléments déterminants de la profondeur spirituelle. Celle qui s’empare des acteurs du medh, une partie de la nuit du jeudi au vendredi…
Le Medh ne s’écrit pas, ne se crie pas, il se psalmodie comme des versets coraniques. La profondeur musicale qui structure son essence se déploie dans l’histoire de la guerre, de la capture, de la soumission…. Mais elle s’effectue aussi dans l’avenir formulé dans la félicité future des âmes dans l’au-delà. Ainsi donc, l’âme musicale se surprend agissante au milieu de l’évocation presque nostalgique d’un paradis, pourtant inconnu, et d’une liberté non encore consommée !
Tout cela peut paraître paradoxal. Alors que ces mêmes manifestations se révèlent comme un véritable prétexte de revendication d’une certaine identité. Identité qui se manifeste par l’introduction d’éléments « étranges et étrangers » à la religion telle qu’elle s’exprime à travers la pratique des anciens maîtres, « dépositaires » attitrés de la religion musulmane. Ces pratiques « singularisent » la communauté, tout en validant son ancrage non seulement dans la religion, mais aussi dans la généalogie refabriquée des maîtres, tout en se réclamant de la descendance de Bilal.
Le medh totalise et exprime toute l’ontologie de l’esclave et son attente formulée dans les termes de l’ailleurs. Les fantasmes rencontrent ici les mythes qui entourent les délices du Paradis.
Dès lors, la musique « pourrait être envisagée comme un puissant vecteur identitaire », mais aussi de libération de toutes les entraves mémorielles…
(Extraits de A. NGAÏDE, « Musique et danse chez les Haratin de Mauritanie : Conscience identitaire et/ou dissidence culturelle ? », in Afrika Zamani, Codesria, Nos. 15 & 16, 2007–2008, pp.1–25, Une 1ère version est téléchargeable à partir du site de l’UNESCO).
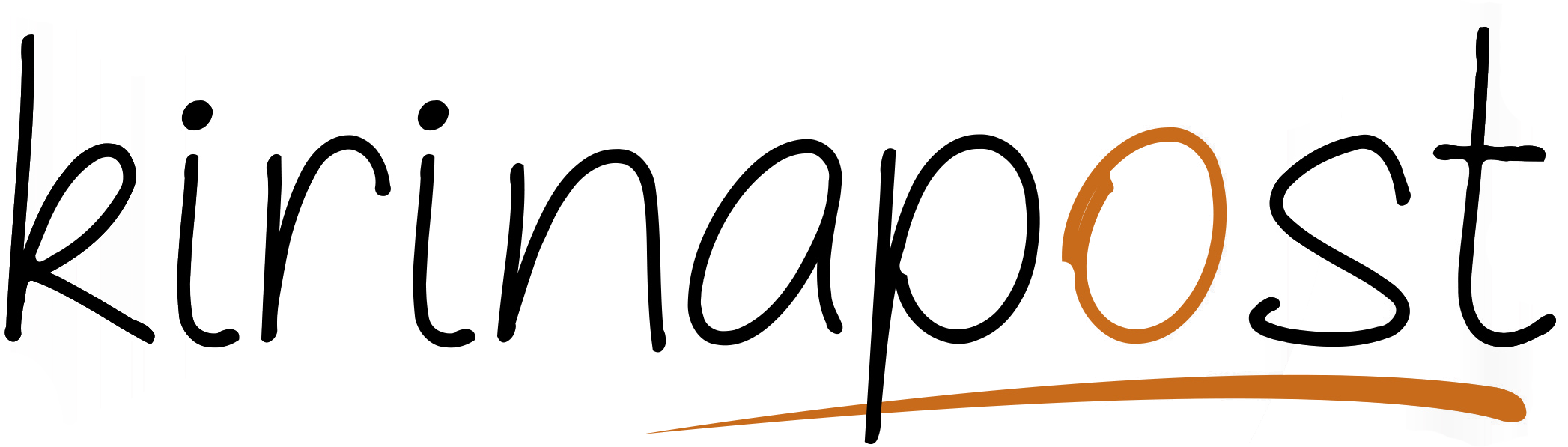



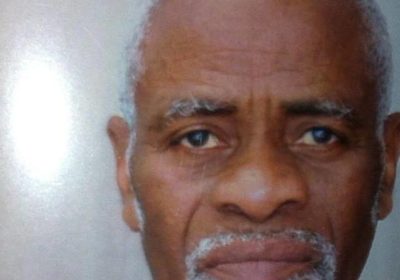






Laisser un commentaire